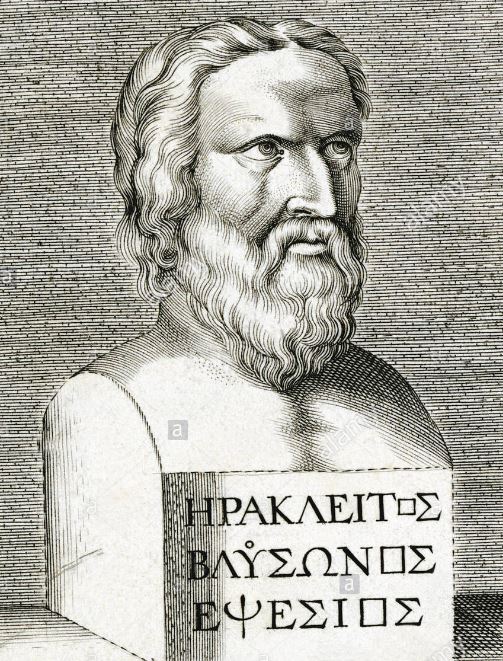« Tout âme est une mélodie, qu’il s’agit de renouer ; et pour cela sont la flûte et la viole de chacun »
Mallarmé, Crise de vers, p. 363, Pléiade 1ère édition.
Dans sa manière d’être habituelle, l’esprit vit d’une vie toute extérieure à soi, aux autres et aux choses. Il ne se rapporte pas à la réalité sans l’avoir préalablement recouverte de ce voile de symboles sur lequel viennent se déposer les significations fixées du langage public. L’immédiat que cherche à reconquérir Bergson dès l’Essai est celui de la présence directe de la conscience à ce qui la constitue et qui l’organise de l’intérieur : les données, qui ne relèvent pas du lexique transcendantal de la donation et de la réceptivité, désignent bien plutôt la multiplicité structurelle de la conscience. Affranchissant l’esprit du langage extérieur et de son usage naïf, l’intuition semble constituer une forme de connaissance muette et du dedans. Mais un grave soupçon pourrait peser ici : l’intériorité qu’il s’agit de renouer n’est-elle qu’une métaphore, c’est-à-dire un simple effet du langage ? N’y a-t-il d’intériorité que celle d’une psyché transportée hors de l’espace matériel ? Serions-nous reconduits à cette métaphysique dont la différence la plus radicale qui soit est une différence « ontique » entre deux choses présentes subsistantes ? Or, la relation entre l’intérieur et l’extérieur n’est pas celle entre deux lieux séparés. Une telle discrimination se fait toujours de l’extérieur, c’est-à-dire qu’elle est le produit d’une modalité spatiale de la différence : on s’en tient à l’extériorité réciproque du dedans et du dehors, ignorant du coup l’existence de deux guises de la différence : la distinction entre éléments juxtaposés dans l’espace d’une part, et la différenciation temporelle d’autre part. Il s’agit pour Bergson de penser aussi bien l’intériorité de la conscience que l’extériorité des choses comme une multiplicité dynamique et temporelle. Puisque l’intériorité ne saurait être extérieure à l’extériorité, entre l’intériorité et l’extériorité, la différence doit être pensée comme une différence de tension et de rythme, comme une différance temporelle et non comme une distinction statique.
L’intériorité et l’extériorité ne s’opposent pas du point de vue de l’intuition et de la conscience immédiate. Elles s’opposent du point de vue de l’intelligence et de la conscience réfléchie. En effet, dans la mesure où elle lui permet de penser du dedans (sans besoin de sortir de soi) le dedans de tout devenir et d’en pénétrer le déploiement intime, l’intuition rend l’esprit intérieur à soi comme à tout ce qui se meut. Je peux ainsi, par exemple, me mettre en pensée à la place d’un mobile en mouvement pour éprouver ce qu’il éprouve au lieu de me contenter de considérer du dehors le dessin qu’il laisse sous sa trajectoire. Je peux pénétrer les trillions d’oscillations qui font vibrer la matière avant leur condensation dans la perception. Je peux aussi sympathiser avec la vie elle-même et en ressaisir l’élan en moi au lieu de rester fasciné par les formes extérieures et toutes faites1. Je peux enfin communier avec l’humanité dans son ensemble et revivre le mouvement générateur des sociétés.
Intérieure est la contraction ekstatique de l’élan qui ramasse le passé pour créer l’avenir. Ce qui est extérieur tend à relâcher sa dynamique, à prendre un rythme de plus en plus dilaté en s’attardant dans un présent presqu’interminable. Mais l’extériorité reste tout de même un mode de l’intériorité, son mode le plus détendu. S’il y a de l’intériorité, celle-ci ne saurait dès lors être pensée autrement que comme intégrant tout dehors – de sorte qu’il faut reconnaître au final que tout est intérieur à tout, qu’il n’y a rien d’extérieur au Tout : « Dans l’Absolu, nous sommes, nous circulons et vivons2 ». L’étendue de durée cosmique n’est elle-même rien d’extérieur par rapport à une intériorité-forteresse retranchée en elle-même et constituant un district ontique spécial. Le Tout est vie psychique parcourue de frissons d’émotions, celles-là mêmes que les grands mystiques sont capables de lancer, de relancer et de partager. Cette immensité mouvante qui ne cesse de se modifier intérieurement, qualitativement, advient même dans un verre d’eau sucrée. S’il faut attendre que le sucre fonde dans le verre, c’est d’abord parce qu’on ne saurait isoler des sous- systèmes indépendants et détachés les uns des autres ainsi que du Tout : chaque changement dans un système artificiellement clos (le verre d’eau sucrée) implique un changement de l’univers entier avec lequel ce système fait corps. Chaque mouvement particulier, même le plus insignifiant, est pris dans la refonte radicale du Monde.
C’est pourquoi, nous ne sommes véritablement intérieurs à nous-mêmes que lorsque nous devenons conscients de notre intégrité comme durée psychique d’une part, et de notre intégration à la totalité mouvante d’autre part. La représentation d’intériorités séparées et extérieures les unes aux autres tient au schème de divisibilité que notre activité pratique jette sur l’étendue matérielle pour la géométriser et la rendre malléable, c’est-à-dire appréhensible logiquement et pratiquement. Une vie extérieure à soi est une vie vouée à l’espace sous toutes ces formes : une vie accrochée aux montages sensori-moteurs de l’habitude, lesquels facilitent le travail de fabrication mais aussi la vie sociale, et s’appuient sur les significations et expressions toutes faites du langage. L’activité philosophique vise à surmonter ces modes d’être spatiaux et à en conjurer les effets sur la connaissance et la vie (la vie de la connaissance et la connaissance de la vie), sur la pensée et l’être (l’être de la pensée et la pensée de l’être). Si le langage est bien ce qui me sépare de moi-même, me sépare des autres, des choses, et sépare les choses les unes des autres, toute la difficulté sera d’élaborer un discours capable de restituer la vie intérieure de toute chose (l’âme, la matière, la vie, la société) sans la dénaturer. Il ne s’agit pas de contempler cette vie vivante de l’extérieur, mais d’agir sur elle de l’intérieur. La métaphysique expérimentale de l’intuition immédiate implique en effet un travail de fond sur l’âme en son entier : il s’agit de tirer de soi plus que ce qu’il y a en accomplissant la création de soi par soi. Cette création porte sur l’esprit en un triple sens, qui correspond à la structure ekstatico-horizontale de la temporalité :
- Être passé : approfondissement de la vie intérieure (ramasser sa mémoire),
- Advenir : intensification de la personnalité (prendre son élan) et
- Être auprès du présent : élargissement de soi (activer l’intuition).
Comment formuler l’appel invitant l’âme à rentrer en elle-même, trouver l’élan nécessaire pour se déborder elle-même et tout remplir d’intériorité ? Alors qu’il cherche à briser les cadres du langage pour dire ce qui échappe à sa prise, Bergson use somme toute d’une langue assez classique. Mais peut-on vraiment s’extraire de la tradition tout en continuant à utiliser son langage ? En philosophie, l’académisme de la langue est pourtant une nécessité. Or, de la langue de l’espace, Bergson n’est pas dupe, comme en témoignent non seulement le détournement qu’il fait subir aux concepts traditionnels, mais aussi la compréhension et l’usage même qu’il nous propose du concept lui-même : la création d’un concept doit répondre à un problème déterminé dont nous ne nous contenterons plus de recevoir les termes tout prêts de la tradition. Un même concept doit être à chaque fois retaillé sur mesure pour une réalité déterminée : il n’a rien d’une clef passe-partout.
Considérons par exemple le concept de succession, tel qu’il est appelé par le problème de la mémoire et plus généralement par le problème de l’union de l’âme et du corps : Bergson n’ignore pas qu’il l’emprunte à une tradition qui n’a jamais considéré les parties du temps comme simultanées. Dans la conception aristotélicienne, le présent s’étend à la fois vers l’avant et vers l’après, et la succession se comprend comme une succession d’instants présents. La succession temporelle découle du caractère de transition et de continuité du présent : chaque maintenant passe en arrière pour laisser la place au maintenant suivant. Ce qui est présent devient passé et ce qui était à venir devient présent. Or, si la durée est succession, elle n’est pas la succession qui va du présent ou de l’avenir vers le passé. Le passé n’était pas présent avant de devenir passé, il n’a rien d’un ancien présent comme le suppose l’image traditionnelle de la succession. Nous ne passons jamais du présent au passé, mais du passé à l’avenir. Sous sa forme pure, mon passé est certes inagissant, non pas en tant qu’il n’est plus, mais en tant qu’il n’est pas encore : il doit s’actualiser pour ouvrir l’avenir prochain. Son actualisation dépend en effet de son utilité aussitôt qu’il peut s’insérer dans le présent de la perception sensorimotrice. En ce sens, la mémoire réveille un souvenir en le faisant progresser depuis le passé inagissant où il se conserve (et non dans l’actualité présente des traces cérébrales) jusqu’au présent perceptif, en y incluant l’avenir immédiat de l’action possible : quand je perçois ce fruit, j’ai à la fois le souvenir de la fraise et l’invitation à la cueillir.
De plus, il faut rappeler que le concept de succession n’a aucun privilège à l’intérieur du tissu d’oppositions qui dramatisent la différence entre durée interne et espace externe. On ne peut expliquer par une même et unique forme de l’opposition tous les dualismes bergsoniens (succession-simultanéité, immédiat-médiat, fusion- juxtaposition, continuité-discontinuité, qualité-quantité, inétendu-étendu, liberté- déterminisme, esprit-matière, intuition-intelligence). Certes, Bergson n’a pas cherché à mettre en évidence sur un mode structuraliste et « catégorial3 » l’agencement de toutes ces notions. Rien ne nous autorise cependant à privilégier l’une d’entre elles pour articuler toutes les autres sur le modèle déductif d’une table de catégories…
De plus, la multiplicité des images que Bergson propose des phénomènes psychiques doit atténuer ce que l’une d’entre elles aurait d’envahissant ou de conceptuellement rigide. Il lui arrive par exemple de parler (de façon toute traditionnelle) de la durée comme de quelque chose qui s’écoule, mais la durée ne fait pas que s’écouler : elle est aussi jaillissement, explosion, enroulement et déroulement, création de nouveauté et conservation du passé, ouverture et clôture, etc.
Par ailleurs, Bergson ne s’interdit pas d’utiliser la géométrie pour décrire la Mémoire, lieu pourtant le moins pénétré d’extériorité. Peut-être que ces figures assouplissent-elles déjà le concept d’espace4 ? Les images utilisées pour suggérer la mobilité de l’esprit peuvent même sembler se contredire : par exemple, Bergson parle pour désigner l’esprit tantôt de contraction (selon qu’il s’insère dans le présent) et tantôt de dilatation (selon qu’il étale les souvenir dans le passé spirituel) alors que la dilatation a pu désigner par ailleurs l’état rythmique de la matière (durée infiniment détendue). De même pour les schèmes de l’ouverture et de la clôture. Dans Matière et Mémoire, l’ouverture est un caractère du spatial et la clôture celui du temporel (la conscience qui ouvre l’espace à mesure qu’elle referme le temps derrière elle) tandis que dans Les deux sources de la morale et de la religion, l’ouverture est dynamique et temporale et la clôture statique et spatiale (l’Ouvert du monde met en marche une humanité intérieure et la clôture sépare et immobilise les individus et les peuples).
Ce qui se joue ici n’est rien moins qu’une tentative pour dire ce qu’un discours rigide et fixé empêche de pressentir. Le flou dans lequel l’intuition nous laisse de prime abord n’est tel que parce que la clarté naturelle, dont notre intelligence s’enorgueillit, n’éclaire rien d’autre que ce que nous comprenions déjà par avance. Conformément à sa dimension mathématique, l’intelligence ne peut apprendre que ce qu’elle sait déjà. Avec l’intuition, nous consentons à affronter une innommable obscurité, le tout autre en moi ou en dehors de moi : l’inconnu acquiert une primauté sur le connu, le problématique sur l’apodictique. Dans la deuxième partie de l’introduction à la Pensée et le mouvant, Bergson distingue entre la clarté du concept intellectuel et celle de l’idée intuitive. L’idée « radicalement neuve et absolument simple 5 » surgit dans les ténèbres tandis que le concept, qui consiste en un réarrangement complexe d’idées déjà connues, se présente d’emblée en toute clarté. Pour l’exprimer dans le discours, il suffit d’en déduire les concepts qu’on y avait auparavant déjà enfermés. Les concepts fournissent des solutions pratiques et générales mais l’idée simple est essentiellement problématique et singulière : son obscurité capture la pensée avant de diffuser peu à peu une lumière sur des problèmes qui finissent par l’éclairer en retour. La vision intérieure n’éclaire rien, tout comme elle ne capte rien entre ses pinces : au lieu de procéder à la reconstitution idéale du réel dans un langage tout fait à partir d’un principe explicatif abstrait, elle est tenue d’accompagner ce mouvement de va-et-vient par lequel l’idée se développe en problèmes. La vie de l’idée ou du sentiment comprend donc une tension vers son expression la plus propre. Celle-ci demeure par principe toujours inachevée et la multiplication des images ne viendra jamais complètement à bout de ce qui est à dire et qui correspond à l’évolution créatrice d’un être, qui advient au langage en glissant de ses filets.
Il pourrait facilement sembler que la critique bergsonienne du langage ne considère celui-ci que comme une chose de l’espace et de l’extériorité, nous vouant à étiqueter et distinguer les objets extérieurs, plus généralement à immobiliser ce qu’il y a de mouvant dans la vie intérieure. L’espace quadrillé du langage aliène la vie psychique en faisant « tomber dans le domaine commun6 » les événements vécus. Le « mot brutal » provoque « l’écrasement de la conscience immédiate7 » ; il « écrase ou tout au moins recouvre les impressions délicates et fugitives de notre conscience individuelle 8 » ; la vie intérieure est réduite en une juxtapositions d’états indépendants les uns des autres mais aussi du moi lui-même. Aussitôt que des états sont nommés, les événements internes (sensations, émotions et idées) auront acquis une immobilité et des « contours précis » ; l’individu perd toute ressemblance avec sa vie intérieure à laquelle le mot aura communiqué « sa banale coloration9 ». En toute rigueur, on ne saurait jamais parler de cette confusion mobile, en « perpétuel devenir10 », qui caractérise le courant psychique. Un sentiment traduit en mots cesse d’appartenir à la série entière des évènements psychiques avec lesquels il entretient une relation de modifications réciproques. Original dans sa qualité, et multiple dans sa singularité, le sentiment profond est pris dans un processus d’individuation inachevée et de division ininterrompue11. Une émotion aussi riche que l’amour se signale par « mille éléments divers qui se fondent12 ». Ces éléments qui s’entre-pénètrent sans se distinguer n’ont pas non plus à proprement parler de nom : aucun mot ne saurait correspondre à une multiplicité symphonique qui concentre en elle d’innombrables processus simples fondus les uns dans les autres – sensations, images du souvenir ainsi qu’un nombre indéfini d’affections élémentaires. Plutôt qu’en une somme d’états, la vie intérieure consiste en un processus perpétuel de division, mais de division sans produits Elle ne constitue pas une totalité par sommations : tout demeure intérieur à tout. En y discriminant des éléments comme autant d’atomes psychiques, le langage analytique n’en donne qu’une ombre fade et impersonnelle.
En réalité, le mot n’est pas en lui-même destiné à figer la mobilité psychique. Il n’aurait pas le pouvoir de le faire si notre conscience elle-même n’y trouvait son intérêt, à la fois vital et social. C’est la vie et la vie en société qui tirent profit des mots, du fait des nécessités de la coopération pour la survie. Dans L’Évolution Créatrice, Bergson ira même jusqu’à attribuer au mot un pouvoir libérateur en en soulignant la mobilité fondamentale : même si les mots finissent par chosifier tout ce dont ils parlent, ils auront à l’origine permis à l’intelligence, qui les chevauche, de cheminer d’une chose à l’autre13. Les mots sont les véhicules qui nous permettent d’emprunter le cours irrésistible de la vie « qui emporte nos états de conscience du dedans au dehors14 ». Ils nous rendent par là attentifs aux besoins de notre corps, aux choses mais également aux autres avec qui nous partageons notre existence. Sans les mots, nous resterions absorbés en nous-mêmes ou fascinés par les choses présentes. Les mots arrachent homo faber à la distraction et lui ouvrent un champ illimité d’actions. En faisant entrer la vie intérieure « dans le courant de la vie sociale15 » pour satisfaire les exigences de la vie animale, les mots ne font pas dès lors que projeter le dedans au dehors : ils permettent au moins un processus d’intégration à un certain type de processus, celui de la société. Sans eux, nous n’aurions jamais intégré la vie en commun, qu’elle soit dans l’ouverture ou dans la clôture : dans le premier cas, l’individu accède à son appartenance à l’humanité en s’exposant à ce qui n’est pas humain, le divin innommable, et dans le second cas, l’individu se découvre exclusivement dans son appartenance nationale comme dans les dieux de sa cité. La clôture n’est que l’effet d’un piétinement sur place d’une société incapable de sortir d’elle-même pour s’expliquer avec une autre, autrement que par les armes. Comme le fait remarquer Bergson, la guerre ne peut vraiment être désirée par celui qui parle la langue de l’ennemi et qui partage sa culture.
Certes, le langage représente ce qui dure à travers des arrêts et stationnements ; il nous fait appréhender le mouvement comme une succession de positions et le changement comme une succession d’états. Mais c’est aussi la représentation qu’il donne de lui-même quand il se décompose en adjectifs (figeant la qualité en un moment unique : orange, rouge, joyeux, triste), noms (fixant les étapes de l’évolution de l’individu : enfant, jeune, vieux) et verbes (exprimant une action déjà terminée ou intentionnée par avance : boire, manger, courir). En se disant lui- même, le langage subit cela même qu’il impose à la réalité mouvante : il se décompose en types de mots, c’est-à-dire en autant d’éléments extérieurs les uns aux autres et mis bout à bout, sur le modèle de l’extériorité des objets extérieurs dans l’espace. Le langage chosifie les processus évolutifs, qualitatifs et extensifs pour autant qu’il s’est déjà chosifié lui-même. La critique bergsonienne ne porterait dès lors que sur l’aspect superficiel du langage : en assignant le langage à l’intelligence, c’est-à-dire à cette puissance de composition et de décomposition indéfinies en n’importe quel système16, Bergson ne serait entrain de nous parler du langage que du dehors, en tant qu’il constitue une pluralité de mots.
Mais la parole ne doit pas nous condamner à spatialiser la durée. Son exercice peut être assoupli pour épouser les fluctuations et les nuances singulières de ce qui dure. Il y a dans le langage lui-même les ressources pour dépasser les limitations inhérentes à son expression. Dans L’Évolution créatrice, Bergson propose de former un langage du devenir, « mieux moulé sur le réel17 » pour échapper à l’imitation cinématographique où le réel semble dérouler une bande où tout est préfiguré, en construisant des phrases dans lesquelles le devenir est le sujet de l’énoncé. On cesserait de s’y représenter l’accident d’une substance ; on comprendrait qu’il n’y a rien sous le changement et que le devenir est substantiel18. Mais il ne suffit pas de recombiner autrement les mots et de se contenter de formules autorisées. C’est la phrase comme processus en formation qu’il faut considérer.
Qu’est-ce que la phrase ? Les Grecs appelaient phrâzein, l’effort pour dire une pensée simple de la manière la plus simple et avec le moins de mots possibles. Une telle pensée ne saurait s’exprimer en quelques mots, et en même temps, on ne peut s’empêcher ni jamais s’arrêter de vouloir la dire19. Avant même d’évoquer un acte de parole, phrâzein signifie « prendre garde », « veiller sur ». Sur quoi ? Précisément sur cette « image fuyante et évanouissante20» secrète et merveilleuse que le philosophe est tenu toute sa vie durant d’écrire. L’adjectif aphrastos désigne ce qui est invisible, caché, inexplicable inexprimable, indicible mais qui cherche en même temps à être dit. Il faut également beaucoup d’epiphradeia (prudence et sagesse) pour renoncer à la bonne formule et consentir à une formulation sans fin. Cet « inédit » n’est pas simplement ce qui échappe à toute parole, ce qu’on ne peut pas exprimer. C’est ce qui suscite la nécessité de parler d’une autre façon que la manière habituelle – la parole créatrice qui ne parle pas pour redire ce qui a été dit (elle ne parle pas d’elle-même), ni ce qui est actuellement ou potentiellement dicible, mais pour produire de l’indicible.
Nous sommes conduits à reconnaître au langage un pouvoir de manifester les nuances multiples de notre vie intérieure, de les susciter, voire d’en créer de nouvelles. La poésie est cette parole qui n’est plus au service de la conservation des significations publiques. Ainsi, les phrases de Rousseau à propos de la montagne provoquent des sentiments que la montagne, ou que d’autres phrases et d’autres poètes ne nous auraient jamais donnés21. Dans son usage musical de la parole, le poète donne à entendre les harmoniques d’une « émotion nouvelle », entièrement créée. Et nous avons besoin de lui, autant pour ressentir des émotions inconnues, que pour prendre garde à ce qui en nous échappe habituellement à notre attention : « Au fur et à mesure qu’ils nous parlent, des nuances d’émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps, mais qui demeuraient invisibles : telle l’image photographique qui n’a pas été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. » Sans la parole poétique, ces nuances resteraient entièrement voilées, enveloppées dans une nébuleuse indifférenciée.
De même, le romancier veut suggérer ce qui ne peut se dire dans les formes habituelles du discours, en cherchant à rendre sensible la confusion multiple des sentiments et à révéler l’« absurdité fondamentale » qui soutient la logique de son discours22. Ses personnages, qui sont des complications et des fantômes virtuels de sa propre personnalité, sont tout autant les débris de notre propre moi : ce que nous sommes, ce que nous pourrions être, ce que nous aurions pu être. Mais l’aventure littéraire du roman ne peut aller jusqu’au bout de ce qu’elle promet. C’est par intermittences seulement que le romancier nous aide à surmonter notre aliénation dans la vie extérieure en nous remettant « en présence de nous-mêmes : « Encouragés par lui, nous avons écartés pour un instant le voile que nous interposions entre notre conscience et nous.23. » Le romancier n’est donc pas en mesure d’assurer à l’âme le renouement recherché. Mais s’il parvient à surmonter la brutalité du mot et à faire entendre une mélodie intérieure susceptible de résonner avec d’autres mélodies intérieures, c’est par le soin qu’il apporte à ses phrases. Il montre par là une direction que le philosophe ne peut ignorer24. Or, la phrase se distingue des mots tout comme l’exécution simple de la symphonie en musique se distingue de sa figuration symbolique. Elle est rythme et trajectoire du mouvement naturel de la pensée (dans cette mesure, une phrase peut consister en un seul mot). En tant qu’unités mises bout à bout, les mots en revanche correspondent aux points qui composent une ligne et aux positions successives par lesquelles l’intelligence appréhende le mouvant dans l’espace.
Dans un passage de l’Energie spirituelle où Bergson assimile l’expérience de la lecture à la télépathie et à l’interprétation en musique, il s’agit précisément de penser la possibilité d’une communication sans mots, bien que portée par la phrase : « L’art de l’écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu’il emploie des mots. L’harmonie qu’il cherche est une certaine correspondance entre les allées et venues de son esprit et celles de son discours, correspondance si parfaite que, portées par la phrase, les ondulations de sa pensée se communiquent à la nôtre et qu’alors chacun des mots, pris individuellement, ne compte plus : il n’y a plus rien que le sens mouvant qui traverse les mots, plus rien que deux esprits qui semblent vibrer directement, sans intermédiaire, à l’unisson l’un de l’autre25. » La lecture à voix haute d’un texte aide précisément à en saisir l’élan, c’est-à-dire le sens mouvant : « le rythme dessine en gros le sens de la phrase véritablement écrite26. » Lire (legere) au sens littéral revient à rassembler le mouvement du sens dans sa simplicité27. Le bon écrivain parvient par ses phrases à conjurer la spatialité de la langue en restituant le mouvement d’une pensée et d’une émotion, comme l’artiste, dont la perception extraordinaire épouse l’unité générative des formes, en figure le mouvement vivant. Et de même que les cours de dessin devraient commencer par l’étude des courbes intérieures au lieu de celles des contours des formes géométriques simples28, on devrait initier les enfants d’abord à la compréhension du rythme phrastique, pour les familiariser avec cette dimension intérieure du langage, au lieu de se contenter de leur inculquer les habitudes motrices servant à la reconnaissance des mots-étiquettes.
En tant que saisie immédiate de l’essence intérieure de ce qui est mouvant, l’intuition est elle-même une grande lectrice et son livre, c’est le livre du monde : « Dans la page qu’elle a choisie du grand livre du monde, l’intuition voudrait retrouver le mouvement et le rythme de la composition, revivre l’évolution créatrice en s’y insérant sympathiquement29. » Le verdict inaugurant l’Essai (« nous nous exprimons nécessairement par des mots et nous pensons le plus souvent dans l’espace30 ») n’a dès lors rien de définitif. Toute l’œuvre du penseur de la durée témoigne d’un effort pour mettre en phrases l’aphrastos et nous faire oublier les mots- étiquettes.
Il est remarquable à quel point les efforts pour dire l’intériorité auront fini par révéler une part intérieure du discours lui-même. La vie intérieure, bien loin d’être absolument hétérogène au langage, se révèle comme la phrase d’un long discours, une phrase interminable, qui ne connaît ni le mot ni la ponctuation forte : « je crois bien que notre vie intérieure tout entière est quelque chose comme une phrase unique entamée dès le premier éveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée par des points31. » Ce n’est pas une simple image métaphorique : le discours imagé donne le sens propre car il parle à la conscience immédiate – à la différence du discours littéral qui est pour sa part figuré, dans la mesure où il soumet la compréhension aux symboles32. Chaque conscience individuelle est une phrase avec son rythme, son mouvement et son sens. Le langage-outil tend à en recouvrir le plus souvent le bourdonnement incessant. Mais en même temps, nous n’avons le langage que parce que nous sommes un discours intérieur. La reconnaissance d’une parole intérieure, incommensurable avec toute expression qui revient à traduire de la durée en espace, doit dès lors entraîner une reconsidération du statut du langage dans lequel Bergson voyait un équipement de l’intelligence destinée à travailler la matière.
L’une des erreurs que l’on commet habituellement, c’est de poser le langage comme une totalité autonome, indépendante et toute faite, avec des énoncés déjà formés, ou prédonnés à titre de possibles. Nous échouons à penser son advenue dans l’écoute intérieure, qui précède et accompagne l’expression orale et écrite. C’est que l’attention à la vie nous porte moins à comprendre les processus de formation du verbe que les résultats déjà formés de ses productions. Pour saisir la parole en gestation, la pensée doit revivre le mouvement de composition de la phrase intérieure, de ce discours qui « dure depuis des années » et qui se poursuit « en une phrase unique ». Cette phrase infra-linguistique au cœur du langage, lieu de la parole formulée, participe activement à son élaboration : phrase inédite, créatrice, virtuelle, toujours en voie d’actualisation et différant perpétuellement son terme. Pour parler, pour exécuter un mouvement, il doit se passer quelque chose en nous. Cela est de l’ordre d’une posture de l’esprit envers un schème d’action encore vague. Il s’agit de toute la série de préparatifs qui précèdent l’articulation et la formulation du discours. La phrase intérieure est au point de convergence de deux tendances, deux mouvements, l’un psychique et l’autre sensori-moteur : le souvenir d’une idée et la matérialité d’une perception. Nous parlons au croisement d’une évocation et d’une écoute.
C’est dans les états pathologiques où le sujet devient incapable d’écoute intérieure, que cette parole intérieure se signale de manière insigne. La surdité verbale (ou aphasie réceptive, aphasie sensorielle) se caractérise précisément par une incapacité à entendre la voix qui résonne intérieurement avant et à mesure que le discours s’exprime dans la voix matérielle ou s’élabore dans l’écrit. Or, toute l’approche de cette forme d’aphasie par les psychologues associationistes de son temps est selon Bergson viciée par ce présupposé, selon lequel les noms représentent des choses. On réduit la maladie à l’incapacité de se représenter des images verbales toutes faites auxquelles correspondent des mots. Et par là, on suppose que la phrase n’est qu’une succession de mots juxtaposés, tout comme on croit que le temps est une succession d’instants ou le mouvement une succession de positions : « On croirait, à entendre certains théoriciens de l’aphasie sensorielle, qu’ils n’ont jamais considéré de près la structure d’une phrase. Ils raisonnent comme si une phrase se composait de noms qui vont évoquer des images de choses. Que deviennent ces diverses parties du discours dont le rôle est justement d’établir entre les images des rapports et des nuances de tout genre ? Dira-t-on que chacun de ces mots exprime et évoque lui- même une image matérielle, plus confuse sans doute, mais déterminée ? Qu’on songe alors à la multitude de rapports différents que le même mot peut exprimer selon la place qu’il occupe et les termes qu’il unit33 ! » Le sens d’un mot ne consiste pas dans sa portée iconique, celle qu’une définition stricte aurait pour fonction d’éclaircir et de fixer une fois pour toutes dans un dictionnaire. Son sens est à chaque fois déterminé par la phrase entière dans laquelle il est pris : la place qu’il y occupe, sa relation aux autres mots. Comprendre la parole que nous prononçons ou que nous entendons (ce dont l’aphasique sensoriel est devenu incapable), ce n’est pas partir d’images verbales, mais du mouvement de pensée par lequel la parole se forme. Le malade n’est pas dans l’incapacité de se représenter l’image des choses dans les noms. S’il ne parvient pas à former des phrases sensées, ce n’est pas parce qu’il a cessé de comprendre les mots, mais c’est parce qu’il ne reconnaît plus le mouvement sous- tendant et sous-entendu dans les phrases qu’il dit ou entend. Les images verbales rattachées aux mots ont valeur d’indices : elles permettent de suivre le mouvement de la pensée, mais elles ne suffisent pas pour la comprendre : « je comprendrai votre parole si je pars d’une pensée analogue à la vôtre pour en suivre les sinuosités à l’aide d’images verbales destinées, comme autant d’écriteaux, à me montrer de temps en temps le chemin. Mais je ne la comprendrai jamais si je pars des images verbales elles-mêmes, parce que entre deux images verbales consécutives il y a un intervalle que toutes les représentations concrètes n’arriveraient pas à combler34. »
Nous pouvons écouter une phrase extérieure pour autant que nous ressentons en nous le mouvement de sens qui l’accomplit. Chaque parole prononcée donne à entendre de façon immédiate – et dès lors inapparente – une certaine mélodie de l’âme. Mais de même qu’en réfléchissant sur l’âme, nous la pensons comme une succession d’états extérieurs les uns aux autres, comme une juxtaposition d’atomes psychiques indépendants, de même nous fixons notre attention sur les mots dont nous composons nos phrases, au lieu de nous y « extasier », c’est-à-dire par la mémoire et l’attente, la protention et la rétention35. La phrase n’est pas une simple juxtaposition ordonnée de mots régis par des rapports syntaxiques36. Le modèle qui permet de penser la formation de la phrase dans la durée est celui de l’élan de volonté37.
Bergson ne nous a pas seulement montré que la conscience réfléchie est incapable de saisir l’élan intérieur (et de penser par là la vraie liberté de l’esprit). Il lui arrive aussi de nous mettre en garde contre les excès de la pensée réflexive : l’intelligence est susceptible de déprimer le vouloir et de ralentir son élan. Il en va tout autrement quand l’élan du vouloir se relâche lui-même : le relâchement implique cette fois une compression ; action et passion à la fois – au cœur du mouvement extrême, le repos. Justement, dans le rêve, la détente ne signifie pas une interruption de l’activité. Et que se passe-t-il alors quand la conscience se fixe sur un mot, non pas pour le réfléchir, mais pour le rêver ? « Chacun de nous a pu remarquer le caractère étrange que prend parfois un mot familier quand on arrête sur lui son attention. Le mot apparaît alors comme nouveau, et il l’est en effet ; jamais, jusque-là, notre conscience n’en avait fait un point d’arrêt ; elle le traversait pour arriver à la fin d’une phrase. Il ne nous est pas aussi facile de comprimer l’élan de notre vie psychologique tout entière que celui de notre parole ; mais, là où l’élan général faiblit, la situation traversée doit paraître aussi bizarre que le son d’un mot qui s’immobilise au cours du mouvement de la phrase. Elle ne fait plus corps avec la vie réelle. Cherchant, parmi nos expériences passées, celle qui lui ressemble le plus, c’est au rêve que nous la comparerons38. » Qu’est donc le mot qu’on entend pour la première fois sinon le rêve du poète ? « Je dis une fleur et surgit l’absente de tout bouquet ». Loin d’abolir la réalité, un tel rêve laisse agir la vie intérieure. Le mot sur lequel le poète fixe son attention n’immobilise pas le mouvement de la phrase intérieure : l’immobilité du mot est rythme. C’est cet arrêt qui lui donne son caractère mélodique.
Qu’un poète nous fasse oublier les mots en tant qu’outils d’information ou de communication, il ne prétend pas moins révéler à son lecteur-interprète la chair du langage vivant. N’est-ce pas pour retrouver derrière cette langue extérieure la phrase intérieure que le poète se permet de subvertir la syntaxe de sa langue ? Il s’agirait de faire entendre d’autres rapports que ceux qui ont été fixés par les grammairiens. Mallarmé a cherché à dépasser les relations logico-grammaticales qui structurent la langue familière sans toutefois abandonner la syntaxe du français. La recherche d’une langue primitive dans le français vise à susciter une vision intérieure, à révéler la vérité native des choses, à co-naître leur éclosion.
Or si les langues peuvent « déchoir » c’est du fait de leur raffinement technique et de leur réduction à un outil de communication : la parole n’y est pas le champ d’une expérience intérieure, mais une simple recollection d’images verbales fixes, rattachées à des mots-étiquettes déposés à la surface des choses et publiquement reconnues. Quand une langue est trop raffinée syntaxiquement, c’est-à-dire quand elle permet de formuler par certains mots des rapports précis, l’activité de l’esprit est trop détendue : celui-ci s’en remet paresseusement aux panneaux indicateurs39. Plus une langue est « primitive40 », plus l’esprit est porté à compenser activement l’absence des rapports représentables dans le discours. Une langue trop syntaxique est une langue qui pense à notre place. Elle nous dispense de l’intuition et nous laisse à la surface de nous-mêmes et des choses ; nous devenons sourds à la phrase intérieure ; les nuances intimes de la réalité s’estompent. Ce qu’elle gagne en exactitude, la langue le perd en suggestion. Dans les langues caractérisées par la rection syntaxique, les mots sont régis par une structure extérieure où chaque élément atomique, chaque mot, est dans un rapport hiérarchique par rapport aux autres : le verbe régit le nom qui régit le déterminant et l’adjectif. Dans les langues caractérisées par l’apposition parataxique, la signification n’est pas déterminée par la structure logico-grammaticale : les mises en rapport ne sont pas faites dans la phrase extérieure mais elles sont inférées par l’esprit, suggérées à lui, sous-entendues par lui : des glissements de sens deviennent possibles. À mesure qu’une langue est syntaxique, elle perd en intériorité. Une telle langue convient davantage aux discours de l’extériorité, juridique et journalistique, mais non pas aux suggestions de la phrase poétique. Langue-reportage d’un côté, langue musicale de l’autre. À l’inverse, une langue parataxique suscite la pensée intuitive et résonne avec la réalité de l’intérieur.
Faire en sorte que la langue extérieure que nous parlons soit pénétrée par une autre, qui en décompose les rapports et en simplifie la structure, tel doit être au fond l’objectif d’une philosophie qui veut laisser une large place à l’intuition et restituer la phrase intérieure, sans renoncer toutefois à mettre à son service l’obstacle que constitue sur son chemin l’ordre grammatical des mots.
La phrase intérieure n’est donc pas nécessairement incommensurable avec son expression. Tant du moins que celle-ci vise, non pas à nommer des états de choses à l’intérieur de soi ou dans le monde extérieur, mais à laisser entendre beaucoup plus que ce qu’elle ne peut exprimer, que ce qu’il est possible de dire41. Il y a toujours dans une parole plus que ce qu’il ne le semble : « raffinée ou grossière, une langue sous- entend beaucoup plus de choses qu’elle n’en peut exprimer. » Ce surplus est le propre de l’esprit capable de tirer de soi plus que ce qu’il y a, en puisant dans cette parole des origines dont Rousseau nous a appris qu’elle était chant. La parole, dans la plénitude de son dépouillement, cesse de procéder à l’étiquetages des choses et à leur désignation dans l’espace pour se donner comme mélodie, rythme, incantation de ce qui dure. L’âme est renouée.
Chapitre extrait du collectif L’homme intérieur et son discours. Le dialogue de l’âme avec elle-même, sous la direction de J.-J. Alrivie, Paris, Vrin, Le Cercle Herméneutique, 2018
NOTES
1 Les espèces de vivants qu’il faudra penser comme autant de piétinements sur place de l’évolution. La vie n’est jamais une somme d’arrêts mais une création continue. Entre elle et les vivants, c’est-à-dire entre l’intérieur et l’extérieur, la différence est de type ontologique.
2 L’Évolution créatrice, p. 664/ 200 (pour les ouvrages de Bergson, nous indiquons à chaque fois la pagination de l’Édition du Centenaire, Paris, Puf, 1959 suivie de celle des éditions de 1939-1941.) Deleuze écrit : « Le temps n’est pas l’intérieur en nous, c’est juste le contraire, l’intériorité dans laquelle nous sommes, nous nous mouvons, vivons et changeons. » (L’image-temps. Cinéma 2, Paris, Les éditions de Minuit, 1985, p. 110).
3 Comme le lui reproche Heidegger (GA 21, Francfort, Vittorio Klosterman, 1976, p. 249-251, nous traduisons) : « Il semblerait que de nouvelles perspectives aient été gagnées quand Bergson a voulu surmonter le concept de temps transmis depuis lors pour s’avancer vers un concept plus originaire. À y regarder de plus près, il retombe droit dans le concept de temps qu’il a cherché à surmonter bien qu’il ait été guidé par un bon instinct. Ce qui compte pour lui est de dégager la différence entre temps et durée. Mais, la durée n’est pour lui rien d’autre que le temps vécu, et ce temps vécu en revanche est seulement le temps objectif ou le temps du monde pour autant qu’est considérée la manière dont il se manifeste dans la conscience. Que Bergson n’avance pas vers une compréhension conceptuelle et catégoriale du temps originaire, cela se voit en ce qu’il saisit le temps vécu, c’est-à-dire la durée, comme « succession », seulement cette succession du temps vécu n’est pas la succession quantitative, disséminée en maintenant ponctuels et juxtaposés, mais est une succession qualitative dans laquelle les différents moments du temps, passé, présent, avenir, s’interpénètrent. Cependant, il arrive déjà là à ses limites, car il ne dit ni ce qu’est la quantité, ni ce qu’est la qualité, ni ne donne aucune exposition fondamentale de ces deux fils conducteurs qu’il pose simplement et décrit le temps qualitatif, la durée, uniquement par des images ; il n’est question d’aucune élaboration conceptuelle plus approfondie. Donc l’essentiel est que Bergson essaie alors vraiment, avec le phénomène de la durée, de s’approcher du temps propre, et qu’à nouveau il saisit cette durée dans le même sens, comme succession. C’est seulement parce que nous n’avons pas compris aujourd’hui le sens propre du temps du monde, que nous sommes portés à croire que Bergson a compris le temps plus originairement. Dans ses écrits ultérieurs, Bergson n’a pas modifié l’exposition qu’il a donnée du temps dans son premier ouvrage, auquel il s’en est tenu jusqu’au jour d’aujourd’hui. Mais ce qu’il y a d’essentiel et de durable dans son travail philosophique ne repose pas dans cette direction. Ce qu’on lui doit de précieux est consigné dans son ouvrage Matière et mémoire, qui est fondamental pour la biologie et dont on ne viendra pas à bout d’ici longtemps. »
4 Les trois figures géométriques que Bergson propose tour à tour au troisième chapitre de Matière et Mémoire, celle du segment AD qui part du souvenir pur et finit dans la perception pure en passant par le souvenir image, et que l’associationniste coupe au milieu (Matière et Mémoire, p. 276/ 147) ; celle des deux lignes perpendiculaires AB (ligne objective des choses aperçues et inaperçues dans l’espace pour exprimer la coexistence de toutes les images du monde matériel non actuellement aperçues d’une part, et pour exprimer en même temps la contemporanéité de cette ligne avec tous les états psychologiques qui coexistent avec le présent de la conscience d’autre part), et CI (ligne subjective sur laquelle s’échelonnent les souvenirs) (Ibid, p. 285/ 159) ; et enfin la célèbre image du cône renversé SAB dont le sommet S qui s’insère sur un plan P représente le présent, c’est-à-dire la conscience de mon corps au centre de l’univers matériel, et la base AB le passé immobile, presque spatialisé, dans lequel les souvenirs s’accumulent par additions successives(Ibid, p. 293/ 169). Cette immobilité du passé et la mobilité du présent ne se laisse pourtant pas ramener à l’opposition du statique et du dynamique, car c’est l’ensemble du cône qui est dynamique.
5 La Pensée et le Mouvant, p. 1276/ 31.
6 Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 86/96.
7 Ibid., p. 87/98.
8 Ibid.
9 Ibid., p. 91/103.
10 Ibid., p. 86/96.
11 Comme l’a fait remarquer Deleuze, la durée ne peut plus définir l’indivisible pur parce qu’elle ne cesse de se diviser, chaque degré de la division correspondant à une différence de nature ; de même elle n’est plus simplement non-mesurable, puisqu’elle se laisse mesurer en différant continûment son principe métrique.
12 Ibid.
13 L’Évolution créatrice, p. 630-631/161 : « Originellement elle [l’intelligence] est adaptée à la forme de la matière brute. Le langage même, qui lui a permis d’étendre son champ d’opérations, est fait pour désigner des choses et rien que des choses : c’est seulement parce que le mot est mobile, parce qu’il chemine d’une chose à une autre, que l’intelligence devrait tôt ou tard le prendre en chemin, alors qu’il n’était posé sur rien, pour l’appliquer à un objet qui n’est pas une chose et qui dissimulé jusque là, attendait le secours du mot pour passer de l’aube à la lumière. Mais le mot, en couvrant cet objet, le convertit encore en chose. »
14 Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 91/103.
15 Matière et Mémoire, p. 322/ 204.
16 L’Évolution créatrice, p. 628/ 170.
17 Ibid., p. 759/ 312.
18 Ibid. : « nous ne dirions pas ‘‘l’enfant devient homme’’, mais ‘‘il y a devenir de l’enfant à l’homme’’. »
19 « En ce point est quelque chose de simple, d’infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n’a jamais réussi à le dire. Et c’est pourquoi il a parlé toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu’il avait dans l’esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction – ainsi, de théorie en théorie, se rectifiant alors qu’il croyait se compléter, il n’a fait autre chose, par une complication qui appelait la complication et par des développements juxtaposés à des développements, que de rendre avec une approximation croissante la simplicité de son intuition originelle. Toute la complexité de sa doctrine, qui irait à l’infini, n’est donc que l’incommensurabilité entre son intuition simple et les moyens dont il disposait pour l’exprimer. » (La Pensée et le Mouvant, p. 1347 /119).
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Essai sur les données immédiates, p. 88/ 99.
23 Ibid., p. 89/ 100.
24 On pourrait voir en Bergson un penseur d’une même phrase plutôt que celui d’un mot unique.
25 L’Énergie spirituelle, p. 849-850/ 46.
26 La Pensée et le Mouvant, p. 1327/ 95, 1n : « il peut nous donner la communication directe avec la pensée de l’écrivain avant que l’étude des mots soit venue y mettre la couleur et la nuance ». Dans la même page : « nous avions essayé de montrer comment des allées et venues de la pensée, chacune de direction déterminée, passent de l’esprit de Descartes au nôtre, par le seul effet du rythme tel que la ponctuation l’indique, tel surtout que le marque une lecture correcte à haute voix. »
27 Ibid., p. 1358/ 133 : « La vérité est qu’au-dessus du mot et au-dessus de la phrase il y a quelque chose de beaucoup plus simple qu’une phrase et même qu’un mot : le sens, qui est moins une chose pensée qu’un mouvement de pensée, moins un mouvement qu’une direction. » Le sens semble ici recueillir dans sa simplicité aussi bien la direction qu’un mot indique que le mouvement de pensée qu’une phrase compose.
28 Ibid., p. 1459-1460 / 264-265 : « L’art vrai vise à rendre l’individualité du modèle, et pour cela il va chercher derrière les lignes qu’on voit le mouvement que l’œil ne voit pas, derrière le mouvement lui- même quelque chose de plus secret encore, l’intention originelle, l’aspiration fondamentale de la personne, pensée simple qui équivaut à la richesse indéfinie des formes et des couleurs. »
29 Ibid., p. 1327/ 95. Bergson ne retrouve-t-il pas ainsi l’unité parménidienne du noiein et du legein ?
30 Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 3/ VII (Avant-propos)
31 L’Energie Spirituelle, p. 56-57/858.
32 La Pensée et le Mouvant, p. 1285/ 42.
33 Matière et Mémoire, p. 269 /132.
34 Ibid.
35 « La vision que la conscience réfléchie nous donne de notre vie intérieu« La vision que la conscience réfléchie nous donne de notre vie intérieure est sans doute celle d’un état succédant à un état, chacun de ces états commençant en un point, finissant en un autre, et se suffisant provisoirement à lui-même. Ainsi le veut la réflexion, qui prépare les voies au langage; elle distingue, écarte et juxtapose ; elle n’est à son aise que dans le défini et aussi dans l’immobile ; elle s’arrête à une conception statique de la réalité. Mais la conscience immédiate saisit tout autre chose. Immanente à la vie intérieure, elle la sent plutôt qu’elle ne la voit ; mais elle la sent comme un mouvement, comme un empiétement continu sur un avenir qui recule sans cesse. Ce sentiment devient d’ailleurs très clair quand il s’agit d’un acte déterminé à accomplir. Le terme de l’opération nous apparaît aussitôt. » (L’Énergie spirituelle, p. 926/ 156-157).
36 Nous retrouvons cette même tendance dialectique dont Zénon fut le premier représentant, et qui a donné son coup d’envoi à la métaphysique inconsciente et naturelle, dont Bergson dit par ailleurs qu’elle se caractérise par une confiance naïve dans le langage : « la tendance constante de l’intelligence discursive à découper tout progrès en phases et à solidifier ensuite ces phases en choses » (Matière et Mémoire, p. 269/ 133). Autrement dit, la tendance constante de l’intelligence discursive à découper tout mouvement de la pensée en phrases et à solidifier ensuite ces phrases en mots.
37 « pendant tout le temps que nous agissons, nous avons moins conscience de nos états successifs que d’un écart décroissant entre la position actuelle et le terme dont nous nous rapprochons (…) De même, quand nous écoutons une phrase, il s’en faut que nous fassions attention aux mots pris isolément : c’est le sens du tout qui nous importe ; dès le début nous reconstruisons ce sens hypothétiquement ; nous lançons notre esprit dans une certaine direction générale, quitte à infléchir diversement cette direction au fur et à mesure que la phrase, en se déroulant, pousse notre attention dans un sens ou dans un autre. Ici encore le présent est aperçu dans l’avenir sur lequel il empiète, plutôt qu’il n’est saisi en lui-même. » (L’Énergie spirituelle, p. 926/ 156-157).
38 Ibid.
39 « Alléguerez-vous que ce sont là des raffinements d’une langue déjà très perfectionnée, et qu’un langage est possible avec des noms concrets destinés à faire surgir des images de choses ? Je l’accorde sans peine ; mais plus la langue que vous me parlerez sera primitive et dépourvue de termes exprimant des rapports, plus vous devrez faire de place à l’activité de mon esprit, puisque vous le forcez à rétablir les rapports que vous n’exprimez pas : c’est dire que vous abandonnerez de plus en plus l’hypothèse d’après laquelle chaque image irait décrocher son idée. » (Matière et Mémoire, p. 269 /132).
40 Nous pouvons, en les traduisant dans nos langues, ressentir la beauté poétique de langues autrement ordonnées que les nôtres et étrangères au groupe de langues indo-européennes. Leur traduction a pour effet de renouveler l’entente de notre propre langue qui retrouve grâce à elles une jeunesse syntaxique. Elle rend notre phrase intérieure moins habituelle, moins familière, plus étrange. Combien de paroles poétiques se sont-elles formées en faisant jouer des langues étrangères ou même des langues anciennes à l’intérieur d’une langue ? Combien de pensées philosophiques ?
41 Ibid, p. 269/ 133. D’une certaine façon, il devient possible de dire et d’écrire ce dont on ne peut pas parler. Si le langage est à l’origine destiné à faciliter le commerce quotidien dans la société, l’efficacité de la communication ne tient pas à la qualité de son usage. Une information peut très bien passer malgré de très mauvaises conditions linguistiques (pauvreté du lexique, syntaxe erronée). Il suffit au gré des contextes d’ajuster son entente et remplir les blancs du non-dit. Il n’est pas rare par exemple que le respect de la littéralité stricte soit dans les conversations (qui travaillent à la conservation des significations publiques qu’on s’échange sans penser) le motif des malentendus les plus cocasses. Quoiqu’elle sacrifie l’illusion d’un sens objectif et unilatéral, la marge de suggestion entretient, malgré tout, les conditions de la compréhension intersubjective, mais aussi intrasubjective.

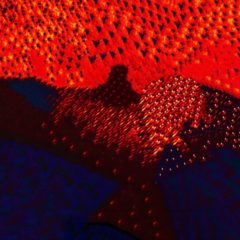













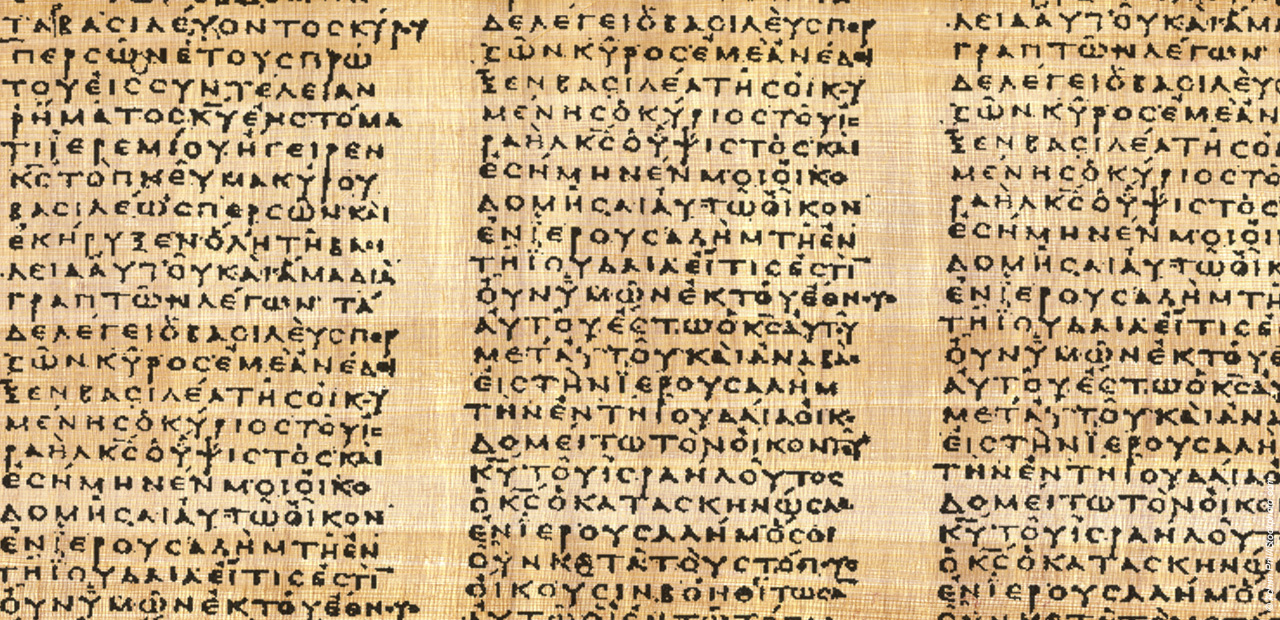





 Cet article est paru dans la revue
Cet article est paru dans la revue