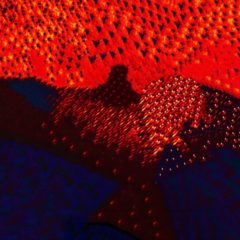« A Surate un Indien voyant ouvrir à la table d’un Anglais une bouteille d’ale et toute cette bière transformée en écume, jaillir de la bouteille, témoignait avec force exclamations de son grand étonnement ; à la question de l’Anglais : « qu’y a-t-il donc là de si étonnant ? » il répondit : « je ne m’étonne pas que cela jaillisse ainsi, mais que vous ayez pu l’y introduire. » »
Les philosophes manquent-ils d’humour ? En nous rapportant cette plaisanterie, Kant ne cherche certes pas à nous faire rire. Et s’il ne s’agit pas plus de savoir si je peux élever mon rire d’autrui en maxime universelle, c’est parce que le problème qu’il se pose dans la Critique de la faculté de juger n’est pas celui de la moralité de la société des rieurs, problème qui sera celui de Bergson. La question ici est : l’art de la plaisanterie et l’art musical font-il partie de la catégorie des beaux-arts ? Quelle place donner à l’auteur comique et au musicien, parmi les peintres, les sculpteurs, etc. ? Pour déterminer le statut de l’humoriste dans la communauté des artistes, Kant va passer par une description phénoménologique de l’éclat de rire dont le résultat ne nous étonnera pas : le rire, tout comme la musique d’ailleurs, n’est que le produit d’un art agréable dont la seule finalité repose sur le bien-être corporel. Le plaisir pris à rire n’aurait rien d’un pur plaisir esthétique. Musique et plaisanterie sont donc exclus des beaux-arts. On se souviendra que ce qui s’appelle « plaisir esthétique pur » implique, plutôt qu’une expérience corporelle, un jeu des facultés de l’esprit qui conduit le corps-spectateur à s’incliner devant un bel objet ou, comme il peut arriver dans le sublime, à s’écraser sous le poids infini de ce qui dépasse tout objet possible. Attitudes gestuelles du corps, l’inclination et l’écrasement n’en demeurent pas moins suggérés par l’entendement et la raison. Dans l’expérience du rire, ce plaisir impur, l’entendement ne s’implique dans aucun libre jeu des facultés : c’est au contraire par son relâchement soudain, par sa détente brutale, qu’il va provoquer une oscillation physique, un jeu des organes corporels qui va jusqu’à faire trembler les entrailles. « Ce n’est pas que nous nous jugions plus intelligents que cet ignorant, ou que notre entendement ait trouvé quelque agrément en cette histoire, mais nous étions dans l’attente et celle-ci s’évanouit soudain. »
Il s’agit pour Kant de déterminer les conditions de possibilités du rire du sujet. Pour en revenir à l’exemple de l’Indien, les raisons que nous sommes supposés avoir pour en rire, ne doivent ni suivre d’un jugement réfléchissant (autrement le plaisir serait pur) ni même tenir à un quelconque caractère comique objectif (autrement il n’y aurait plus de plaisir du tout). Lorsque Descartes retient la « surprise de l’admiration » (Les passions de l’âme, article 178) comme ce qui cause l’éclat de rire devant un objet risible, la surprise est comprise sur le mode de la réaction passionnelle devant l’irruption de quelque chose d’inattendu. Si en revanche la plaisanterie fait rire, ce n’est pas selon Kant, en représentant des objets dont on pourrait se moquer à cause de leur effet surprenant. La plaisanterie n’est pas l’art de présenter des objets saugrenus, mais celui de générer une attente à travers un récit et sa chute. Plutôt que dans le surgissement de quelque chose de déterminé (je vois quelque chose que je n’attendais pas), la surprise consiste ici en l’anéantissement d’une attente indéterminée et savamment entretenue (j’attends quelque chose qui ne survient pas.) En d’autres termes, ce n’est pas à proprement parler un étant surprenant qui nous fait rire : l’indien par exemple, ni un quelconque prédicat que notre mépris civilisé lui affuble : sa différence culturelle, sa bêtise, son ignorance. C’est bien un effet de ce que notre entendement se désengage de la situation, lorsqu’il voit qu’il n’y a rien à attendre de l’illusion comique (« il ne découvre pas ce qu’il attend ») : il est mis en demeure de ne rien statuer et n’a rien à juger, bref : la synthèse avec l’intuition temporelle est rompue soudainement. D’où la célèbre formule : « Le rire est une affection résultant de l’anéantissement soudain d’une attente extrême. » Critique de la faculté de juger, p. 238.
Sous un tel point de vue, le comique ne représente qu’une illusion inoffensive pour l’entendement mais revêt en contrecoup un caractère hygiénique pour le corps : il est source de détente, accorde bien-être et renforce la santé. Kant et Descartes s’accordent ensemble pour définir le rire par l’affectivité : c’est un affect de joie ou de plaisir. Cette joie ou ce plaisir ont ceci de particulier que c’est une joie éprouvée devant le mal ou un plaisir pris en l’erreur : si le rire railleur est analysé comme une impression de surprise composée d’une joie médiocre, c’est-à-dire une joie prise à un petit mal, le rire provoqué par la plaisanterie apparaît lui, comme le résultat d’une erreur insignifiante – joie immorale et plaisir errant : « Cela nous fait plaisir, parce que nous nous amusons un temps de notre propre méprise en une chose qui nous est par ailleurs indifférente . » Or, l’indifférence, dira Bergson, est précisément l’élément du rire, mais c’est elle du coup qui nous interdit de le considérer comme une affection :
« Signalons maintenant, comme un symptôme non moins digne de remarque, l’insensibilité qui accompagne d’ordinaire le rire. Il semble que le comique ne puisse produire son ébranlement qu’à la condition de tomber sur une surface d’âme bien calme, bien unie. L’indifférence est son milieu naturel. Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion. Je ne veux pas dire que nous ne puissions rire d’une personne qui nous inspire de la pitié, par exemple, ou même de l’affection : seulement alors, pour quelques instants, il faudra oublier cette affection, faire taire cette pitié. »
Car une âme sensible, en tant que telle, ne rit pas ; elle est plutôt inclinée à compatir et à pleurer pour les autres plutôt qu’à rire d’eux :
« Dans une société de pures intelligences on ne pleurerait probablement plus, mais on rirait peut-être encore ; tandis que des âmes invariablement sensibles, accordées à l’unisson de la vie, où tout événement se prolongerait en résonance sentimentale, ne connaîtraient ni ne comprendraient le rire. »
Toutefois il faut souligner qu’un mal, une difformité, une douleur, une chute ne deviennent risibles aux yeux de nos philosophes qu’à la condition qu’ils ne soient pas trop importants et qu’ils entraînent des conséquences relativement négligeables sur la victime comique d’une part et pour le rieur de l’autre. Rire et rire d’autrui, cela doit rester quelque chose de léger : c’est le fait d’avoir cru que la perruque du marchand pouvait devenir grise sous l’effet du chagrin qui a fait rire Kant ; c’est une difformité légère et non une grave maladie qui a fait rire Descartes. Mais le rire sadique ne connaît pas de limites . Qu’est-ce qui empêche notre capacité à rire de repousser indéfiniment les limites de notre sympathie jusqu’à mettre entre parenthèses l’ensemble de notre vie affective ? « Le comique exige donc enfin, pour produire tout son effet, quelque chose comme une anesthésie momentanée du cœur . » Il faut remarquer que cette insensibilité accompagne le rire, plutôt qu’elle ne le cause. Cette mise entre parenthèses du sentir symptomatique du rire, justifie son exclusion du domaine purement esthétique : « le rire ne relève donc pas de l’esthétique pure ». L’impureté esthétique du rire n’est pas comprise comme résultant de la participation du corps, mais à partir de la thèse originale du rire comme le produit d’une anesthésie codifiée socialement : le rire sert de châtiment que la société exerce sur un individu, châtiment social qui ne s’empêche pas d’emprunter des voies peu morales. On y découvre un fond d’amertume dont le rire est l’effet de surface, renfermant tous les degrés possibles de la malice et de la méchanceté . En se demandant pourquoi le nègre nous fait rire, Bergson cite l’anecdote d’un cocher qui y voit un visage mal lavé : un noir ressemblerait à un blanc déguisé, sali . En tant que tel, le rire appartient à la tendance « clôturante » de la société, qui veut neutraliser les différences. Puissance antipathique et anesthésique, le rire est l’effet d’une inquiétude sociale devant quelque chose qui reste inoffensif : il y préside un sentiment d’agression virtuelle mais non matérielle qui fait que la réponse de la société se veut ajustée au dommage subi : « Elle est en présence de quelque chose qui l’inquiète, mais à titre de symptôme seulement, – à peine une menace, tout au plus un geste. C’est donc par un simple geste qu’elle y répondra . » Le symptôme est traité aussitôt dans une perspective de normalisation et même pourrait-on dire, de naturalisation. Car dans le comique, la nature se fait art : la noirceur d’un visage paraît « plaquée artificiellement » sur lui. C’est ce qui fait que le rire « a quelque chose d’esthétique cependant » et qui explique comment le comique va pouvoir se glisser dans l’écart de la vie et de l’art pour produire sa « force d’expansion. » Outre de servir au but pratique de la société d’adapter un individu singulier (et de l’adapter aux exigences générales de l’adaptation : la souplesse) la naissance du comique correspond « au moment précis » où la société et la personne « commencent à se traiter comme des œuvres d’art. » Riant d’elle-même, la vie se met en scène et jouit de sa propre représentation. Faire rire pour corriger les défauts, tout l’art de Molière consiste en une articulation de cette double perspective morale et esthétique, c’est-à-dire qu’il se place dans l’écart de la vie et de l’art.
S’il est vrai que la musique adoucit les mœurs, c’est en poussant à l’extrême la sensibilisation de l’auditeur ; et si le comique châtie les mœurs, c’est en l’anesthésiant. « Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion . » L’analogie kantienne entre comique et musique n’est plus valable chez Bergson, lequel ne les sépare pas tous deux d’une forme d’éthique, c’est-à-dire d’une pratique de vie. Seulement, on peut dire que la musique viserait plutôt une morale ouverte et spirituelle alors que le comique correspondrait aux aspirations matérialistes d’une société close.
Le rapport entre morale ouverte et esthétique apparaît justement dans ces descriptions de l’émotion musicale où pleurer s’interprète comme l’expérience d’un devoir singulier, celui de ressentir l’émotion suggérée par une musique : « C’est ce qui arrive dans l’émotion musicale, par exemple. Il nous semble, pendant que nous écoutons, que nous ne pourrions pas vouloir autre chose que ce que la musique nous suggère . » Mais si elle impose quelque chose, elle « n’imposera que du consenti ». La musique me crée une obligation de pleurer avec elle, parce que « quand la musique pleure, c’est l’humanité, c’est la nature entière qui pleure avec elle . »
Aussi, Bergson aurait écrit son « esthétique » dans son livre sur la morale et la religion. La question de savoir pourquoi ce ne serait pas au Rire de tenir lieu de l’esthétique bergsonienne, trouve sa réponse dans le fait que « le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion . » Le rire n’est pas un affect, c’est la pure expression de l’absence de toute émotion puisqu’il a lieu à l’occasion d’une anesthésie du cœur, qui explique que seul un être intelligent peut rire : « dans une société d’intelligences pures on ne pleurerait probablement plus, on continuerait à rire . » Or, que serait une telle société, sinon close – comme le montre l’anecdote colonialiste rapportée par Kant qui souligne l’appartenance de la fantaisie comique « à l’originalité de l’esprit. Il va même jusqu’à apprécier la figure de l’humoriste, comme en une analogie avec sa propre position criticiste, avec la digue qu’il oppose au dogmatisme, à l’empirisme et à l’enthousiamse du génie (la Schwärmerei : l’essaim d’abeilles autour de la tête du génie). L’œuvre de l’humoriste, nous est-il indiqué en passant, demande certaines qualités qui font gravement défaut aux œuvres casse-tête (kopfbrechend), casse-cou (halsbrechend) et crève-cœur (herzbrechend), contredisant ainsi la tortuosité mystique, l’audace géniale et l’affliction sentimentale des « romanciers moralistes ». Et si ces œuvres ne sont pas comiques en droit, elles peuvent très facilement le devenir en fait, à l’insu de leurs auteurs qui restent ainsi guettés par le ridicule – un ridicule dont le comique se préserve d’emblée. Mais il faut remarquer aussi que l’inverse peut être vrai : on ne rit pas toujours devant quelque chose qui serait comique en droit. Un clown qui cherche à faire rire en déployant de grands moyens sans même provoquer un sourcillement.
C’est précisément dans cet écart entre le comique de fait et le comique de droit que se pose pour Bergson le problème de la méthode à employer pour questionner le rire : « Une des raisons qui ont dû susciter bien des théories erronées ou insuffisantes du rire, c’est que beaucoup de choses sont comiques en droit sans l’être en fait . » L’attention au fait comique signale au contraire son irréductibilité à toute formule générale qui voudrait rendre raison du rire : « On expliquera le rire par la surprise, par le contraste, etc., définitions qui s’appliqueraient aussi bien à une foule de cas où nous n’avons aucune envie de rire . » Il ne suffit donc pas d’établir les conditions de possibilités de l’événement du rire car toutes les conditions peuvent être réunies pour que le rire advienne et pourtant il ne viendra pas. A l’inverse toutes les conditions peuvent être absentes et c’est alors qu’il peut exploser le plus fort. Si aucune condition ne peut a priori déclencher ou arrêter le rire, c’est parce qu’à l’occasion, soit on rit, soit on ne rit pas. Il n’y a jamais plus de raisons pour rire que pour ne pas rire, parce qu’il y a seulement des occasions pour cela. Dans l’occasion, les conditions ne se présentent jamais comme étant plus larges que le conditionné. En elles, sont réunies les conditions de possibilité d’une expérience réelle dans son imprévisibilité matérielle et non pas celles de toute expérience possible dans sa généralité formelle. La question que le fait comique nous suggère de poser n’est donc pas : quelles sont les conditions du rire du rieur ? Mais : à quelle occasion le rire éclate-t-il ? L’occasion c’est ce qui vient ou ne vient pas, et qui, lorsqu’elle vient, demande à être saisie sur le champ : c’est non sans raison qu’elle est mythologiquement représentée comme cette divinité chauve qu’il faut attraper par les cheveux lorsqu’elle passe.
A la faveur d’un lieu et d’un temps pour quelque chose, l’occasion de rire survient consécutivement à l’accident dont la forme la plus prosaïque est figurée par la chute. Occasionem vient de occasum, occidere, composé de ob et de cadere qui donne choir, ce qui échoit… Le cas échéant : ce qui est advenu ou aura advenu. Oc est le préfixe qui vient par assimilation de ob : l’en-face. Il indique aussi le renversement. Littéralement, le grec parlerait ici de katastrophé. Occasion et occident sont étymologiquement identiques : Moins que le pays du couchant tranquille, Occidere dit le lieu de la catastrophe la plus grande, la plus désastreuse qui soit : la chute d’un astre. Mais l’occident en est venu aussi à jouer le rôle de « l’ »Histoire comme succession d’événements et de bouleversements. C’est à l’occasion que se décide la conjoncture des temps et lieux pour chaque chose. Mais dans cette « vallée de larmes » où pour Hegel l’esprit tombe pour endurer les douleurs et les pleurs de son propre enfantement, où trouver l’occasion pour rire ? La tragédie semble si ininterrompue que cette occasion semble à chaque fois contredite par les conditions réelles.
Dans le roman très nietzschéen de Kazantzakis, Zorba le Grec, un téléphérique est réalisé pour acheminer jusqu’au port les troncs de pins de la forêt. Mais l’inauguration de ce dispositif technique se conclut par une catastrophe générale : tous les piliers tombent à la chaîne. Rien ne prédispose alors le héros et le narrateur à éclater de rire et à danser gaiement sur la plage crétoise. On sait combien l’échec de la technique humaine, son impuissance face à la nécessité, a nourri l’esprit de la tragédie antique. Cette fois-ci c’est bien le comique qui trouve de façon inexplicable et totalement imprévisible, l’occasion d’exploser. Bergson pourrait dire ici que le rire et la danse ont fini par sanctionner la rigidité de la mécanique et voir dans ces réactions vivantes et affirmatives une réponse intelligente à la catastrophe survenue : comme si, résolue à son inadaptation foncière à toute machine, c’est-à-dire aux moyens techniques pour rationaliser le monde, l’intelligence possédait avec le rire une conscience et un aveu de ses propres limites. Bien que le comique « s’adresse à l’intelligence pure » il n’en constitue dès lors pas moins le signe d’une réaction vivante contre les excès de l’intelligence. Si ce que le rire met en cause dans son éclatement, ce n’est ni la laideur ni l’erreur, mais la raideur , si ce qui est drôle, c’est l’absence de grâce qui menace la vie dans ses mouvement, c’est bien que celle-ci se venge de sa propre (auto)réduction en mécanisme – et pour cela, elle monte tout un mécanisme. Le rire apparaît dès lors comme une réaction mécanique contre le mécanisme.
La considération du comique à travers le double point de vue de sa fabrication et de ce qu’on pourrait appeler son « évolution créatrice », renvoyant à la méthode même du bergsonisme. Il n’y a aucune contradiction à dire que le rire n’a lieu que pour un étant intelligent, et qu’il constitue en même temps une réaction de la vie à l’égard des raideurs qui viennent des excès de cette même intelligence. La méthode même de détermination du comique tient compte de ce paradoxe structurel : il faut à la fois traiter la fantaisie comique comme un être vivant qui se métamorphose, croît, s’épanouit , et mettre au jour les procédés techniques de sa fabrication. En effet, on peut lire dans la préface : « Mais notre méthode, qui consiste à déterminer les procédés de fabrication du comique, tranche sur celle qui est généralement suivie, et qui vise à enfermer les effets comiques dans une formule très large et très simple. »
Qu’est-ce qui pourrait donner au philosophe l’occasion pour rire ? Et pour rire, ne doit-il pas d’abord commencer par rire de soi ? C’est la leçon qu’on peut tirer d’un joke philosophique rapportée par Platon à propos de Thalès qui échoue au fond du puits, provoquant le rire d’une servante de passage. Après avoir rappelé à ses étudiants cette fameuse anecdote, Heidegger poursuit :
« La philosophie est cette pensée avec laquelle on ne peut essentiellement rien entreprendre et à propos de laquelle les servantes ne peuvent s’empêcher de rire. Cette définition de la philosophie n’est pas une simple plaisanterie : elle est à méditer. Nous ferons bien de nous souvenir à l’occasion qu’au cours de notre cheminement il peut nous arriver de tomber dans un puits sans pouvoir de longtemps en atteindre le fond. »
La question qui s’enquiert de l’étant : « qu’est-ce qu’une chose ? » fait rire le sens commun. Tout d’abord, il faut reconnaître que celui-ci n’a pas tout à fait tort de rire et prendre son rire avec humour. Si le philosophe est celui qui fait rire le non-philosophe, il peut aussi rire au souvenir de la servante espiègle : « Et ne faut-il pas qu’une brave servante ait l’occasion de rire ? » Ensuite, celui qui tombe dans le puits n’est pas sûr d’en toucher le fond – même si Thalès pourra toujours y trouver de l’eau, autrement dit, un étant fondamental pris comme principe du tout. Pour Heidegger, si le fond reste hors de portée, c’est parce que la raison fondatrice est elle-même sans fondement. On reconnaît ici ce que vise Heidegger : les visées fondationnelles, « fondamentalistes », de la métaphysique. « Que ce nom nous indique seulement cette démarche où l’on court grand risque de tomber dans le puits. » Le sans-fond dans lequel échoue la philosophie, provoquant les rires du bon sens commun, se rapporte au jeu abyssal de l’être. L’émotion fondamentale du philosopher y est accordée, tandis que le rire de l’autre de la philosophie, du non-philosophe, marque une insensibilité essentielle à l’égard des questionnements que ce jeu suscite. Le sens commun est insensible à l’abîme du »il y a », car il ne connaît que l’utile et ignore la dépense généreuse et gratuite.
« Il faut d’abord qu’une personne ait une connaissance de l’urgence de l’inutile, avant de pouvoir parler avec elle de l’utile. Certes, la terre est grande et vaste ; et pourtant, pour que l’être humain tienne debout, il ne lui faut pas plus de place que ce qui est nécessaire pour pouvoir poser son pied. Mais si juste à côté du pied s’ouvrait une crevasse plongeant jusqu’au monde souterrain des enfers, la place qu’il occupe pour tenir debout lui serait-elle encore d’une quelconque utilité ? »
Cette parabole peut constituer une réponse du philosophe au sens commun : je tombe dans un puits, toi dans une crevasse et tu ne cesses d’y chuter sans même être en mesure de le remarquer. Le penseur aurait une connaissance de cet abîme profond en y étant tonalement accordé. Quelle est cette tonalité affective qui rend possible d’acquérir une stature, de se lever et de se tenir debout malgré la dérobade du sol ? Et en termes bergsoniens : selon quelle émotion reconduire la marche en avant ? Au milieu de la dévastation du monde ces questions se fait pressantes. Sans doute en accueillent-elles déjà la fin.
« Le ton fondamental de la pensée propre à l’autre commencement trouve son rythme dans des tonalités qui ne se laissent qu’approximativement nommer avec les noms d’effroi, de retenue et de pudeur. »
Ces tonalités que retient Heidegger suggèrent une attitude de retardement, d’attente. Eclater de rire, voilà qui semble impossible dans cette attitude « essentiellement autre que toute manière de s’attendre à, qui est au fond incapacité d’attendre » : car ce n’est pas quelque chose qui est attendu. « En tant que nous sommes ceux qui attendent, nous sommes le là ouvert qui laisse venir le venir en s’engageant en lui . » S’il devait alors y avoir rire, ce ne serait plus là à cause de l’anéantissement d’une attente, à l’occasion d’une chute qui briserait l’attente de quelque chose, mais dans l’attente du néantir, de ce néant dont le Da-sein est dit être le lieu-tenant. Car rien ne peut venir rompre cette attente extrême, pas même la dévastation du monde qui est justement attendue : l’attente de ce qui sauve est attente du péril extrême.
Peut-être qu’alors dans l’attente d’un nouveau commencement, pourrait-on apprendre à rire d’un rire formé à l’école de l’enfance de l’être ? Un rire dont l’atmosphère ne serait pas l’indifférence, mais la joie et la sérénité.
Il est difficile de savoir si cette sérénité ou cette joie sont supportables ou si même elles sont possibles pour nous autres hommes qui se disent d’aujourd’hui. Mais si jamais un rire serein venait à éclater, ce serait non sans évoquer ceux qu’Epicure a qualifiés de bienheureux et dont le rire est dit « inextinguible » par Homère. Car c’est en définitive cela, le divin, dont le retrait appelle, aussi bien pour Bergson que pour Heidegger, la décision à venir pour l’ouverture ou la clôture du monde, sur la base d’un renouveau spirituel de l’humanité.