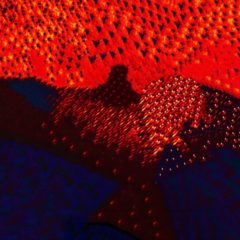Il ne serait pas exagéré de dire que l’arrivée de Heidegger en France a bouleversé le paysage intellectuel français. Outre la gerbe créatrice qui en a résulté, ce bouleversement eut pour effet une césure importante entre la première et la seconde moitié du vingtième siècle : le fil qui nous reliait aux « beaux jours de l’université française » a été brusquement rompu, laissant dans une certaine obscurité l’ampleur du legs qu’elle nous aura aussi destiné. Voilà qui devrait exiger un retour expresse sur la tradition dominant la scène française avant l’entrée du philosophe allemand : le bergsonisme.

[NOTE : L’ouvrage de D. Janicaud, Heidegger en France vise à présenter de manière exhaustive l’histoire de cette singulière réception de celui qui « conquit l’intelligentsia de l’ “ennemi héréditaire” », la France. Il insiste notamment sur cette mutation qui a transformé la manière de faire de la philosophie. C’est moins un style qu’une contenance de fond dont la provenance historique a été refoulée par la seconde guerre mondiale et dont « l’effet Heidegger » ne saurait être complètement détaché : « Onze ans seulement séparent Les Deux Sources de la morale et de la religion et L’Être et le Néant : que s’est-il produit entre 1932 et 1943 pour que la claire retenue de Bergson cède la place à la sombre et implacable rhétorique de Sartre? La guerre et la lecture de Heidegger. » Heidegger en France I. Récit, Idées, Albin Michel, 2001, p. 16.]
Il aura fallu attendre le Merleau-Ponty du Visible et l’invisible pour qu’un fil commence à se renouer. Cet ouvrage posthume accomplit un noyau de convergences par où le penseur de l’être et celui de la durée se rencontrent franchement.

[NOTE : le Merleau-Ponty de la Phénoménologie de la perception considère Bergson comme un phénoménologue manqué. Merleau-Ponty est ensuite conduit à remettre en question la critique qu’il menait, au nom du transcendantalisme husserlien, de Bergson, au profit de sa réception de Heidegger. Cette évolution n’a pas non plus échappé à ce dernier lorsqu’il écrit à Arendt que « Merleau-Ponty était en train de s’acheminer de Husserl à Heidegger » en remarquant incidemment que « les Français ont bien du mal à se remettre de leur cartésianisme inné ». Cf. Lettres et autres documents, 1925-1975 Hannah Arendt, Martin Heidegger, Gallimard, Paris, 2001, p. 220]
La possibilité de se frayer une voie pour une lecture croisée est alors ouverte. Mais un tel retour n’acquerra son sens que dans la mesure où il permet de remettre en état un dialogue à l’intérieur du même domaine de décisions, c’est-à-dire d’identifier les problèmes communs qui, à une certaine époque ont appelé à penser, et ceux qui requièrent aujourd’hui notre pensée, au lieu de traquer à la surface des textes les influences et les lectures supposées entre les auteurs. On pourrait par exemple reprendre certaines thèses heideggériennes et montrer ce qu’elles doivent à Bergson, en marquer l’évolution jusqu’à Sein und Zeit où Bergson est nommé pour être aussitôt révoqué. Aura-t-il été soumis comme le prétend Lévinas, à une « exécution sommaire » ? Mais on pourrait tout autant partir du jeune Heidegger qui cherchait à penser un temps qualitatif historique qui ne fût pas le temps quantitatif de la science de la nature, dans sa leçon d’habilitation du 27 juillet 1915, intitulée Le Concept de temps dans la science historique (Der Zeitbegriff in der Geschichtwissenschaft, in Frühe Schriften, GA 1, Klostermann, Frankfurt am Main, 1972 p. 355-375). Il importe bien plutôt de suivre leurs chemins disparates et tenter de les prolonger jusqu’à des carrefours furtifs. C’est en sauvegardant chaque penseur dans ce qu’il a de propre que les proximités pourront surgir, s’il est vrai que « chacun suit son propre chemin, mais dans la même forêt » (Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. W. Brokmeier, Gallimard, Tel, Paris, 1962 (noté NP), p. 7).
[NOTE : Par-delà la logique de l’identité et de l’unicité, le même n’exclut pas la différence et la multiplicité : « Les penseurs essentiels disent constamment le même. Ce qui ne veut pas dire l’identique » (Heidegger, Questions III et IV, trad. J. Beaufret, F. Fédier, J. Hervier, J. Lauxerois, R. Munier, A. Préau et C. Roëls, Gallimard, Tel, Paris, 1976 (noté Q III-IV), p. 126). Dans l’identité, toutes les différences s’effacent sous le morne habit de la généralité qui fixe les variations dans un concept unique, égal à soi (A = A) ; tandis que la « mêmeté » advient dans un mouvement d’auto-différenciation dynamique et de scission interne. Par conséquent, la différance en jeu ne saurait se réduire en une distinction thétique entre des termes extérieurs et opposés l’un à l’autre.]
Chaque philosophe se retrouve dans la situation de celui sur lequel se déversent une nuée de flèches et qui a à cueillir celles qu’il aura à son tour besoin de lancer à d’autres, pour reprendre cette belle image nietzschéenne. Lorsqu’il sera question de le soumettre à la question « qui ? » chacun pourra ainsi reprendre pour son compte cette phrase du démon biblique : « Mon nom est légion car nous sommes plusieurs » (Luc, 8 : 30-33 ; Marc, 5 : 9-13).
[NOTE : Dans la parabole, les démons brisaient l’égalité à soi de l’individu possédé. Mais, identifiés, ils demandent au Verbe de les résoudre dans un troupeau de porcs et se jettent alors du haut de la falaise dans la mer. Autrement dit, l’ordre est rétabli lorsqu’une multiplicité (la légion) passe de l’un (le possédé) au pluriel (le troupeau), avant de se fondre dans le tout mouvant.]
La question « qui ? » devra dès lors céder la place à la question « quel ? », qu’elle présuppose et que nous définirons méthodologiquement comme le postulat de la multiplicité « autorale » d’une pensée.
[NOTE : c’est ce que Merleau Ponty découvrait dans ses notes de travail de Mars 1961 : « Étudier le Descartes pré-méthodique […] et le Descartes post-méthodique, celui d’après la VIème Méditation […] le Descartes “vertical” âme et corps, et non celui de l’intuitus mentis (…) le Descartes d’avant et d’après l’ordre des raisons, le Descartes du Cogito avant le Cogito », M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Gallimard, Paris, 1964, p. 326]
À quel Bergson, à quel Heidegger nous adresserons-nous donc pour saisir leur indiscutable et pourtant fragile rapport ? Fragile, dans la mesure où nous sommes exposés aux pires contresens et malentendu.
[NOTE : comme en témoigne Heidegger lui-même, dans une lettre du 24 novembre 1928 à K Jaspers : « J’ai déjà lu si souvent que j’étais la synthèse devenue réalité – depuis longtemps d’ailleurs projetée par d’autres – de Dilthey et Husserl, assaisonnée d’un peu de Kierkegaard et de Bergson. » Cf. Heidegger, Correspondance avec Karl Jaspers, trad. C-N. Grimbert, Gallimard, Paris, 1996, p. 92]
Ce ne sont pas là seulement deux grandes figures universitaires ou membres privilégiés du panthéon de l’histoire des idées. Tous deux entendent réviser notre rapport à la métaphysique occidentale, l’un en menant le projet d’une restauration de celle-ci avec la position des problèmes, l’autre de sa déconstruction avec l’élaboration topologique des questions. Ils invitent chacun à une expérience de la pensée qui procède de tracés précis et rigoureux de lignes de faits ou de voies de localisation, conformément au sens originel de la méthode comme chemin (odós). En questionnant les vrais problèmes ou en problématisant les bonnes questions, il s’agit pour chacun de libérer la pensée des réflexes de l’intelligence géométrique et de l’emprise de la logique : penser contre la raison sans pour autant renoncer à la rigueur et à la précision.
« Depuis longtemps, trop longtemps déjà, la pensée est échouée en terrain sec. Peut-on maintenant appeler ‘’irrationalisme’’ l’effort qui consiste à ramener la pensée dans son élément ? » (Heidegger, Questions III-IV, p. 69).
Sur un tel terrain, celui de la tradition, l’être ne vaut plus qu’en tant qu’il offre un terme à la visée d’une représentation dont les catégories n’ont pas pour unique effet de figer le mouvement ondulatoire du penser et de l’aplatir à la surface : elles empêchent surtout l’eau qui court de revenir à sa source. Si, comme le montre Bergson dans L’Évolution créatrice, l’intelligence s’est formée « par voie de condensation » (Bergson, L’Évolution créatrice, in Oeuvres, Puf, éd. du Centenaire, Paris, 1959, noté EC, p. 659/ 194) au terme d’une genèse qu’elle doit revivre à rebours pour retrouver l’« océan de vie » et le « fluide bienfaisant (EC, p. 657/ 192) » dans lequel elle s’origine, alors il ne reste qu’à « pousser l’intelligence hors de chez elle » (EC, p. 659/ 195), en la jetant dans ce milieu aquatique qui à terme lui est devenu étranger et l’effraye :
« Le raisonnement me clouera toujours, en effet, à la terre ferme. Mais si, tout bonnement, je me jette à l’eau sans avoir peur, je me soutiendrai d’abord sur l’eau tant bien que mal en me débattant contre elle, et peu à peu, je m’adapterai à ce nouveau milieu, j’apprendrai à nager. » (EC, p. 658/ 193-194.)
Sans un effort de volonté, l’intelligence ne saurait quitter son milieu naturel ni remonter la pente de ses habitudes pour retrouver son élément originel :
« Celui qui se jette à l’eau, n’ayant jamais connu que la résistance de la terre ferme, se noierait tout de suite s’il ne se débattait pas contre la fluidité de ce nouveau milieu ; force lui est de se cramponner à ce que l’eau lui présente encore, pour ainsi dire, de solidité. À cette condition seulement on finit par s’accommoder au fluide dans ce qu’il a d’inconsistant. Ainsi pour notre pensée, quand elle s’est décidée à faire le saut. Mais il faut qu’elle saute, c’est-à-dire qu’elle sorte de son milieu. […] Vous aurez beau exécuté mille et mille variations sur le thème de la marche, vous ne tirerez pas de là une règle pour nager » (EC, p. 659/ 194.)
En mettant l’accent sur le chemin, Heidegger répète à sa manière l’exigence d’animer la pensée contre sa fixation « dans les espaces raréfiés des concepts morts » (Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ?, trad. A. Becker et G. Granel, Puf, Paris, 1959, noté QP, p. 67). S’il faut remettre la pensée dans son élément d’origine, c’est que « nous ne sommes pas encore dans le propre de la pensée. » (QP, p. 103.) Nous n’y parvenons qu’en accomplissant le saut « pour atteindre le sol même sur lequel nous nous trouvons. » (QP, p. 43.) Dans tous les cas, le chemin nous conduit jusqu’au point où il devient nécessaire de sauter par-dessus l’habitude millénaire qui a abouti à la « méversion » de l’esprit, c’est-à-dire à l’interprétation instrumentale de la pensée, laquelle a fourni jusque-là un critère inapproprié pour juger de la puissance de la pensée et de sa co-appartenance à l’être.
« Cette façon de juger équivaut au procédé qui tenterait d’apprécier l’essence et les ressources du poisson sur la capacité qu’il a de vivre en terrain sec. » (Q III-IV, p. 69.)
La pensée qui s’achemine se tient en dehors de tout lieu donné, de tout secteur dont les limites seraient déjà tracées, parce qu’elle doit elle-même construire le lieu qui rassemble les lieux (c’est là ce qui définit le chemin) pour approcher le lieu de ce qui donne lieu (le y de “il y a” qui se dit es gibt, « ça donne », en allemand.)
[NOTE : cf. É. Escoubas, « Parcours de la topologie dans l’œuvre de Heidegger », Les Temps Modernes, juillet-octobre 2008, numéro 650, pp. 158-173. L’auteur analyse cette « logique du lieu » en termes de « puissances » en empruntant ce terme à Schelling, (Potenzen) sans restreindre toutefois le déploiement de cette logique au « deuxième » Heidegger : « Nous pensons que l’œuvre entière de Heidegger est susceptible d’une lecture topologique, d’une ‘’logique du lieu’’, qui rende compte des différents moments ou périodes de la pensée de Heidegger » (p.158). Cela conduit naturellement à chercher à « éclairer la configuration des ‘’tensions’’ ou ‘’puissances’’ entre les thèmes constitutifs de chaque période de l’œuvre heideggérienne » (p. 159). En effet, la « métaphore » (mais est-ce bien une métaphore ?) des chemins apparaît dès les premiers textes de Heidegger et servira jusqu’à son inscription sur la tombe pour intituler l’œuvre entière. En tant qu’il nomme la dunamis du questionnement, le chemin est une ligne virtuelle qu’il faut réaliser, creuser et prolonger.]
Si le chemin prend place dans un espace forestier, il ne faut quand même pas y voir une excursion hors du plan d’exploitation généralisée de la nature par la technique contemporaine. Dans le phénomène planétaire de la dévastation du monde, ce qui est perdu avant tout c’est précisément le sens du lieu. C’est ce dont en atteste l’idéal d’abolition des distances et de la proximité ainsi que l’impossibilité de l’habitation.
[NOTE : QP, p. 67 : « entrer pas après pas, c’est-à-dire à chaque phrase, sur un terrain difficile, qui cependant ne s’étend pas à l’écart, dans les espaces raréfiés des concepts morts, ni dans les dérèglements de l’abstraction. Ce terrain s’étend dans un pays sur le sol duquel s’accomplissent tous les mouvements de notre époque moderne. Que l’on ne voie pas ce sol, et encore moins bien le pays, ou pour mieux dire qu’on ne veuille pas les voir, ce n’est pas une preuve qu’ils ne sont pas. ».
La lenteur et la monotonie qui ont cours sur le Feldweg (le chemin de campagne) ne doivent pas nous tromper, habitués que nous sommes aux rues grouillantes et aux routes embouteillées des mégalopoles contemporaines. Le chemin a ceci de particulier qu’il définit un espace de repos dynamique, de telle sorte qu’il est le principe à la fois d’une territorialisation – il prend place dans un paysage qui se rassemble autour de lui et qui donne le monde (Q III-IV, p. 13 : « Les choses à demeure autour du chemin, dans leur ampleur et leur plénitude, donnent le monde. ») – et d’une déterritorialisation – il traverse divers lieux jusqu’à celui qui exige le saut vers ce qui n’est plus susceptible d’apparaître comme lieu, tant il nous entraîne dans le sans-fond de ce qui se soustrait à la toute-puissance du fondement (principe de raison), vers le souterrain impensé (ce qui n’a pas été pensé) par lequel communiquent les pensées.
[Note : Une telle mise au point faisant appel au concept deleuzien du territoire permet d’étendre le champ de la « cueille » (c’est le sens même du mot « lecture ») des flèches philosophiques. Que le motif « nous ne pensons pas encore » anime l’œuvre de Deleuze, cela confirme l’existence d’une source muette dont procède la communauté des penseurs. Et que de son propre témoignage, Foucault atteste d’une secrète et continue obédience à Heidegger, alors que son style semble l’en écarter, cela suffit pour signaler une certaine tradition souterraine dont la continuité n’exclut nullement les sauts et les ruptures.cf. M. Foucault, « Le retour de la morale » in Dits et écrits IV, 697, Gallimard, Nrf, Paris 1984 : « Tout mon devenir philosophique a été déterminé par ma lecture de Heidegger.]
L’histoire de la philosophie n’est pas cadencée de manière extérieure : elle dessine un événement de dissémination dont les actualisations successives (par différenciations) n’en épuisent jamais les virtualités qui demeurent en réserve. Car il s’agit d’abord de rappeler le passé en fonction de ce qu’il laisse advenir, des tendances qui s’y dessinent. Tel est le sens de l’impensé qui renvoie davantage à une promesse de richesses qu’à un manque dans la tradition. Cela devrait atténuer l’impression d’un point de vue unitaire auquel le penseur allemand semble parfois soumettre l’histoire de « la » métaphysique. Ce qui n’a pas encore été pensé tout autant que ce qui a été pensé ailleurs, appartient à la philosophie de façon plus essentielle que tout ce que celle-ci a pu penser jusqu’ici et maintenant :
« Plus grande est l’œuvre d’un penseur – ce qui ne se mesure aucunement à l’étendue et au nombre de ses écrits – et d’autant plus riche est l’impensé qu’elle renferme, c’est-à-dire ce qui, pour la première fois et grâce à elle, monte à la surface comme n’ayant pas encore été pensé. A vrai dire cet impensé ne concerne pas quelque chose qu’un penseur n’aurait pas vu ou dont il n’aurait pu venir à bout, et qu’après lui d’autres penseurs plus capables devraient tirer au jour » (Heidegger, Le principe de raison, trad. A. Préau, Gallimard, Tel, Paris, 1962, noté PR, p. 166).
C’est pourquoi, il ne sera pas question, dans le retour sur l’impensé, de penser mieux que les prédécesseurs, dans le sens d’un progrès ou d’une rectification de tirs inaboutis, mais de penser autrement.
[NOTE : Ce qui implique l’invitation à se confronter à d’autres aventures de la pensée, telles qu’elles ont pu avoir lieu dans d’autres contrées et avant tout en Orient.]
Dans cette exigence d’apprendre à penser autrement il s’agit avant tout pour la pensée de devenir fidèle à elle-même, pour nous permettre de recréer notre rapport au monde en montrant dans ce qui est le plus proche cette distance essentielle que la science et la philosophie ont voulu nous faire oublier en prétendant la combler. Il s’agit aussi de reconnaître que ce qui se retire ne dépend pas de nous (il n’est pas le fait de notre finitude) mais qu’il est relatif à la « chose même » de sorte que le repoussement des limites ne saurait l’atteindre.
« Il faut que, dans les choses mêmes soit fondé le mouvement qui les dénature, il faut que les choses commencent pas se perdre pour que nous finissions par les perdre, il faut qu’un oubli soit fondé dans l’être » (G. Deleuze, « Bergson 1859-1941 » in L’Île Déserte, coll. « Paradoxe », éd. de minuit, Paris, 2002, p. 30.)
C’est à cette condition seulement que pourra s’engager pour Bergson l’invention des vrais problèmes et pour Heidegger la répétition créatrice de la question la plus ancienne :
« […] ce que l’on a nommé le non-penser qui régnait jusqu’à nos jours n’est pas une négligence, mais est à penser au contraire comme la conséquence du retrait de l’être lui-même. Un tel retrait appartient à la clairière de l’être comme privation de celle-ci » (Q III-IV, p. 234).
Bien plus que de rappeler l’être à la mémoire pour surmonter un oubli accidentel, il faut aller à la rencontre de cet événement de dissension originaire par où l’être se retire. De même, il s’agit pour Bergson de retrouver le point à partir duquel la source se dédouble en partageant l’existence en deux courants contraires, l’un de détente et l’autre de tension, celui que nous pourrons emprunter pour aller au-devant de l’étant présent et celui qui provoque le retournement de tout notre être vers l’être comme Mémoire ontologique. Accomplir cette remontée à contre-courant vers l’origine, suppose de rechercher l’impensé de toute question ou de restaurer l’intuition primordiale dans tout problème :
« […] on peut dire a priori que le problème de la durée est le problème central de la métaphysique, et que, dans l’histoire des systèmes, alors même qu’il n’est pas parlé du temps, de la durée, sûrement le problème est là, il est traité implicitement, et la question est centrale ; elle occupe en dépit des apparences, le centre même du système ». (Bergson, Cours sur « l’histoire de l’idée de temps », Annales bergsoniennes I, Bergson dans le siècle, éd. par F. Worms, Puf, coll. Épiméthée, Paris, 2002, p. 44.)
Restaurer les intuitions originelles d’une pensée pour retrouver le centre dynamique qui l’a engendrée ne nous épargne en rien l’effort de déconstruire ses dispositifs conceptuels. On ne se libère pas de la tradition sans libérer la tradition elle-même des sédiments successifs qui ont fini par en obstruer l’accès.
Alors que les philosophes pensaient encore selon l’espace, Bergson veut fondre la métaphysique (plutôt que la « fonder » pour reprendre le jeu de mots de Camille Riquier dans son Archéologie de Bergson) dans l’intuition de la durée. La question se pose de savoir s’il parvient au travers de cette tâche à « court-circuiter l’histoire de l’onto-théologie ».
[NOTE : c’est l’expression qu’utilise J-M. Vaysse dans son étude sur Spinoza et Heidegger, Totalité et finitude, Vrin, Paris, 2004, dans laquelle il montre en quoi l’ontologie spinoziste résiste à la lecture heideggérienne de l’histoire de la métaphysique, dans la mesure où elle met en question le fondement théologique de celle-ci en poussant jusqu’au bout ses conséquences ultimes]
Car la « restauration » ne consiste pas à reprendre la métaphysique passée telle quelle et à en adapter la structure à l’esprit du temps. Le terme « restaurer » doit être pris au sens d’une réinstauration de ce dont procède toute pensée avant de parvenir à son expression doctrinale et de se figer dans des thèses toutes faites, dont les résultats pourraient alors être colportés sous forme de dogmes sans vie détachés de leur genèse. Le but est de « faire sortir la philosophie de l’école » et de « la rapprocher de la vie » (Bergson, La Pensée et le Mouvant, Puf, éd. du Centenaire, Paris, 1959, noté PM, p. 1363/ 139). Le nouveau spiritualisme crée ainsi à la fois les conditions d’une reprise et d’une rupture : un retour à l’intuition fondamentale des problèmes qui ont été jusque-là mal posés, parce que les termes étaient inadéquats ou mal analysés, et une rupture avec les faux problèmes « formulés en termes d’illusion » (PM, p. 1335/ 104). Toute pensée prend d’abord naissance dans une intuition fondamentale que les philosophes finissent par trahir dans l’extension de l’écrit.
[NOTE : cf. J. Chevalier, Entretiens avec Bergson, Plon, Paris, 1959, p. 54 : « Rien n’est plus frappant que le contraste entre le système très compliqué de Spinoza et l’intuition simple qu’il exprime. Cette intuition en son fond est vraie, mais elle n’est ni complète, ni pure, et elle n’est pas pure parce qu’elle n’est pas complète ».]
En tant qu’elle constitue l’acte primordial de la pensée, l’intuition se retrouve, à divers degrés d’intensité et de profondeur dans toute doctrine. Il y aurait donc un moyen de revenir, si du moins nous faisions l’effort de nous y installer « au lieu d’en faire le tour (PM, p. 1347/ 119) », jusqu’à un point dont la simplicité excessive échappe à tout langage et à toute reformulation. Les redites qu’on croirait y trouver ne sont qu’apparentes tant la nouveauté des problèmes qui sont soulevés oblige l’interprète à en chercher le mouvement singulier au lieu de les recomposer extérieurement à partir d’associations et de combinaisons conceptuelles avec du déjà-pensé. Ici, l’original (le non-identique) et l’originaire (le même) se rencontrent.
PM, p. 1349/ 122 : « là même où le philosophe semble répéter des choses déjà dites, il les pense à sa manière »
Cependant, en entendant repenser les conditions de possibilités des ontologies traditionnelles, qui définissent l’être à partir de l’étant suprême, sur la base d’un questionnement sur le sens du mot « être », Heidegger cherche de son côté à suspendre toute ontologie au profit d’une méta-ontologie :
« Toute ontologie, si richement et solidement agencé que puisse être le système des catégories dont elle dispose, demeure au fond aveugle et pervertit son intention la plus propre tant qu’elle n’a pas d’abord suffisamment tiré au clair le sens de l’être et n’a pas conçu cette clarification comme sa tâche fondamentale. Quand elle est bien entendue, l’investigation ontologique donne elle-même à la question de l’être sa primauté ontologique qui laisse loin derrière la simple reprise d’une tradition vénérable et le désir de faire avancer un problème resté jusqu’ici impénétrable. » (Heidegger, Être et temps, Gallimard, Paris, 1986 (noté SZ), p. 11.
Il n’est donc pas question pour Heidegger de fonder une nouvelle théorie de l’être de l’étant en continuant encore à demander ce qu’est l’étant, tant du moins qu’une recherche sur le sens de l’être n’a pas été entreprise. On peut cependant deviner dans le motif où s’inscrit le projet d’une ontologie fondamentale, que toute nouvelle fondation n’est pas seulement différée, mise entre parenthèses, voire purement et simplement écartée. La déconstruction (nous privilégions le terme Abbau pour souligner la continuité du geste heideggérien dans son ensemble, depuis la Destruktion jusqu’à l’Überwindung, « surmontement », et le Schrittzurück, « pas en arrière », en accord avec sa prolongation dans le travail de J. Derrida) ne vise pas l’anéantissement d’un édifice en vue de lui substituer un autre, pas plus qu’elle ne vise l’Aufhebung dialectique des philosophies antérieures dans une pensée finale, mais elle concerne l’analyse des structures de toute édification en vue de revenir à l’impulsion fondamentale du philosopher, celui de l’habiter qui précède tout bâtir. Ainsi, la déconstruction de la tradition vise à en établir les possibilités originales en vue de l’habitation du monde. C’est ce qui conduira le « deuxième » Heidegger à l’exigence d’accomplir le pas en arrière de la philosophie, vers une pensée plus matinale, auprès du matin du monde, une pensée qui se soucie de l’habiter – car si on ne correspond toujours pas à ce qui est à penser, autrement dit, si on ne pense pas encore, cela signifie que nous faillons à l’habiter, à la possibilité du foyer. Nous n’avons rien du poète philoikos, l’ami de la maison. Et pourtant, en tant qu’hommes, nous ne saurions habiter le monde que poétiquement et méditativement.
Avec le Tournant (die Kehre) dans la pensée, la métaphysique se confond désormais avec l’histoire planétaire, situant la pensée en fonction d’un évènement (l’absence de monde des expulsés que nous sommes du pouvoir-habiter). Ce événement en appelle à l’attente autant qu’à la mémoire. Toutefois, la pensée qui pense après (et avant) la métaphysique continue de penser auprès de la métaphysique. Surmontée, cette dernière n’est donc ni dépassée ni délaissée comme pourrait l’être une entreprise vaine et inutile. Elle reste au centre de la méditation, et si on ne peut s’en écarter, c’est parce qu’elle est déjà achevée dans le règne de la technique planétaire où elle actualise encore ses possibilités. Et c’est justement sous un tel horizon que l’oubli de l’être peut désormais être rappelé : son recouvrement le plus extrême est le signe de son appropriation prochaine.
Nous dirons alors de la déconstruction de la métaphysique et de sa restauration qu’elles nous préparent, chacune à leur manière, à recevoir l’impensé de la tradition. Malgré leurs divergences et leur distance, ces deux entreprises forment un geste similaire, qu’une pensée de la différence devra à leur suite reprendre pour son compte.
[NOTE : Par-delà la logique de l’identité et de l’unicité, le même n’exclut pas la différence et la multiplicité : « Les penseurs essentiels disent constamment le même. Ce qui ne veut pas dire l’identique » (Heidegger, Questions III et IV, trad. J. Beaufret, F. Fédier, J. Hervier, J. Lauxerois, R. Munier, A. Préau et C. Roëls, Gallimard, Tel, Paris, 1976 (noté Q III-IV), p. 126). Dans l’identité, toutes les différences s’effacent sous le morne habit de la généralité qui fixe les variations dans un concept unique, égal à soi (A = A) ; tandis que la « mêmeté » advient dans un mouvement d’auto-différenciation dynamique et de scission interne. Par conséquent, la différance en jeu dans le même ne saurait se réduire en une distinction thétique entre des termes extérieurs et opposés l’un à l’autre.]
Dans les deux cas, il revient à la philosophie de faire sa part à une différence radicale qui serait celle de toutes les différences, ou encore à l’événement de la différenciation en tant que telle
[NOTE : cf. F. Dastur, Philosophie et différence, éd. de la Transparence, Chatou, 2004, p. 16. Ce qui est dit de Heidegger, s’applique parfaitement pour Bergson : « il réinstaure une différence, mais en vient à la penser comme inhérente à un être qui se retire ‘’par essence’’ : il veut ainsi remonter en deçà du projet philosophique en pensant l’événement de la différence lui-même, et non en s’installant dans une différence déjà advenue. »]
C’est que la confusion entre deux types de différences (de nature et de degrés), tout comme l’assimilation du pli de l’être aux distinctions entre étants (et à l’étant suprême) marquent à chaque fois l’histoire de la métaphysique d’une indifférence et d’une indifférenciation significatives.
[NOTE : cf. Les deux sens de la vie, Puf, Quadrige, coll. essais débats, Paris, 2004, p. 254, où F. Worms souligne un point de comparaison essentiel pour notre propos : « On pourrait même dire pour Bergson, comme pour Heidegger, la philosophie commence en disant et en masquant du même coup la question de l’être puisqu’elle commence avec les paradoxes de Zénon, qui à la fois posent la question du mouvement et en nient la réalité. Mais l’histoire de la philosophie sera comme une lutte entre les tendances logiques de notre esprit et la résistance d’une intuition qui non seulement constate le mouvement, mais en fait une réalité antérieure à celle des essences logiques et dont celles-ci sont issues. »]
Ainsi, la déconstruction questionne l’oubli de l’être dans une tradition dominée par les distinctions d’ordre ontique, et la restauration s’attelle à la tâche de séparer les mixtes confus pour poser les vrais problèmes (jusque là posés en termes d’espace) en termes de durée, sans sortir du champ de possibilités de l’expérience réelle.
C’est que la métaphysique pour Bergson doit se faire expérimentale et l’expérience devenir métaphysique. L’expérience brute ne donne quant à elle qu’un mixte confus de tendances divergentes qu’il s’agit de démêler en les prolongeant dans une direction idéale. Si la méthode autorise à dépasser l’observable, c’est précisément pour permettre de retrouver les différences de nature constitutives du réel dans leur pureté en deçà de leur mélange réel :
« Le but de toute notre recherche n’est-il pas de retrouver le réel, de modeler notre esprit sur lui, afin de tâcher de le comprendre ? Le réel m’apparaît comme une forêt immense, semée de beaucoup d’obstacles, à travers laquelle le chercheur, pareil à un bûcheron, ouvre des avenues. Beaucoup de ces avenues aboutissent à des impasses. Mais il arrive quelques fois que deux d’entre elles se rejoignent : alors on y voit clair, et de cette convergence naît pour l’esprit le sentiment de la vérité. Cette prudence ne nous interdit pas de dépasser les faits : la convergence même de deux lignes de visée nous incite à le faire, en nous montrant un au-delà de l’observé et de l’observable : mais, alors, il faut bien marquer qu’on dépasse les faits. » (E, p. 39, nous soulignons.)
Dans Matière et mémoire, Bergson sépare la perception et le souvenir selon une division entre deux lignes de faits, l’une objective et l’autre subjective, avant de recouper le point en deçà du tournant de l’expérience où elles se rejoignent. À ce niveau tout idéal, il retrouve la durée dans son double mouvement de détente et de tension par où elle se matérialise et se spiritualise. Dans l’Évolution créatrice, en isolant ce qu’il y a d’instinctif dans l’instinct et ce qu’il y a d’intelligent dans l’intelligence, Bergson va plus loin encore, puisque c’est à l’origine et à la fin de l’évolution qu’il prétend nous faire assister en même temps : au point de divergence entre les deux directions d’une intériorisation et d’une extériorisation, un même principe vital, et au point de convergence, l’homme comme le terme infini ou la « finalité sans fin » de l’évolution. On peut poursuivre ce mouvement jusqu’aux Deux sources où l’homme lui-même devient un écart entre la tendance à la clôture de l’intelligence et de l’instinct, et la tendance à l’ouverture dont la direction est tracée par une surhumanité au niveau de laquelle il n’y a plus de disharmonie possible. Ce sont des individus historiques qui ont déjà incarné cette humanité supérieure, qui l’incarnent peut-être et l’incarneront sans doute encore. Ils sont déjà eux-mêmes en deçà du tournant où toutes les directions convergent dans l’horizon que le philosophe pressentait grâce à la méthode. Le sentiment immédiat est devenu émotion créatrice. C’est ce qui fait dire à Deleuze que le probabilisme de la pensée est finalement transmué en certitude mystique et que Bergson atteint alors une « enveloppe ou une limite à tous les aspects de la méthode. » (Deleuze, Le bergsonisme, op. cit., p. 119.)
En prolongeant les lignes de faits qu’elle avait d’abord séparées jusqu’à leur point de recoupement idéal, la méthode ne visait rien moins qu’à retrouver l’expérience à sa source, c’est-à-dire à la dépasser vers ses conditions réelles(Ibid., p. 13 : « On dépasse l’expérience vers des conditions de l’expérience (mais celles-ci ne sont pas à la manière kantienne, les conditions de toute expérience possible, ce sont les conditions de l’expérience réelle. ») Chercher à accomplir l’expérience des conditions originaires de l’expérience, ce n’est pas faire tenir toute expérience possible dans un principe synthétique a priori. Telle aura été la prétention de Kant contre le dogmatisme métaphysique. Mais le criticisme a échoué en ceci qu’il n’a eu affaire qu’à du constitué sans jamais parvenir au constituant. De plus, l’analyse cartographique de l’esprit ne saurait nous montrer la possibilité d’une dilatation de la pensée telle que l’exigerait la connaissance métaphysique (cf. ES, p. 816/ 2 : « Je ne vois qu’un seul moyen de savoir jusqu’où on peut aller : c’est de se mettre en route et de marcher. Si la connaissance que nous cherchons est réellement instructive, si elle doit nous permettre de dilater notre pensée, toute analyse préalable du mécanisme de la pensée ne pourrait que nous montrer l’impossibilité d’aller aussi loin, puisque nous aurions étudié notre pensée avant la dilatation qu’il s’agit d’obtenir d’elle. » ) Si cette dernière est possible, c’est justement dans la mesure où l’esprit fait l’effort pour dépasser ses conditionnements pour se fondre dans le tout, au lieu de se fixer sur son île.
[NOTE : Kant aurait confondu l’entendement et le cerveau – c’est le cerveau qui fixe l’esprit et l’empêche de divaguer. Il est conduit à concevoir l’entendement au milieu du chaos des illusions qui le pressent de toute part et le menacent constamment d’engloutissement. Tout l’art poïétique du cartographe de la raison pure culmine dans la présentation de cette utopie insulaire qui est une description intelligente, c’est-à-dire spatiale, de l’esprit : « Nous avons maintenant non seulement parcouru le pays de l’entendement pur, en en examinant chaque partie avec soin, mais nous l’avons aussi mesuré, et nous y avons fixé chaque chose à sa place. » Kant, Critique de la raison pure, op. cit., p. 970, (traduction légèrement modifiée – nous soulignons). La valeur didactique de toute cette imagerie consiste, dira-t-on, à prendre le relais des concepts pour imposer à l’esprit quelque chose comme le dessin d’une signification intellectuelle, le schème d’un sens intelligible. Nous devons cependant y voir un exemple de ce qu’on pourrait appeler le « géographisme » de Kant, qui en fait un penseur de l’espace – ce dont il donne une confirmation éclatante dans la courte dissertation Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? On découvre alors qu’il y a une continuité plus que métaphorique entre l’orientation dans l’espace et celle dans la pensée : un principe subjectif est toujours à l’œuvre qui permet de distinguer et de fixer des lieux et des directions. Or, c’est cette continuité qui va assurer la progression même de l’éducation de l’esprit, c’est-à-dire son apprentissage des règles qui lui assureront un passage vers la majorité intelligente. Il faut donc commencer par fixer l’imagination débordante de l’enfance : c’est à la géographie qu’il revient d’assurer la formation de l’imagination, et plus spécialement l’initiation aux cartes : « Les cartes géographiques ont en elles-mêmes quelque chose qui charme tous les enfants, même les plus petits. Lorsqu’ils sont fatigués de toute autre étude, ils apprennent encore quelque chose lorsqu’on use de cartes. Et c’est là une bonne distraction pour les enfants, en laquelle leur imagination ne peut pas rêver, mais doit pour ainsi dire se fixer à une certaine figure. On pourrait réellement faire commencer les enfants par la géographie. On pourrait y joindre en même temps des figures d’animaux, de plantes ; elles devraient rendre la géographie plus vivante. L’histoire devrait venir seulement plus tard. » cf. Kant, Réflexions sur l’éducation, trad. A. Philonenko, Vrin, 1966, p. 158 (nous soulignons). Retenons que la formation consiste aussi en une fixation. Il s’agit avec l’apprentissage de la géographie de fixer l’imagination pour qu’elle ne rêve pas, c’est-à-dire la soumettre à des règles intellectuelles. On ne chasse pas l’imagination de la science : on la tient, on l’immobilise. Autrement dit le rôle de l’entendement vigilant est d’inhiber le rêve. C’est seulement dans l’expérience esthétique, qui renvoie à un autre champ de l’existence humaine, à moins de donner une réponse spécifique à la question générale « qui est l’homme ? », que l’entendement va se laisser aller aux rêveries de l’imagination. Notre unité proprement humaine s’éprouve dans la libre expérience esthétique, qui est un état de rêverie éveillée et de dissipation intellectuelle.]
Il faut par conséquent dépasser la limitation kantienne en élargissant la méthode expérimentale vers ce qui ne relève pas des grandeurs variables. Pour Bergson, Kant n’a pas borné la connaissance à l’expérience, il aura rétréci le champ de l’expérience en n’y voyant qu’un accès aux phénomènes mécaniques et déterminables mathématiquement.
[NOTE : « C’est ainsi que j’ai été amené à dilater ma pensée sans quitter le réel. Il faut dilater sa pensée indéfiniment avec le réel. Pascal l’avait vu et l’avait pratiqué. Plus je vais, plus je me sens proche de Pascal : ce que Pascal appelle le « sentiment » n’est autre chose que ce que j’appelle « l’immédiat ». […] c’est de Descartes et de Pascal que procèdent les deux courants qui se sont partagé la pensée moderne : mais le courant qui procède de Pascal, s’il est moins visible, est peut-être plus profond que le courant cartésien. » E, p. 39. Cf. également B. Pascal, Pensées, 530, Lafuma : « Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment. »]
Une pensée qui cherche à dépasser l’expérience humaine vers sa source doit dès lors commencer par retrouver un immédiat qui, par essence, se retire, de même que l’être se cèle en faveur de l’étant.
Si la durée renouvelle notre entente de l’être, on ne pourra cependant pas la penser comme une nouvelle figure historiale de celui-ci. Assimiler être et durée reviendrait à lire le bergsonisme comme une étape supplémentaire de la dispensation de l’être dans l’histoire de son oubli. La durée serait une figure de l’être de l’étant au même titre que l’Idée, l’objectivité des objets, l’Esprit absolu ou la volonté de puissance. On ne saurait pas plus, sans produire de faux problèmes, opposer à l’être comme terme général un concept impersonnel du devenir. Ce qui est en question, pour Bergson, c’est bien plutôt la co-appartenance de l’être et de la durée :
« […] je ne puis séparer l’être de la durée ; j’ai été jusqu’ici amené à voir plutôt l’aspect durée comme essentiel à l’être. […] le problème qui se pose précisément à moi est celui-ci : jusqu’à quel point, dans quelle mesure la durée, inséparable de l’être, touche-t-elle l’être ? » (Entretiens, p. 15-16).
La mise au jour de ce contact interdit la séparation métaphysique entre deux temporalités, l’éternité et le devenir, et par conséquent entre deux lieux, l’intelligible et le sensible, et rend compte pour la première fois de la nécessité de penser rigoureusement l’être sous l’horizon du temps.
« Le problème que se sont, en somme, posé tous les philosophes, a été d’expliquer le devenir, c’est-à-dire la durée ; et toujours la solution a consisté à y substituer le concept. Or, l’histoire nous montre l’échec complet de ce mode d’explication ; aucun système n’a pu trouver le moyen de passer du monde intelligible au monde sensible. » (Bergson, Mélanges, Puf, Paris, 1972, p. 517.)
Qu’il y a dans la Métaphysique cette tendance à diviser le monde en deux lieux différents, un topos sensible (en devenir) et un topos intelligible (immuable), et à occulter la différence entre différence de nature et différence de degrés, cela vient avant tout de la tendance de l’être au cèlement et par conséquent à l’aplatissement du pli de la différance. Il semble alors qu’en divisant le mouvement de la durée en deux sens adverses, celui du présent spatial et celui du passé durant, Bergson accomplit une approche temporale de la différence ontologique qui échappe à la détermination traditionnelle de l’essence comme par-ousia (pré-sence) : il cesse par conséquent de rapporter l’être à ce mode abstrait du temps dans lequel il aura été jusque-là enfermé. Car, ce que l’intuition chez Bergson voit n’est pas une présence identique à soi, mais un procès de différenciations, où l’être cesse de figurer un objet de la représentation. Qu’il diffère de l’étant, cela signifie que la totalité de l’étant n’est pas le produit donné ou l’effet d’une cause étante, comme si l’étant survenait à l’être à titre de juxtaposition entre deux choses présentes subsistantes (Vorhanden). Le présent est toujours dans un rapport de différance par rapport au passé, différence dynamique qui implique leur coexistence virtuelle hors de toute actualité ontique et précède ainsi toute détermination du temps en termes de succession de maintenants selon l’avant et l’après. Cette idée chez Bergson marque de manière insigne le pli de l’être et de l’étant tel qu’il s’affirme dans la pensée de Heidegger.
[NOTE : Il ne s’agit pas de signaler par là les insuffisances du bergsonisme, comme si sa vérité se trouvait dans Heidegger, mais de prendre mesure de l’événement que la pensée heideggérienne dans ce qu’elle a de propre a été en situation de méditer à fond comme étant l’inquestionné de toute philosophie. À l’inverse, le but n’est pas de montrer les influences que Heidegger aurait pu subir. Indiquons cependant quelques points importants dans la réception heideggérienne de Bergson auquel les premiers écrits ne manquent jamais de se référer explicitement. La leçon d’habilitation de 1915, Le concept de temps dans la science historique, vise à rechercher dans l’historicité un temps non objectif tel que celui qui se rencontre en sciences de la nature et qui est un temps mesurable, spatialisé et homogène. En cherchant un champ qui échappe aux approches théorétiques de la réalité, le Heidegger de l’herméneutique de la facticité rencontre la sphère de la vie comme plus originaire que toute constitution d’un monde objectif. J. Greisch propose même de « penser le ‘’prémondain’’ comme l’équivalent heideggérien de l’ ‘’élan vital’’ bergsonien. » (L’Arbre de vie et l’Arbre du savoir, Les racines phénoménologiques de l’herméneutique heideggérienne (1919-1923), éd. du Cerf, Paris, 2000, p. 49). En effet la notion de Lebensschwungkraft qui apparaît dans le cours de 1919, Kriegsnotsemester (GA 56-57, Zur Bestimmung der Philosophie, Klostermann, Frankfurt am Main, 1987, p. 115) désigne le mouvement de lancée du « es gibt » (« il y a » ou littéralement : « ça donne ») à l’origine de la production des différents mondes de la vie : le monde vécu, le monde religieux, le monde esthétique et le monde social surgissent à partir de ce prémondain avant toute donation pour un sujet orienté sur la réification du monde. On ne peut donc ignorer qu’au moment même où sa pensée germait, Heidegger reconnaissait déjà tout ce que son originalité future pourrait devoir à Bergson. Cf. « Ma chère petite âme », Lettres à sa femme Elfriede, 1915-1970, trad. M-A. Maillet, éd. du Seuil, Paris, 2007, p. 147 : le 8 février 1920, Heidegger écrit : « je travaille maintenant à fond et systématiquement Bergson et partant de là j’aimerais arriver à Jaspers, je me sens maintenant si libre, si créateur par moi-même – qui plus est, j’ai maintenant une position claire vis-à-vis de Husserl – il faut juste qu’arrive la nomination, je pourrai alors puiser dans tout ce qu’il y a en moi… » Cf. également p. 148, la lettre du 11 février 1920 : « J’apprends beaucoup en étudiant Bergson – ce que je t’ai dit il y a des semaines déjà, combien peu nous connaissons les Français – se confirme de plus en plus – des problèmes que souvent Husserl dans la conversation présente comme des nouveautés inouïes ont été clairement définis et résolus par Bergson il y a déjà 20 ans de cela. » Cela indique clairement une volonté de jouer Bergson contre Husserl, comme si la pensée de la vie permettait de contrebalancer les excès du logicisme du maître.]
Deleuze nous incite à lire dans le bergsonisme une percée vers la différence, par laquelle l’étant psychique est dé-passé, la Mémoire étant le lieu de passage de l’ontique vers l’ontologique.
G. Deleuze, Le bergsonisme, Puf, Quadrige, Paris, 1963, p. 51–52 : « Il y a donc un passé en général qui n’est pas le passé particulier de tel ou tel présent, mais qui est comme un élément ontologique, un passé éternel et de tout temps, condition pour le passage de tout présent particulier »
[Note : Dans Différence et répétition, Puf, Paris, 1968, p. 111, il relève les trois paradoxes de la contemporanéité, de la coexistence et de la préexistence, qui font l’objet du chapitre III de Matière et mémoire : « chaque passé est contemporain du présent qu’il a été, tout le passé coexiste avec le présent par rapport auquel il est passé, mais l’élément pur du passé en général préexiste au présent qui passe. » Dans une parenthèse en note, il ajoute : « Sous ces trois aspects, Bergson oppose le passé pur ou pur souvenir, qui est sans avoir d’existence psychologique, à la représentation, c’est-à-dire à la réalité psychologique de l’image-souvenir. » Il y a donc autre chose dans la durée qu’une conscience intime du temps et qu’un rapport de succession entre un présent actuel (ce qui est) et un ancien présent (ce qui n’est plus).]
Dans son effort pour rétablir un sens verbal de l’être contre sa compréhension substantiviste, Bergson est donc conduit à penser dans le pli de l’être. Il n’est dès lors pas excessif de faire correspondre le problème de la différenciation entre l’étendue et la durée correspond à la fois à la question heideggérienne de la différence de l’être et de l’étant et à une transfiguration de la distinction ontique traditionnelle : l’étant qui nomme la matière ainsi que la conscience psychologique comme présences actuelles, et l’être comme totalité virtuelle de la Mémoire. Il faudrait donc, avec la notion de « virtuel », penser l’esprit au-delà de l’étant-présent ou du psychologique, en définir la texture propre sans la rapporter à l’âme ou au corps. Car, qu’on l’aborde sous l’angle psychologisant ou bien physio-cérébral, la pensée échoue dans le présent, c’est-à-dire dans une modalité ontique, et elle est réduite à la fonction de représentation.
Par conséquent, s’il est vrai que toute l’histoire de la philosophie se caractérise par le privilège octroyé au présent, on ne saurait en dire autant de Bergson. Dans une « note » qu’il consacre à la note de Sein und Zeit où ce dernier est situé par Heidegger dans le prolongement d’Aristote et de Hegel, Derrida écrit :
« De Parménide à Husserl, le privilège du présent n’a jamais été mis en question. Il n’a pu l’être. Il est l’évidence même et aucune pensée ne semble possible hors de son élément » (J. Derrida, « ousia et grammà, note sur une note de Sein und Zeit », in Marges de la philosophie, éd. de Minuit, Paris, 1972, p. 36.)
Peut-on inclure Bergson dans cette lignée en sachant que pour lui le présent est précisément le signe que l’espace a envahi le temps, que l’ampleur virtuelle du passé s’est rétractée à la pointe de l’actualité ? Si tout le §32 du Kantbuch vise à libérer l’intuition kantienne de ce privilège du présent, en ce qu’elle n’est pas ordonnée à la réception d’un objet, c’est dans la mesure où elle enveloppe déjà en elle-même la différence du sensible et de l’intelligible, de la réceptivité et de la spontanéité, autrement dit dans la mesure où elle est imagination transcendantale.
[Cf. Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, trad. A. de Waelhens et W. Biemel, Gallimard, Tel, Paris, 1953 (noté KPM), p. 229 : « Nous découvrons à présent plus concrètement pourquoi et comment l’intuition pure, dont traite l’esthétique transcendantale, se refuse d’emblée à être l’acte réceptif d’un [réel] ‘’présent’’. L’intuition pure qui, comme réception se donne à elle-même [son objet], ne peut absolument pas être relative à quelque présence, et encore moins à un étant donné. »]
Cette source commune devant laquelle Kant a reculé entre les deux éditions de sa première Critique ne serait rien d’autre que le temps originel « qui fait surgir le temps comme succession des maintenant » (KPM, p. 231). C’est la trace de cette différance originaire qu’on retrouve chez Bergson au niveau du problème de l’union de l’âme et du corps comme lieu de contraction de l’étendue et de dilatation de la durée. Il y aurait dès lors dans la durée elle-même une temporalité encore plus originaire que celle qui est opposée au temps spatial en tant que temps psychologique.
En prouvant la réalité de l’âme et celle du corps, Bergson fait en même temps sauter toute distinction ontique entre les deux termes sans besoin de recourir à la négativité de la dialectique pour fondre des contraires dans l’homogénéité de l’actuellement présent. Il lui suffisait pour cela de suivre la positivité des lignes virtuelles dans leur mouvement de différenciation à partir duquel surgissent l’étendue et l’inétendu.
[NOTE : il apparaît que cette opposition, dont J. Sallis nous dit qu’elle ne peut être surmontée est bien plutôt transfigurée dans le rapport de l’espace et du temps : « Le fait de se détourner de la distinction traditionnelle entre le sensible et l’intelligible a le caractère d’une Aufhebung, car cette distinction est insuppressible et toujours déjà invoquée à nouveau dans le discours même qui voudrait la bannir. » Cette phrase tirée de The Gathering of Reason, Ohio University Press, Ohio, 1980, est citée et traduite par F. Dastur dans son opuscule Dire le temps, encre marine, La Versanne, 1994, p. 89, 26n]
Matière et Mémoire pourrait dès lors se lire comme le lieu de surmontement du nihilisme métaphysique pour lequel il ne restait plus après Platon et Nietzsche qu’à soutenir la double négation : « ni esprit, ni corps ». En brisant le cercle du dogmatisme, de l’empirisme et du criticisme, Bergson chercherait à mettre un terme à l’errance de la métaphysique et à surmonter la différence autrement plus impérieuse dans la modernité entre objet et sujet avec la découverte d’un champ transcendantal impersonnel et a-subjectif (Cf. Annales bergsoniennes, I, op. cit., p. 83-86). Telle est la thèse que V. Goldschmit et Deleuze tirent de leur lecture de Matière et mémoire. On ne saurait lui opposer avec J-L. Vieillard-Baron le caractère exclusivement personnel et subjectif de la mémoire, sans réduire celle-ci à une faculté de re-présentation.
[NOTE : Cf. J-L. Vieillard-Baron, l’introduction à Bergson, la durée et la nature, Puf, coll. débats philosophiques, Paris, 2004, p. 16-17. Le problème vient de ce que l’auteur « considère l’interprétation de Deleuze comme ‘’structuraliste’’, et donc à cent lieues du vrai Bergson. » Outre qu’il n’est pas interdit au structuralisme de comprendre Bergson, on peut mettre en doute le préjugé qui consiste à penser qu’il existe un vrai Bergson – comme si le vrai Bergson consistait en une forme figée et immuable dans laquelle il ne reste à ses commentateurs qu’à y puiser la lettre ; comme si le vrai Bergson ne devait pas aussi continuer ses effets dans une interprétation créatrice de ses textes par des successeurs originaux. N’est-ce pas le principe même de l’« esprit » d’un philosophe, ou si l’on préfère, de son intuition fondamentale qui traverse le temps et demeure comme ce qu’il y a de durable (et non pas d’éternel) dans son œuvre ?]
En effet, en montrant que la réalité de la matière est coextensive à notre perception, et que celle de l’esprit est identique à la totalité du passé, Bergson parvient à penser l’âme par-delà toute psychologie personnaliste et anthropologique (cf. Matière et mémoire, noté MM, in Oeuvres, op. cit., p. 321/ 205 : « Mais il y aurait une dernière entreprise à tenter. Ce serait d’aller chercher l’expérience à sa source, ou plutôt au-dessus de ce tournant décisif où, s’infléchissant dans le sens de notre utilité, elle devient proprement l’expérience humaine. ») La mémoire-contraction et la perception intelligente définissent le rapport ontique de présentification au psychique et à la matérialité, alors que la mémoire-souvenir enracinée dans les ténèbres du virtuel exige le saut dans le passé ontologique. Nous voyons bien dès lors comment l’affirmation d’une différence ontologique entre passé et présent ouvre la voie chez Bergson vers une ontologie de la différence.
[NOTE : on ne finira pas de tirer toutes les implications d’une pensée de la différence dans un monde livré à l’uniformisation et à l’homogénéisation et dont le mouvement unique produit par là même des îlots idéologiques qui font de l’identité une revendication, sinon une arme politique – comme en témoigne le débat sur l’identité nationale en France ou les revendications identitaires dans un monde où l’individu cherche à se faire reconnaître en fonction de son appartenance à un groupe.]
Lorsque chez le « deuxième » Heidegger, la différence ontologique se retrouvera transfigurée dans la « Dimension » – celle en laquelle la terre et le ciel se manifestent comme les guises du cadran de l’espace-du-temps et du temps-de-l’espace, c’est-à-dire comme Jeu du monde – elle se figure alors dans la biffure du mot « Être », stratagème scriptural à même de signifier le mouvement de retrait de la présence. Est-ce un hasard si Heidegger finit alors par retrouver l’unité d’un durer (Währen quoique ce ne soit pas la Dauer) et de l’étendue dont l’ampleur donne le monde comme totalité ouverte en laquelle l’existence mortelle chemine entre la naissance et la mort, dans sa relation au divin et à son retrait ?