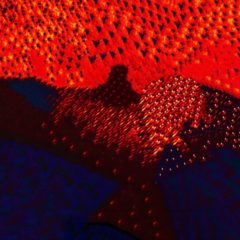De la psychologie à la métaphysique
Le second chapitre de l’Essai sur les données immédiates de la conscience constitue la jonction entre la critique de la notion d’intensité psychologique et la question de la liberté, laquelle est liée, comme l’indique le titre du chapitre, au problème de « l’organisation des états de conscience ». Avant d’engager une explicitation du mode d’être de l’esprit selon la liberté, Bergson a dû en premier lieu écarter le faux problème des grandeurs intensives puis établir la nature de la conscience comme durée. Dans le premier chapitre, divers états psychologiques auxquels s’applique la notion d’intensité ont été considérés isolément : les sentiments profonds, les sentiments esthétiques, l’effort musculaire, l’attention, les émotions violentes, les sensations affectives et représentatives, de son, de poids et de lumière. Avec l’introduction de l’idée de durée, il s’agit plutôt d’éclairer la conscience comme totalité concrète. Il n’est plus question de traiter des « états psychologiques » mais de « la multiplicité des états de conscience » selon les deux niveaux de la surface et de la profondeur : le moi superficiel qui se représente dans l’espace, où chacune de ses parties se distingue des autres selon une extériorité réciproque, et le moi fondamental qui vit dans la pure durée, où ses éléments constitutifs se fondent les uns dans les autres.
La place centrale de la durée tient ainsi la structure d’ensemble d’un ouvrage savamment ficelé pour accomplir le passage de la psychologie à la métaphysique. Dès l’introduction de l’Essai, Bergson nous prévient que le problème de la liberté a été choisi parce qu’il se pose à fois en métaphysique et en psychologie. Or, ces deux disciplines ont tendance à se contredire dans la mesure où leurs intérêts divergent. En renvoyant dos à dos les déterministes et les partisans du libre-arbitre, Bergson veut surmonter l’opposition entre science et philosophie, puisqu’il s’agit de montrer qu’on peut connaître avec précision les faits de conscience sans sacrifier la liberté, et qu’on peut à l’inverse affirmer la liberté de l’esprit sans pour autant renoncer à la connaissance positive. Pour l’associationnisme qui considère les différents moments de la vie psychique comme étant extérieurement liés, toute action serait l’effet d’une nécessité mécanique. Mais, en réduisant la liberté au choix entre des possibles extérieurs au moi qui se les représente, les philosophes du libre-arbitre échouent à penser la création libre du possible dans la dynamique interne de la conscience. Que la conscience dure, il ne s’agit pas là d’une hypothèse dont on aurait à vérifier l’application à un problème métaphysique particulier, mais bien d’un fait – d’une donnée immédiate qu’il est impossible aussi bien au savant qu’au philosophe de ne pas reconnaître.
Si la région psychique constitue le domaine thématique de la recherche, l’enjeu en est donc la reformulation du problème de la liberté selon la durée. Que la solution d’un tel problème dépende d’une juste compréhension du temps, voilà qui peut à première vue sembler étonnant. C’est pourtant cette compréhension qui a manqué à toute la tradition qui mêlait plus ou moins confusément ces deux notions sans jamais thématiser de manière expresse leur rapport. Pendant que nous choisissons, le temps ne poursuit-il pas son cours, nous poussant dans l’urgence, parfois nous retenant, ou alors à l’inverse rendant obsolètes certains de nos choix ou encore nous faisant regretter nos indécisions ? Il suffit de penser au fondement « kairologique » de l’action avec l’importance du moment opportun (kairos) dans la décision pratique chez Aristote. Le temps de la délibération sert à retarder l’agir, freinant ainsi l’automatisme d’une réaction instantanée par rapport aux excitations reçues. Non seulement la conscience est capable d’attendre avant d’agir, elle fait du coup augmenter la part d’imprévisibilité du réel. Une action est d’autant plus libre qu’elle met en échec toute tentative de la déduire de tout ce qui la précède. L’indétermination de l’avenir est essentielle pour affirmer la liberté, et c’est pourquoi ses adversaires ont besoin plus que tout de démontrer la nécessité du cours des choses, supprimant par là une dimension fondamentale du temps : l’avenir. Mais, en considérant d’un point de vue rétrospectif l’action comme déjà accomplie et non du point de vue de son accomplissement, en définissant la liberté comme un tranchement entre des possibles prédonnés, les défenseurs du libre-arbitre eux-mêmes donnent raison aux déterministes. Le mouvement rétrograde du vrai que Bergson décrit dans La Pensée et le Mouvant comme le mirage du présent dans le passé ne concerne pas seulement les événement qui ont déjà eu lieu. Il s’illustre également dans le problème logique des futurs contingents : il est impossible pour ce qui va arriver de ne pas arriver, s’il est vrai que cela va arriver. En vertu de la vérité ou de la fausseté des énoncés portant sur le futur, tout ce qui arrive est prédéterminé. La bataille aura lieu demain parce que la valeur de vérité de cette proposition ne peut changer dans le temps. On nie ainsi la liberté au nom d’une pseudo-éternité de la vérité. Mais, et c’est tout le sens de la position bergsonienne, rien n’est changé à la posture fondamentale de cette thèse si on remplace la nécessité logique par la possibilité : en disant la bataille une fois réalisée aurait pu ne pas se produire, on pense qu’elle devait préexister à sa réalisation à titre de possible. Pour Leibniz, qui distingue vérités de fait contingentes et vérités de raison nécessaires, s’il n’est pas contradictoire qu’Adam n’ait pas péché, cela est du moins nécessité par l’exigence morale de compossibilité qui assure, grâce au calcul infini de Dieu, l’existence du meilleur des mondes possibles, celui qui comprend l’Adam pécheur. Mais celui-ci aurait pu, si néanmoins il avait existé dans un autre monde, ne pas pécher. Si la liberté est maintenue par Leibniz, c’est parce qu’une autre action demeure possible quoiqu’elle soit actuellement incompossible avec la totalité des actions du monde existant. Dans ce développement prédéterminé des possibles, le temps joue le rôle d’un ordre de succession pour tous les changements dont s’aperçoit la substance.
Si Leibniz prépare la définition kantienne du temps comme forme de l’intuition, le philosophe critique va en revanche devoir affirmer le sens cosmologique de la liberté qui le conduit d’abord à penser celle-ci sur le modèle d’un surgissement spontané, d’un événement qui bouleverse le cours ordonné causalement du temps. La liberté introduit une brèche dans le déterminisme qui caractérise la succession objective des phénomènes physiques et menace par là tout le système, dont elle est censée être la clef de voûte. La célèbre solution kantienne est de séparer temps et liberté, de leur imposer le khôrismos, et de se faciliter pour ainsi dire la tâche en concluant que le temps ne joue que dans l’ordre phénoménal alors que la liberté appartiendrait au monde nouménal. De cette liberté nous n’avons aucune intuition qui permette de l’appréhender dans le cadre de l’espace et du temps, ce qui rend impossible de la démontrer ou alors de la nier, mais (et voilà la ruse insupportable et géniale du kantisme) rien n’interdit de la postuler. Au final, la liberté ne s’éprouve-t-elle pas comme le besoin propre d’une raison devenue majeure et qui ne peut supporter l’asservissement et la tyrannie ? Bien qu’atemporelle, elle doit donc se conquérir dans une histoire, quand elle n’est pas ce qui fait l’Histoire : celle précisément dans laquelle, il devient possible pour Hegel d’assister à la venue à soi de l’esprit absolu. Selon la perspective de l’« historidicée », le temps figure un lieu de chute où l’esprit tombe pour endurer la souffrance infinie de son enfantement. C’est un facteur de déchirement, un principe de séparation dont la venue à bout finale se confondrait alors à la fois avec la conquête pleine de la liberté et avec la fin de l’Histoire.
Pour conclure, on peut dire que les Mégariques suppriment temps et liberté, Leibniz les relativise, Kant les sépare et Hegel les confronte. Seul Aristote a peut-être pu penser l’heureuse rencontre du temps et de la liberté, si seulement les efforts de l’agent ne devaient pas compenser la contingence du monde sublunaire, c’est-à-dire une fois encore, compromettre le temporel en prenant pour modèle l’éternité du premier moteur immobile. Quoiqu’il en soit, ces diverses problématiques signalent un lien traditionnel constant entre les deux ordres de questions. Mais tout se passe comme si le nœud de la difficulté était d’admettre et de concilier deux concepts opposés. Pour Bergson, il n’est besoin d’aucune tentative dialectique pour penser le rapport du temps et de la liberté, car la liberté est la ratio cognoscendi de la durée et la durée est la ratio essendi de la liberté. Lorsque la traduction anglaise du titre par Time and Freewill (ou allemande par Zeit und Freiheit) pose ensemble les deux concepts, il s’agit tout comme pour cet autre titre qu’est Être et Temps, de signaler une conjonction structurelle : la liberté doit être ressaisie dans et à travers la durée. Toutes les autres tentatives conduisent soit à des impasses par où la liberté est niée, soit à une mécompréhension de son essence. D’où la nécessité de dépasser l’idée traditionnelle qu’on se fait du temps comme d’un temps qui ne passe pas au profit de l’idée de durée hétérogène et continue, pour, en contrecoup, délivrer le vrai concept de liberté – celui qui la définit comme une action créatrice à la fois de possibilités et de réalité et non pas comme une simple faculté de choix.
Le retour à la conscience immédiate souligne l’échec de la physique mathématique à rendre compte du temps réel et de toute tentative de démontrer la liberté. On peut tout au plus la montrer, la saisir dans son accomplissement. Parce qu’on ne peut prévoir un acte libre ni l’expliquer rétrospectivement par des raisons après coup, c’est par l’action seulement que je connais ma liberté, que je prends conscience d’un agir retardé et qui tranche par sa nouveauté sur ce qui précède. Tardive et nouvelle, l’action libre se constate lorsque le moi se laisse aller, c’est-à-dire laisse faire le temps. Or, la conscience retrouve sa durée propre pour peu qu’elle se laisse aller, comme dans le rêve ou dans l’écoute d’une mélodie enivrante. « La vraie durée, celle que la conscience perçoit » (DI, p. 113/ 129) est obtenue dans sa « pureté originelle » (DI, p. 85/ 96) lors des vacillements de la conscience où nous sentons la durée comme une qualité (DI, p. 120/ 137). C’est justement cette différence entre l’état psychologique réfléchi et l’état naïf qui permet de voir la vraie liberté :
« Je crois que nous nous sentons libres, mais que nous nous voyons nécessités, par la raison très simple que la conscience réfléchie n’atteint que le ‘‘tout fait’’, et par conséquent le déterminé, tandis que le sentiment immédiat et inexprimable, nous donne ce qui est entrain de se faire […] c’est dans l’action se faisant, et non pas faite, que réside la liberté. » (DI, p. 87/ 98.)
Puisque la durée est au principe même de ce qui se fait, elle seule permet de trouver la liberté. Le temps et la liberté doivent être fondés sur le sentiment immédiat que nous en avons, avant toute théorisation par la conscience réfléchie. Celle-ci se révèle inapte à penser le temps comme la maturation de la conscience, et cette maturation comme acheminement vers sa liberté.
« Le moi, infaillible dans ses constatations immédiates, se sent libre et le déclare ; mais dès qu’il cherche à s’expliquer sa liberté, il ne s’aperçoit plus que par une espèce de réfraction à travers l’espace. » (DI, p. 71/ 79).
C’est une véritable entreprise de libération que propose Bergson, dans laquelle il s’agit de surmonter « l’écrasement de la conscience immédiate » (Ibid.) Il y a en effet quelque chose de dramatique dans cette invasion de l’espace dans la durée, puisque les spatialisations nous rendent incapable d’actes libres. Le plus souvent nous vivons à l’extérieur de nous-mêmes, nous ne laissons pas nos résolutions mûrir pour se détacher de nous. Lorsqu’on prétend penser la durée de l’âme sur le modèle de l’intratemporalité des choses extérieures, là où le temps constitue un milieu homogène dans lequel tout semble traîner comme dans un espace indifférent à son essence, on échoue à penser sa causalité propre. On pose pour la causalité psychologique et la causalité physique une même forme de légalité réglant de part et d’autre des rapports uniformes de successions. Or, tandis que l’esprit peut tirer de lui-même plus que ce qu’il n’a, un effet physique ne rajoute rien de plus à la cause. Dans ce dernier cas, le rapport de causalité est celui d’une identité, tandis que dans le domaine psychologique, le moi et sa vie sont affiliés : l’effet ressemble à sa cause. La distinction entre poéisis et praxis, entre l’action dont l’effet est extérieur à son agent et celle où il lui est intérieur, n’a plus de sens ici :
« Bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu’on trouve parfois entre l’œuvre et l’artiste » (DI, p.113/129).
La ressemblance n’est pas extérieure aux termes qu’elle relie, elle surgit à même eux. C’est pourquoi l’apparente prévisibilité de mes actions ne tient qu’à ce même air de famille qu’elles comportent avec moi et entre elles. Un acte est libre en tant qu’il est l’expression d’une singularité originale. De fait, s’il est très rare de trouver une existence qui soit authentiquement libre c’est parce que nous ne sommes pas toujours au contact de nous-mêmes et que la plupart de nos décisions ne viennent pas de notre fond : nous nous conformons le plus souvent à ce qu’on veut pour nous. Il faut donc retourner par « un effort vigoureux d’analyse » au-dessous des strates superficielles de notre moi qui s’y accumulent dans la vie en société « pour retrouver ce moi fondamental, tel qu’une conscience inaltérée l’apercevrait (Correspondance, p. 98). »