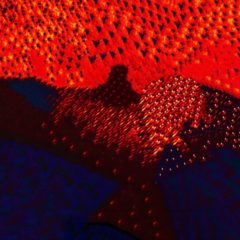Dans le texte « Des espaces autres », Michel Foucault écrit : « L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace[1]. » Que pourrait bien être une époque de l’espace sans l’époqualité en sa dimension temporelle ? S’agit-il d’une fixation et d’une immobilité qui ferait de notre époque un point de stagnation ? Loin de là. La question des espaces aura entraîné au cours de la seconde moitié du vingtième siècle une mobilité créatrice faisant de l’espace un lieu de mutations avec des enjeux scientifiques, littéraires, artistiques, politiques. L’espace ne peut plus être appréhendé comme une simple forme de l’intuition ou encore comme le contenant géant des choses. Dans ses plis, il détermine les circulations de la pensée, reconduisant celle-ci dans l’indécision des distinctions nettes et tranchées. L’espace devient un concept opératoire et méthodique chez les penseurs de la différence.
Dans le texte « Des espaces autres », Michel Foucault écrit : « L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace[1]. » Que pourrait bien être une époque de l’espace sans l’époqualité en sa dimension temporelle ? S’agit-il d’une fixation et d’une immobilité qui ferait de notre époque un point de stagnation ? Loin de là. La question des espaces aura entraîné au cours de la seconde moitié du vingtième siècle une mobilité créatrice faisant de l’espace un lieu de mutations avec des enjeux scientifiques, littéraires, artistiques, politiques. L’espace ne peut plus être appréhendé comme une simple forme de l’intuition ou encore comme le contenant géant des choses. Dans ses plis, il détermine les circulations de la pensée, reconduisant celle-ci dans l’indécision des distinctions nettes et tranchées. L’espace devient un concept opératoire et méthodique chez les penseurs de la différence.
En poursuivant l’entreprise heideggérienne de déconstruction de la métaphysique, Jacques Derrida inscrit la spatialité au coeur du concept temporel de la différance (au sens du différer) :
« La différance, c’est le jeu systématique des différences, des traces de différences, de l’espacement par lequel les éléments se rapportent les uns aux autres. Cet espacement est la production, à la fois active et passive (le a de la différence indique cette indécision par rapport à l’activité et à la passivité, ce qui ne se laisse pas encore commander et distribuer par cette opposition), des intervalles sans lesquels les termes « pleins » ne signifieraient pas, ne fonctionneraient pas. C’est aussi le devenir-espace de la chaîne parlée – qu’on a dite temporelle et linéaire ; devenir-espace qui seul rend possibles l’écriture et toute correspondance entre la parole et l’écriture, tout passage de l’une à l’autre. (…) L’activité ou la productivité connotées par le a de la différance renvoient au mouvement génératif dans le jeu des différences. Celles-ci ne sont pas tombées du ciel et elles ne sont pas inscrites une fois pour toutes dans un système clos, dans une structure statique qu’une opération synchronique et taxinomique pourrait épuiser. Les différences sont les effets des transformations et de ce point de vue le thème de la différance est incompatible avec le motif statique, synchronique, taxinomique, anhistorique, etc., du concept de structure. Mais il va de soi que ce motif n’est pas le seul à définir la structure et que la production des différences, la différance, n’est pas a-structurale : elle produit des transformations systématiques et réglées pouvant, jusqu’à un certain point, donner lieu à une science structurale. Le concept de différance développe même les exigences principielles les plus légitimes du « structuralisme ». […] Rien – aucun étant présent et in-différent – ne précède donc la différance et l’espacement. Il n’y a pas de sujet qui soit agent, auteur et maître de la différance et auquel celle-ci surviendrait éventuellement et empiriquement. La subjectivité – comme l’objectivité – est un effet de différance, un effet inscrit dans un système de différance. C’est pourquoi le a de la différance rappelle aussi que l’espacement est temporisation, détour, délai par lequel l’intuition, la perception, la consommation, en un mot le rapport au présent, la référence à une réalité présente, à un étant, sont toujours différés. Différés en raison même du principe de différence qui veut qu’un élément ne fonctionne et ne signifie, ne prenne ou ne donne « sens » qu’en renvoyant à un autre élément passé ou à venir, dans une économie des traces. »[2].
 Dans Khôra, Derrida cherche à lire les grandes oppositions métaphysiques comme pré-inscrites dans un espace vide qui n’est pas le vide, mais ouverture, béance, abîme ou chasme en lequel le clivage entre sensible/intelligible est venu dès l’antiquité prendre lieu[3]. Pour Heidegger cette béance signifie la décision initiale qui aura donné son coup d’envoi à la métaphysique :
Dans Khôra, Derrida cherche à lire les grandes oppositions métaphysiques comme pré-inscrites dans un espace vide qui n’est pas le vide, mais ouverture, béance, abîme ou chasme en lequel le clivage entre sensible/intelligible est venu dès l’antiquité prendre lieu[3]. Pour Heidegger cette béance signifie la décision initiale qui aura donné son coup d’envoi à la métaphysique :
« C’est Platon qui donne l’interprétation déterminante pour la pensée occidentale. Il dit qu’entre l’étant et l’être il y a le khôrismos : khôra signifie l’endroit (Ort). Platon veut dire que l’étant et l’être sont en des endroits différents. L’étant et l’être sont différemment mis à l’endroit (sind verschieden geortet). Si donc Platon considère le khôrismos, la différence d’endroit de l’être et de l’étant, il pose alors la question du tout autre endroit (nach dem ganz anderen Ort) de l’Être, par comparaison avec celui de l’étant[4]. »
 Dans son Introduction à la Métaphysique, Heidegger se réfère à la khôra platonicienne pour montrer que dans l’interprétation platonicienne de l’être comme idea « se prépare[5] » une mutation de khôra et topos en extension. Comment khôra se transforme-t-elle en extensio ? Ce qui nommait une différence ontologique vient finalement à nommer une multiplicité quantitative ouvrant l’Idea à l’espace de la représentation de la subjectivité moderne. Derrida l’accusera de céder à une projection rétrospective anachronique[6] et ce geste lui paraît significatif pour l’ensemble du questionnement heideggérien de l’histoire de la philosophie. Ce serait la structure même de la khôra qui aurait prédéterminé ses interprétations, faisant d’elle « l’anachronie de l’être[7] ».
Dans son Introduction à la Métaphysique, Heidegger se réfère à la khôra platonicienne pour montrer que dans l’interprétation platonicienne de l’être comme idea « se prépare[5] » une mutation de khôra et topos en extension. Comment khôra se transforme-t-elle en extensio ? Ce qui nommait une différence ontologique vient finalement à nommer une multiplicité quantitative ouvrant l’Idea à l’espace de la représentation de la subjectivité moderne. Derrida l’accusera de céder à une projection rétrospective anachronique[6] et ce geste lui paraît significatif pour l’ensemble du questionnement heideggérien de l’histoire de la philosophie. Ce serait la structure même de la khôra qui aurait prédéterminé ses interprétations, faisant d’elle « l’anachronie de l’être[7] ».
Opérant la séparation des concepts, l’espace apparaît comme inséparable du destin de la pensée.
« Et si l’espace est dans le langage d’aujourd’hui la plus obsédante des métaphores, ce n’est pas qu’il offre désormais le seul recours, mais c’est dans l’espace que le langage d’entrée de jeu se déploie, glisse sur lui-même, détermine ses choix, dessines ses figures et ses translations. C’est en lui qu’il se transporte, que son être même se métaphorise[8]. »
Heidegger nous rappelle que les Anciens n’avaient pas de mot pour dire « espace » mais aussi qu’ils n’en avaient pas non plus pour dire « langage ». Tópos et lógos appellent cependant chacun un type de question spécifique : la question « où ? » (pou) et la question « ti esti ? » qu’une pensée topologique rapporte l’une à l’autre alors qu’elles avaient été hiérarchisées par Aristote, le « pou ? » comme étant la question de l’accident subordonnée à la question de l’essence, « ti esti ? ». La topologie vise ainsi la multidimensionnalité de l’être dans le jeu des différances et ne saurait dès lors nous confiner à un espace sans dedans. « L’ » espace pur apparaît comme une fiction opératoire, un idéal qui accompagne la pensée instrumentale dans son application pragmatique et technique. Mais quand bien même des espaces échapperaient à l’homogénéisation, n’est-ce pas l’espace dévasté et homogène qui a triomphé mondialement et historiquement ? La clôture du monde, le vide cosmique, l’abolition des distances, l’accélération de l’information, la victoire de la cybernétique comme technique du raccordement, l’équivalence des langues – chacune d’elles étant devenue traduisible en une autre, réductible à un code sous l’angle de la multiplicité actuelle – ces conséquences ne proviennent-elles pas historiquement de la prééminence de la re-présentation d’un espace ordonné selon la juxtaposition et la contiguïté ?
L’homme du monde technique aura déjà perdu avec l’oubli de la Dimension, depuis sa place jusqu’au sens des lieux, de l’espace essentiel, de l’emplacement et de la localité. Pourtant, tout espoir est encore permis car chaque jeu produit les conditions sous lesquelles un où et un quand deviennent possibles. S’il n’y a pas de dehors du jeu, c’est parce que le jeu lui-même produit son dehors et son dedans. De sorte qu’avec une pensée du jeu nous avons atteint une limite, celle-là même qui constitue l’horizon indépassable du penser : le monde. Et bien que le monde semble avoir perdu toute trace de l’être, celui-ci continue en tant que jeu d’avoir lieu et de donner lieu à l’époque du planétaire.
« Dans l’être planétaire, la terre est redevenue plate. Or cet écrasement des dimensions précédemment remplies par les puissances, cet aplatissement qui réduit les choses et les êtres à l’unidimensionnel, bref ce nihilisme a le plus bizarre effet, qui est de rendre les forces élémentaires à elles-mêmes dans le jeu brut de toutes leurs dimensions, de libérer ce nihil impensé dans une contre-puissance qui est celle d’un jeu multidimensionnel[9]. »
[1] Foucault, Dits et écrits IV, p. 360.
[2] Derrida, « Sémiologie et grammatologie », in Positions, éd. de Minuit, Paris, 1967, p. 38-39.
[3] Derrida, Khôra, Galilée, Paris, 1993, p. 45.
[4] Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ?, p. 261.
[5] Heidegger, Introduction à la Métaphysique, p. 76-77.
[6] Khôra, op. cit., p. 24.
[7] Ibid., p. 25.
[8] M. Foucault, « Le Langage de l’espace », in Critique, n°203, avril 1964.
[9] Deleuze, « Faille et feux locaux » in L’île déserte, op. cit., p. 224.