- I. Приходящее
То, что приходит — так названа книга Костаса Акселоса[a], появившаяся в печати в 2009-м году. Так же назван сборник бесед с Француазой Дастюр, Мыслить то, что приходит[b], вышедший в 2014-м. Похоже, что после Хайдеггера мышлению предписано открыться некоему нечто, что приходит : при некоторых особых обстоятельствах места и времени. Как уточняет Акселос, речь идёт о том, чтобы помыслить не прихождение[c] как таковое вообще, но лишь то, что приходит. Это всякий раз есть нечто неуловимое: парадокс мышления, которое силится высказать то, что уходит от его хватки; шаткое мышление, суть которого — брести навстречу тому, что может разве только на неё не явиться, мышление, граничащее если не с невозможностью сказать и сделать, то по крайней мере с немалым затруднением развернуть теоретическое вопрошание или выдвинуть практическое решение. Нельзя сказать, к примеру, о рождении и смерти, будто бы они суть происшествия[d], которые случаются кому-то или происходят с кем-то; и всё же рождение и смерть есть то, что заставляет нас прийти в мир от мира[e]. Прихождение именует приход к присутствию[f] и неявное явление в горизонте открытости мира.
Начавшись с психологии, феноменология предприняла далее отчасти поворот в сторону теологии, отчасти — в сторону космологии, каковая в конечном счёте куда более верна методологическому атеизму своего основателя. Феноменологии нечего было смущаться тем событием, которое заложило фундамент современности: смертью Бога. Однако, после того, как Фуко объявил конец человека, — тогда мир остался единственной из трёх метафизических идей, остался под укрытием апокалиптических рассуждений (быть может, потому что он и всегда составлял их объект?). Невзирая на своё эко-логическое, эко-политическое и эко-номическое опустошение («пустыня растёт»), мир, в котором мы обитаем, остаётся для нас непреодолимым горизонтом того, что приходит. Человеческая душа и Бог и в самом деле могли отжить своё как силы, полагающие основу опыта и ценностей, как путеводные идеалы, как высшие всеобщности или крайние устремления: это означает не то, что они отбыли и выбыли, но лишь что отныне они раскрыты как то, что они суть: позитивные реальности, партикулярии, чистые отношения, средства для сторонних целей, вариации в нашем отношении к миру. Даже сами «Я» и Бог приходят в мир(е)[g]. С этих пор нет больше зрителя κοσμοθεωρός — как то показал Мерло Понти — человека или Бога, чьё обозревающее мышление делает их способными изъять себя из Плоти[h] мира. Ни совокупность вещей, ни сумма происшествий, ни даже статичный, отдельный от вещей горизонт: мир есть прежде всего деятельный акт: мирить[i], κοσμεῖν, акт, могущий дать прийти человеку и божеству. Мир есть уникальное трансцендентальное поле (полностью бессубъектное): условия возможности пришествия реальности не конститутивны рассудку Бога или человеческого субъекта. Они не идеальны и не принадлежат «потустороннему» (Hinterwelt). И если школярная трёхчастность метафизики ставит мир в один ряд с двумя другими безусловными всеобщностями, с «Я» и Богом, то так было не всегда. Чуждое всякому эсхатологическому посылу архаическое речение, гласящее что мир сей «ни из богов никто, ни из людей не сотворил» (Гераклит, DK 30), обращается к миру как будто он не имеет ни начала, ни конца, но захвачен слаженным чередованием возгораний и угасаний: он никогда не угасает совершенно и никогда не разгорается до предела: так он мерно отбивает свою меру, μέτριον и φρόνιμον.
Как мыслить отныне это время мира, время-мир, это пространство-игры-времени (Zeit-Spiel-Raum), через которое приходит мир? Мир приходит и не перестаёт приходить, сообразно временному движению, иному чем таковое чистого становления[j] (линейное время, последовательность): сообразно одновременности прошлого, настоящего и грядущего[k] в единстве удержания[l] и порыва[m]. Скорее чем последçовательность присутствий, надлежит продумать биение Присутствия, игру утаивания и разоблачения, сокрытия и раскрытия. Это, без сомнения, то, что имеет в виду Паточка, когда в письме Роберту Кэмпбеллу от 20-го марта 1964 года она пишет: «Становление — то движение, что стоит у истока всего нашего опыта — само по себе невозможно без становления более глубокого и более начального, которое не есть движение в опыте или в мире, но становление и движения мира как такового: онтологическое становление.» То, что приходит, есть близящееся, чья сдержанность вызывает установление правления или века мира, эпоху открытия или закрытия, сокрытия и раскрытия, утаивания и разоблачения. Мир скорее порядка пришествия, чем происшествия. Тогда как единичное происшествие есть непредвиденное, которое может вдруг возникнуть в мире и, далее, рассказываться, приходящее никогда не всходит как происшествие[n]. Пришествие остаётся вне досягаемости: его нельзя произвести или же спровоцировать. Обратить внимание на то, что приходит среди происшествий, значит обратиться к тому, что случается прямо сейчас, к тому, что не почиет в уже давно содеянном, но что деятельно совершается. Даже когда происшествие уже стряслось, нечто продолжает приходить. Даже когда происшествие уже или ещё не имело места, нечто также может приходить. Зачастую происшествия заслоняют собой то, что приходит прямо сейчас: если долгое время ссылались на Алжирскую войну как на «происшествия в Алжире», то было это оттого, что не хотели признавать перестройку колониальной державы, которой была Франция. Также и известная фраза «это не бунт, это революция!» должна была указать Королю, что именно приходит прямо сейчас, что именно кроется за тревожными происшествиями и одновременно же подготовляется. Приходящее не только лишь приходит прямо сейчас, ни лишь в грядущем: оно всегда уже грядёт прямо сейчас. Гераклит называет слово τεθνεῶτες — причастие прошедшего времени (умершие) — с тем чтобы указать на смертных, как если бы смерть, что даёт нам прийти, всегда уже имела место, как та граница, от которой мы начинаем быть тем, что мы есть: сущие-в-мир(е)[o]. В росте растения, в расцветании цветка приходит также нечто от мира. Приходящее обозначает не происшествие, происходящее и проходящее в мире, но то, что, происходя из мира и к миру, даёт прийти самому миру. После Симондона, можно было бы говорить о доиндивидуальном начале (удержание, виртуальная сдержанность памяти) и трасиндивидуальной судьбе (направление порыва) всякого индивидуально сущего. Единство до- и транс- есть единство экстатической длительности[p], место прихождения мира, то откуда сущее происходит и то к чему оно всходит, всякий раз в кратком, молниеносном сверкании.
На эту космическую Временность Бергсон наводит философскую мысль: «Мы непрестанно вбираем что-то из океана жизни, в который погружены, и чувствуем, что наше существо <…> сформировались в этом океане как бы путем локального затвердения. Философия может быть только усилием к тому, чтобы вновь раствориться в целом[q].» (Во введении к Материи и памяти, Виндельбанд называет бергсоновскую метафизику метафизикой происшествия, то есть того, что не повторяется вновь. Происшествие характеризуется своей единственностью и своей невозможностью, в том смысле, что у него есть определённая дата и он не существует до неё как нечто возможное. Однако, в Бергсоне уместнее было бы увидеть именно мыслителя прихождения мира, чем становления вещей.) Интуитивная мысль, возведённая в философский метод, должна позволить нам заново найти «огонь присноживый (ἀείζωον) мерно вспыхивающий и мерно потухающий», эту «бесконечность жизни», от которой нас отвращают обыденные способы восприятия, организованные практическим разумом[r]. Именно наше восприятие кроит вещи (их материальные образы) в движущейся безмерности[s]. Открытое и его неявное явление неуловимо для концептов, предназначенных геометрическим телам. Мир, который есть Время, не есть ларь перемен: он приходит как внезапное и беспрерывное появление нечаянных новшеств. Здесь нас может кое-чему научить рассмотрение обычного стакана с подслащённой водой.
В опыте с сахаром, таящем в воде[t], Бергсон хочет показать, что в столь же замкнутой системе как та, что объединяет стакан, воду, сахар, чайную ложку и меня, изменение не сводится к перемещению частиц сахара (его распадение на молекулы), или же ещё к последовательности различных состояний (вода+сахар, затем сладкая вода). Лёгкое изменение в искусственно замкнутой системе влечёт изменение в « конкретном целом, охватывающем эту систему ». Вселенная в целом приходит и не прекращает приходить в стакане с подслащённой водой. Раскроить внутримирный процесс на фазы, затем воспроизвести и изолировать в той или иной подсистеме, — всё это заслоняет пришествие, кроющееся за таким процессом. Как бы абстрактны и замкнуты ни были те системы, что экспериментатор намерен изолировать от прочих вещей, от этого они не перестают вызывать к прихождению мир в его целости. Этот опыт показывает, очевидно, важность задержки и тот факт, что всё требует времени. Точнее сказать, нерешительность, свойственная становлению, означает что каждое происшествие взято в коренном переустройстве всего того, что не прекращает в ней своё самопроизведение. Декарт, не смогший увидеть в целом возможность создания нового (пытаясь схватить Я в мгновении и противопоставляя свои мысли и протяжённость, свободу и необходимость), помыслил всё же творение как пришествие, а не как уже произошедшее происшествие: каждый миг мир приходит, вместо того, чтобы пропадать в ничто, даже если это обязано, в конечном итоге, божьему содействию. Однако, Бог сам есть непрерывное извергание, но не вещь, то есть причина мира[u]. Он есть « центр, из которого извергаются миры, как снаряды из огромного букета», «непрерывность извергания», «непрестанная жизнь, деятельность и свобода» (3-ья глава Творческой эволюции, стр. 706/249[v]). Творение не есть происшествие, т.е. оно не влечёт онтического отношения между существующими наличными вещами: высшее сущее и прочее сущее. Как божественное у греков, это непрерывное извергание порядка пришествия (ср. Вальтер Отто, Das Wort der Antike, Штутгарт, 1962, p. 39 : « Es ereignet sich etwas »).
Кроме того, не следует воображать себе, что внутренняя мелодия сознания скроена из происшествий, разворачивающихся снаружи. Участь души (которая расцветает всецело в творческой радости и в самотворении) и судьба мира глубоко связаны. Ср. Два источника морали и религии: сознание разливается и расширяется в величайшем возбуждении. Побуждающая и заразительная радость открывает его открытому мира и бросает его в движение вперёд[w] (или в космический танец). Мистическое сознание всё заключено в ожидании того, что приходит («сосредоточенность души в ожидании трансформации[x]»). Но если материальные препятствия могут быть сняты точечно, то невозможно сказать, что они будут сняты окончательны. Ожидание становится утомлением и безнадёжность, остающаяся в сердце надежды, способна опрокинуть и разбить порыв. Отсюда мысль о спиральном движении истории и о чередования, характеризующих политические пришествия мира: общества не живут неопределённо долго в той открытости, которую сумели вызвать мистики. Они всегда кончает тем, что вновь впадают в закрытость. Даже если при этом призывы Открытого/к Открытому никогда не прекратят приходить, дабы разбить путы, держащие душу взаперти в ней самое и в её сообществе. Фигура движения судьбы мира — спираль, а не циклика, потому что речь идёт о том, чтобы помыслить постоянство возвращения и в то же время постоянство изменения: у того же самого, что возвращается, было время для того, чтобы преобразоваться. Как уже замечал Бадью по поводу истории Франции, за революционной эпохой всегда следует реакционный период. (Далеко от того, чтобы подтверждать это положение дел, политическое чередование двухпартийности, к которой нас приучили в Европе представительные демократии, есть лишь иллюзия чередования, тогда как чередование только ещё подготовляется — пусть и под знаком грядущего худшего, к примеру, фашиствующей смены).
Нет истории-катастрофы, ни истории-прогресса, которые могли бы быть усмотрены в происшествиях. Зато есть чередование открытости и закрытости, мрачных периодов, которые оборачиваются просветами, и наоборот. Мы снова сталкиваемся с гераклитовским ритмом (возгораний и угасаний), с этим ῥυθμός, что есть не просто ῥοή становления, но σφυγμός прихождения, не протекание но пульсация того, что никогда не приходит полностью и не никогда не исчезает совершенно. Биение сокрытия и раскрытия, присвоения (Ereignis) и отчуждения (Enteignis). То, что мы называем пришествие, есть то обращение, которым сокрытие и раскрытие превращаются всякий раз один в пользу другого, биение, которое заставляет нас переходить от одного к другому.
- II. Время и αἰδώς
В греческом мифе можно найти, следуя эллинисту Жан-Жаку Альриви, две альтернативные модели временности (которые несводимы к простому противопоставлению исторического и природного времени):
- История происшествий, следующих друг за другом начиная с первоначального падения — у Гесиода
- Время пришествия биения, в котором приходящее не может быть взято в обобщающем смысле — у Пиндара
Следующее краткое изложение является частью более широкой работы, которую мы ведём с Ж.‑Ж. Альриви и которая касается вопрос об Αἰδώς. Я обязан ему кропотливой интерпретацией греческих текстов.
а. Историческое время (Гесиод)
Всё начинается в то время, когда «боги с людьми препирались в Меконе[y]». Боги и люди улаживали свои разногласия. Однако, их делёж (κρίσις) был произведён не на справедливых основаниях вследствие хитрости Прометея, который раздал людям часть жертвенного быка, предназначенного богам (Теогония, стих 535 и далее), причём последним достались лишь кости, прикрытые жиром. Тогда Зевс покарал человека (в мужском роде), низвергнув его в Историю, отмеченную двойной «катастрофой»: разницей полов и борьбой за жизнь, ведомой в труде. Далее следует описание человеческого жития, которое разделено в Трудах и днях на пять клонящихся к закату модусов истории, которая сама, в своей целости, устремлена к финальной катастрофе. Мы принадлежим пятому веку, железному, конец которого Гесиод видит в безраздельном царствовании зла и страданий (Труды и дни, стихи 199-201). Нынешняя эпоха существования мира достигнет поэтому своего полного заката, своей точки невозврата, Αἰδώς (сдержанность) и Νέμεσις (воздаяние), закутавши свои прекрасные тела в белый покров, покинут землю и оставят людей силам зла[z]. В чём смысл этого будущего? Это отбытие Αἰδώς и Νέμεσις восходит к порядку приходящего: ни прошлое, ни настоящее, ни собственного говоря грядущее, но все три сразу. Непоправимо не происшествие, точка в истории: непоправимое находится в истоке самого исторического времени, отмеченного неудачным дележом, дурной раздачей и незаслуженным воздаянием, из-за чрезмерности (ὕβρις), бесстыдства, невоздержанности, из-за этого всегда больше (πλεονεξία), которое для классической греческой мысли лежит в основании каждого конфликта. Уход Αἰδώς и Νέμεσις есть уход всего того, что удерживает общество от падения в хаос и уничтожения. Без αἰδώς ничто не остаётся на своём месте. Быть на своём месте, иметь место, это означает быть. Разгром касается множества человеческих отношений, подрывает связи, разоряет сообщество и упраздняет обычаи гостеприимства: отныне никакой близости между родителями и детьми, между хозяином и гостем, между идущим и его спутником, отныне никакой дружбы (φίλος) к брату, но презрение к близким, старики обхаживаемые грубостями, города развязывающие войну, отныне никакого почтения к богам и к данным клятвам, правильное и хорошее уничтожено, малодушные упрекают храбрых. Последствия ухода Αἰδώς становятся всё более и более тяжкими — вплоть до самого конца истории мира.
В этом бегстве, в этой оставленности священным, которой подверглось человечество, речь не идёт, таким образом, о каком-либо происшествии, чьё появление просто-напросто имело бы место посреди связующего полотна прошедших фактов. Уход двух божеств, уже всегда имевший место, обнаруживается как пришествие, дающее мифу истории её посылание (Geschick). Всё происходящее позднее, может быть понято как разворачивание того, что заключено в этом уходе: миф Истории, услышанной как целостность смысла, царящая над беспорядочными происшествиями, рассказ, имеющий начало и конец, не так важно, ведёт ли она нас к катастрофе или к прогрессу, миф, имеющий своими эпигонами Священную Историю (от первородного греха до страшного суда), Ката (вечный мир), Гегеля (абсолютный дух), Маркса (коммунизм) и т.д., но кроме того одновременно и верование в некую западную конфигурацию времени мира — планетаризация Земли есть также европеизация, т.е. поглощение целых обществ, слывущих примитивными и как будто бы оставшимися вне Истории: см. знаменитую речь Саркози (написанную Анри Гэно) в Дакаре («Чёрный человек ещё не достаточно вошёл в историю»).
Вопрос состоит в том, чтобы понять, можно ли рассматривать другую временность, которая не была бы временностью происшествий-катастроф, можно ли рассматривать другой, нежели исторический, способ проживать и мыслить время — время, не отмеченное печатью неудержимого прогресса (возрастание производящих сил) или же необратимой катастрофы, — можно ли покончить с судом истории[aa]. Короче говоря, можно ли рассматривать временность, в которой Αἰδώς не покинул Землю и где дурной делёж не был бы непоправимым и окончательным?
- b. Временность мира (Пиндар)
В курсе лекций, посвящённых Пармениду, комментируя отрывок из VII Олимпийской оды, Хайдеггер называет αἰδώς «основным словом поэзии Пиндара и, таким образом, основным словом эллинства[bb]». Он отмечает у Пиндара связь между Αἰδώς — пребывание сокрытым и несокрытым[cc] —, сокрытием (λάθα) и несокрытостью (ἀλάθεια) (стих 43 и далее). Интуиция Хайдеггера, согласно которой вопрос о сокрытии/раскрытии является первичным, оказывается подтверждена. Бытие для греков есть лишь как игра вхождения в присутствия и выхода из него. Люди, боги, земля и море вовлечены у Пиндара в эту игру. В тексте Гесиода, где боги и люди, обречённые на зевсово отмщение (труд и пол), брошены во временность, определённую способностью суждения и первоначальным падением (не бывает Истории без суждения), Αἰδώς связана с Δίκη (Справедливость) и Ἔρις (Раздор). VII Олимпийская ода Пиндара повествует о трёх сокрывающих событиях, посредством которых имеет место один и тот же негаданный переворот, вызывающий всякий раз прихождение раскрывающей благодати: раздел Землю, забвение жертвенного огня, убийство Ликимния (брата Алкмена). Напомним контекст: эпиникий воспевает победу Диагора Родосского и восходит к мифу о рождении и основании Родоса. Отметим: поэтическое сказание не довольствует лишь показанием происшествий (как то: победа атлета), чтобы предохранить их от забвения[dd]. Сама победа приходит в сказании. Поэма скорее есть осуществление приходящего, нежели чем рассказ о происшествиях.
– Пришествие 1: раздел Земли Зевсом и бессмертными. Однако, не будучи назван, здесь отсутствует Гелиос — бог, приносящий свет, в котором приходит всё приходящее. Он оказывается, таким образом, без своей доли, без наследия, без χώρα. Но он отказывает от того, чтобы Зевс затевал новый раздел, так как он видит, в своего рода пророческом откровении, как вырастает на дне морском доселе сокрытая земля: будущая Родос, невидимо приходящая. Он требует её в удел, когда та появится на свет. И вот «горние слова упали в раскрытость[ee]» — говорит поэт (сказание совершается в сокрытии как в месте своего последнего назначения). Гелиос берёт в жёны Родос и имеет от неё семь детей. Есть нечто весьма удивительное в отсутствии того, кто делает присутствующей всякую вещь, равно как и в этом пред-видении того, что ещё сокрыто, погребено под водами: Гелиос видит в собранности (как происходящее) то, что даётся обыкновенно лишь в виде последовательности происходящих явлений.
– Пришествие 2: Гелиос просит своих детей построить жертвенник на акрополе, на виду, и совершить возношение Афине. Но дети Гелиоса восходят на акрополь, забыв взять с собой семя огня. Тем не менее, они совершают жертву, и Афина шлёт им драгоценные дары: дождь из золота — золота, о котором Пиндар говорит нам в ином месте (III Олимпийская ода, 42), что он есть αἰδοιέστατος из всех даров, т.е. наиболее достойный почтения после воды — и превосходство во всяком искусстве (способность производить существования, подобные живым). Этот же отрывок про забвение огня для учреждения жертвы разбирает Хайдеггер: «В цветение и радость ввергает людей благоговейная приязнь, настраивающая в предмыслие; но иногда наплывает [никак] не обозначенное облако сокрытия и влечёт прямой путь дел в сторону, вовне обдуманно раскрытого[ff].»
– Пришествие 3: предок Диагора Тлеполем убил брата Алкмена ударом палкой оливкового дерева, и Дельфийский оракул отправил его в изгнание на Родос. Тот был там принят подобно богу (ὥσπερ θεῷ) основателю колонии и Игр[gg].
Три несправедливости, что не заканчиваются дурно — три сокрытия, приводящих к эпифании. Эти три упущения, обернувшиеся милостью, не упустили, однако, случая привести комментаторов в замешательство. Так как облако сокрытия угрожает без конца (забвение огня, непреднамеренное убийство), необходимо умолить того, кто имеет над ним относительный[hh] контроль: Зевса. Именно он может дать победителю αἰδοίαν χάριν, которая оберегает его от ὕβρις. «Но и в единое мгновение ветер встает на ветер». Перед лицом внезапных и беспрерывных появлений нечаянных новшеств, смертное существование обречено также на неизвестность, неожиданности, тревогу перед неизвестным. Необходимость видеть то, что случается прямо сейчас, то, что близится, то, что ещё удержано, то, что готовит нас к подготовляющемуся, — эта необходимость требует сдержанности, удержания. Προμαθέος αἰδώς, целомудренный стыд того, кто имеет προμήθεια. Приходящее требует предмыслия, этой Gelassenheit, которая даёт прийти тому, над чем нет никакого контроля. Предмыслие (προμάθεια) развёртывается в своём отношении к свободному биению сокрытия/раскрытия. Речь не идёт о предусмотрительности или дальновидении, которые позволили бы увидеть будущие происшествия, но о предвидении, в истоке заботы, внимания и попечения по отношению к Богам, к уязвимым, к странникам. Отношение к тому, что приходит, есть отношение к существенному. Чтить своё слово и свой долг — вот проявление προμάθεια. Эта последняя восходит к памяти, равно как к наброску. Предмыслие вспоминает о себе самом. Каковы бы ни были обстоятельства будущего, я сделаю всё, чтобы не забыть мой обет. Есть и некоторая шаткость человеческой αἰδώς (шаткость, о которой уже в некотором смысле свидетельствует воля исполнить обет), потому что ошибки (ἀμπλακίαι) парят (κρέμανται) над умами (φρασίν) (стих 24) и даже у такого мудреца (σοφόν), как Тлеполем, сознание (φρένες) может затуманено тревожной растерянностью (ταραχαί) (стих 31). Можно вспомнить, например, о странной ситуации с Хайдеггером и нацизмом. Есть нечто, что смущает сознание человека, сбивая его с верного пути. Пиндар не говорит, что сознание сходит с правого пути: сознание не является причиной собственной потерянности. Упущения не совершаются «по ошибке» сознания, поскольку то якобы представляет собой морального агента, ответственного за свои поступки. Скорее, люди оказываются всякий раз жертвами собственных упущений. Нераскрываемой облако сокрытия обрушивается на людей, унесённых ветрами, отнюдь не попутными (ср. XI Нимейская ода, стих 47 и далее), но приносящими смятение в их умы и затуманивая правый путь. «Ошибка» у греков эпохи Архаики восходит к λαθεῖν , к сокрытию. Сокрытие не то же самое, что ошибка (faute, fallere: падение): речь о совершенно ином опыте этики как способа быть. Для нас, проникнутых христианским вероучением, трагический герой несёт вину за злодеяние. Эдипа уличают в том, что он убил своего отца и женился на собственной матери. В сущности же, для греков дело идёт о сокрытии. Отношение, связывающее Эдипа с его родителями, не было для него отрыто. Эдип движется в облаке. Жениться на матери и убить отца — это происходит не по его ошибке: в этом являет свою волю судьба. То же, что действительно является преступлением Эдипа и в чём его можно было бы обвинить, то, в чём он нарушает меру, — это его уверенность, что он способен рассеять облако или же вновь погрузиться в него по собственному хотению. Наконец, и это кульминация его преступления, он выкалывает себе глаза, ибо, движимый стыдом, не желает предстать всеобщему взору (как учит нас Хайдеггер, предстать взору — это определяющая черта греческого бытия). Чрезмерность Эдипа в том, что он тщится совладать с сокрытием, после попытки спровоцировать раскрытие. Однако, человек имеет над одним не больше власти, чем над другим.
Надлежит помыслить сокрытие как другую сторону раскрытия. Αἰδώς, стыдливое удержание, требуется о человека для того, чтобы он мог отнести себя к сдержанности сокрытия, на основании которого имеет место всякое раскрытие. Мощь сокрытия такова, что оно всегда может принудить к себе: это объясняет, например, то, что мудрец Тлеполем мог сбиться с пути настолько, что убил насмерть брата Алкмена, ударив того палкой оливкового дерева. Это объясняет также, как образом сокрытие, являющее себя сперва как упущение, может затем обернуться, трижды, раскрывающей милостью[ii]. Нет никакой возможности знать, как развернётся положение дел, когда на нас обрушится облако, ни то, как и когда оно минет. Это обращение упущений в милость и благодать свидетельствуют о биении сокрытия/раскрытия, посредством которого приходит мир и целость игры которого угадывает Пиндар: ни один из двух никогда не занимает всего места, сокрытие не разрушает раскрытие, и наоборот… Ибо это мир, которой не может быть покинут Αἰδώς, который не подчинён историко-катастрофической временности, временности несчастья, непоправимой ошибки и отмщения. В «юдоли плача», где правит Суд и отмщение времени за его «уже было», сокрытие держит верх над раскрытием. Мир Пиндар есть мир, где люди не отделены навеки от богов, как у Гесиода. Αἰδώς, о которой Софокл говорит, что она восседает на троне высочайшего Бога[jj], поддерживает на своём мест всякую вещь. Сдержанность целомудренного стыда руководит дружеским дележом Земли между богами (Родос — Гелиосу), а также и дележом, который согласуюет совместное обитание бессмертных и смертных, из чего Гёльдерлин, а затем Хайдеггер, сделает обитаемую среду «жительствования» в мире. Эта среда, или Четверица — Небо/Земля, Бессмертные/Смертные — произведена и поддерживаема Αἰδώς.
Αἰδώς не психо-социальная черта древнегреческого общества: она — пульсация Бытия, поскольку это последнее, воздерживаясь само, даёт прийти Всему, в игре сокрытия-раскрытия. Стыдливое удержание представляет собою иной способ высказывать и проживать время, иной чем история, которую Запад сделал своей собственной манерой быть временным. Хайдеггеровская концепция Истории, отмеченной забвением Бытия и понятой как посыл — судьба, Geschick — старается максимально приблизить ту иную конфигурацию времени мира, что мы находим у Пиндара. Всякое сокрытие взято в свободном биении Бытие, что скрывается/раскрывается. То, что Гёльдерлин называет бегством богов, не есть непоправимое происшествие, равно как и забвение Бытия у Хайдеггера. Такое отношение бытия ко времени невозможно у Гесиода, где миф рассказывает об исключительном триумфе сокрытия.
«Историческому» мифу, начатому с ухода Αἰδώς, понятого как происшествие, противопоставлено, таким образом, биение времени сообразно игре пришествия сокрытия/раскрытия, где временность не принимает форму Истории. История есть лишь один из возможных образов временности. Понятие Истории должно остаться для нас в прошлом. Этим не говорится, что больше-де ничего не происходит, но: то, что поистине происходит, восходит к порядку пришествия. Мы всякий раз охвачены происшествиями и оттого не умеем помыслить приходящее. Это неумение объясняется не нехваткой документов, информации или средств связи. Оно объясняется скорее неявным характером близящегося. Приходящее не схвачено в историческом сценарии и не отмечено печатью непоправимой катастрофы. Когда Хайдеггер говорит, что атомная бомба взорвалась уже в поэме Парменида, он не ссылается на происшествие прошлого или же на некое возможное происшествие. Но это нечто, имеющее отношение к прихождению мира. Для того, чтобы пришёл мир, нет нужды, чтобы происшествие взрыва и разрушения прогремело финальной катастрофой, принимая во внимание то, что именно приходящий мир делает такое происшествие возможным. Опустошение мира не должно затуманивать то, что всегда уже приходит и что нельзя, однако, показать или сказать. Пришествию нет нужды производить происшествие, и его собственная стыдливость удерживает его в воздержании от суматохи и суеты. Самое большее, то, что приходит, способно явить себя предчувствию, которое обладает требуемым целомудрием предмыслия.
[a] Kostas Axelos, Ce qui advient.
[b] Françoise Dastur, Penser ce qui advient.
[c] Advenir — субстантивированный глагол.
[d] Événements.
[e] Т.е. не из каких-то немыслимых далей прийти в мир, а потом уйти из него обратно прочь как посторонние, но со смертью, равно как с рождением, мы исходим из мира и входим в него (ср. «из земли взят, в землю отыдеши»).
[f] Здесь и далее: présence.
[g] Au monde — это может значить как «в мир», так и «в мире». Автор понимает «прихождение» не лишь как прибытие в некое место из другого, но и как происхождение из того самого места и в том самом месте, в которое осуществляется прибытие.
[h] Chair.
[i] Mondifier. Это слово, кроме того что является неологизмом, значит также «прочищать рану», а отсюда и в фигуральном смысле: очищать. Мир же мирит как мiръ и примиряет как миръ.
[j] Devenir — это слово обыкновенно переводится как становление, но здесь правильно было бы сохранить корень ход/шест, то и дело звучащий у автора: advenir, venir, devenir, survenir, provenir и т.д. Слова всхождение, всход отсылают к старому греческому слову φύειν, φύσις, стоящему у истоков мысли о становлении. Поэтому читая всюду далее «становление», уместно читать также и всхождение.
[k] Avenir. Именно грядущего, а не будущего — снова корень venir, venio, ход.
[l] См. Хайдеггер, Бытие и время, стр. 339.
[m] Имеется в виду élan vital Бергсона, что переведено в Творческой революции как жизненный порыв.
[n] Т.е., буквально, никогда не становится происшествием.
[o] Êtres-au-monde — первое слово здесь является субстантивацией глагола быть, которая используется во французском для обозначение любого существования, будь то человек или зверь или нечто ещё. Если позволить себе такую вольность (точность), то можно написать: быть-в-мир(е). Где быть должно быть услышано во множественном числе: мы суть быть-в-мире и прибыть-в-мир (см. сноску g на предыдущей странице).
[p] Durée. См. Бергсон, Длительность и одновременность (Durée et simultanéité).
[q] Бергсон, Творческая эволюция, Глава 3.
[r] Мерло-Понти, Знаки, Москва, Искусство, 2001, стр. 212: «Бергсон отыскивает в сердцевине человека досократический и «дочеловеческий» смысл мира.» Прим. авт.
[s] Бергсон, Мысль и движущееся, Введение, Часть вторая, «О постановке проблем»: «Чем стал бы стол, на котором я сейчас пишу, если бы мое восприятие, а следовательно, мое действие были созданы для величины такого порядка, которому соответствуют элементы, или скорее события, конституирующие материальность этого стола? Мое действие тогда бы рассеялось; мое восприятие охватило бы — в том месте, где я вижу свой стол, и в тот краткий момент, когда я на него смотрю, — необъятную вселенную и не менее бесконечную историю. Я не сумел бы понять, каким образом эта подвижная безграничность может стать, дабы я воздействовал на нее, простым прямоугольником, неподвижным и прочным. Это верно для всех предметов и событий: мир, в котором мы живем, вместе с действиями и противодействиями, происходящими между его частями, является таким, каков он есть, в силу известного выбора на шкале величин, определенного нашей способностью действовать.» (Перевод на русский И. И. Блауберг.) Прим. авт.
[t] Ср. Творческая эволюция, сс. 377-378. Минск, Харвест, 1998, и Мысль и движущееся, Введение, Часть первая, «Возрастание истины. Возвратное движение истины»: «Эта необходимость ждать — факт очень показательный. Он говорит о том, что хотя в универсуме можно выделить системы, для которых время — всего лишь абстракция, отношение, число, сам универсум есть нечто иное. Если бы мы хотели охватить его целиком — неорганический, но сплетенный с организованными существами, — то увидели бы, как он беспрестанно принимает формы столь же новые, столь же оригинальные и непредвидимые, как состояния нашего сознания.» (Перевод на русский И. И. Блауберг.) Прим. авт.
[u] Слова вещь (chose) и причина (cause) во французском языке более, чем однокоренные: это собственно одно и то же, хотя теперь их значения и разные.
[v] Страница по французскому изданию. См. например с. 274, Минск, Харвест, 1999. Цитаты приведены с изменениями. Словом «извергание» переведено французское слово jaillissement, от глагола jaillir: бить ключом, фонтанировать, хлестать, брызгать, сыпаться.
[w] Бергсон, Два источника морали и религии, Москва, Канон, 1994, с. 61, перевод на русский А. Б. Гофмана: «Но душа, которая открывается и в глазах которой материальные препятствия падают, вся наполнена радостью. <…> она — это движение вперёд.» Прим. авт.
[x] Там же, с. 247. Прим авт.
[y] Гесиод, Теогония, стих 535.
[z] Καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐριοδέιης
Λευκοῖσιν φάρασσι καλυψάμενα χρόα καλὸν
Ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλίποντ’ ἀνθρώπους
Αἰδὼς καὶ Νέμεσις ·
«Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд.» (Перевод на русский В. Версаева)
[aa] Pour en finir avec le jugement de l’histoire. Отсылка на речь Антонена Арто Pour en finir avec le jugement de Dieu, «Чтобы покончить с Божьим Судом».
[bb] Хайдеггер, Парменид, «Владимир Даль», Санкт-Петербург, 2009, с. 165, перевод А. П. Шурбелёва.
[cc] Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Gesamtausgabe Band 7, S. 271. Речь идёт о тексте Хайдеггера Ἀλήθεια, который на русский язык (официально) не переведён. Его можно, однако, найти в нашем журнале Ἑρμηνεία, №1 (8), 2016, перевод О. С. Ракитянской.
[dd] II Олимпийская ода, эпизод 5. Прим. авт.
[ee] Τελεύταθεν δὲ λὀγων κορυφαί ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι. VII Олимпийская ода, стих 69. Прим. авт.
[ff] Хайдеггер, Парменид, op. cit., с. 164. Прим. авт.
[gg] Τόθι λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς Τλαπολέμῳ ἵσταται. Стих 78 и далее (прим. авт.):
«Там и сбывается
Сладкий выкуп скорбной беды
Тлеполема, водителя тиринфян.»
[hh] Боги не совершают упущения, даже если они и могут обманывать или обманывать. Впрочем, Зевс и Аполлон никогда не лгут, — об этом нам напоминает Пиндар в своей III Пифической оде: Ψευδέων δ’ οὐχ ἅπτεται κτλ… (стих 39).
[ii] Стих 26. Невозможно знать то, что встретит человек: τοῦτο δ’ ἀμάχανον εὑρεῖν ὁτι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ φερτάτον ἀνδρὶ τυχεῖν.
[jj] Ср. стих 1267 и далее Эдипа в Колоне: «Но ведь недаром у престола Зевса | Во всяком деле Милость (Αἰδώς) восседает» (пер. Ф. Ф. Зелинского).
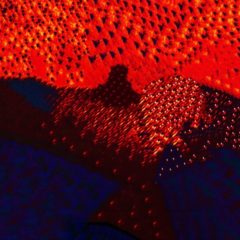








 Dans son cours Parménide, commentant un passage de la Septième Olympique, Heidegger tient aidôs pour « le mot fondamental de la poésie de Pindare et par conséquent un mot fondamental du monde grec » (p. 123). Il fait remarquer la connexion chez Pindare entre Aidôs – le « demeurer caché » – et le cèlement (λάθα) et le décèlement (ἀλάθεια) (v. 43 sq.) L’intuition de Heidegger selon laquelle c’est la question du celer/déceler qui est première se trouve confirmée. L’être, pour les Grecs, n’est qu’en tant que jeu de l’entrée en présence et de la sortie hors de la présence. Chez Pindare, les hommes, les dieux, la terre et la mer sont pris dans ce jeu. Dans le texte d’Hésiode où les dieux et les hommes voués aux représailles de Zeus (le travail et le sexe) sont jetés dans une temporalité déterminée par le jugement et la chute originelle (pas d’Histoire sans jugement), Aidôs est liée à Dikè (Justice) et Eris (Discorde). La Septième Olympique de Pindare narre trois événements celants par lesquels un même retournement inattendu a lieu qui fait à chaque fois advenir une grâce décelante : le partage de la terre, l’oubli du feu pour le sacrifice, le meurtre de Licymnios (le frère d’Alcmène). Rappelons le contexte : l’épinicie chante la victoire du Rhodien Diagoras et remonte au mythe de la venue au jour et de la fondation de Rhodes. Remarque : la parole poétique ne se contente pas de manifester les événements (la victoire de l’athlète) pour les préserver de l’oubli [8]. La victoire advient dans la parole. Le poème est mise en œuvre de ce qui advient plutôt que récit d’événements.
Dans son cours Parménide, commentant un passage de la Septième Olympique, Heidegger tient aidôs pour « le mot fondamental de la poésie de Pindare et par conséquent un mot fondamental du monde grec » (p. 123). Il fait remarquer la connexion chez Pindare entre Aidôs – le « demeurer caché » – et le cèlement (λάθα) et le décèlement (ἀλάθεια) (v. 43 sq.) L’intuition de Heidegger selon laquelle c’est la question du celer/déceler qui est première se trouve confirmée. L’être, pour les Grecs, n’est qu’en tant que jeu de l’entrée en présence et de la sortie hors de la présence. Chez Pindare, les hommes, les dieux, la terre et la mer sont pris dans ce jeu. Dans le texte d’Hésiode où les dieux et les hommes voués aux représailles de Zeus (le travail et le sexe) sont jetés dans une temporalité déterminée par le jugement et la chute originelle (pas d’Histoire sans jugement), Aidôs est liée à Dikè (Justice) et Eris (Discorde). La Septième Olympique de Pindare narre trois événements celants par lesquels un même retournement inattendu a lieu qui fait à chaque fois advenir une grâce décelante : le partage de la terre, l’oubli du feu pour le sacrifice, le meurtre de Licymnios (le frère d’Alcmène). Rappelons le contexte : l’épinicie chante la victoire du Rhodien Diagoras et remonte au mythe de la venue au jour et de la fondation de Rhodes. Remarque : la parole poétique ne se contente pas de manifester les événements (la victoire de l’athlète) pour les préserver de l’oubli [8]. La victoire advient dans la parole. Le poème est mise en œuvre de ce qui advient plutôt que récit d’événements.



