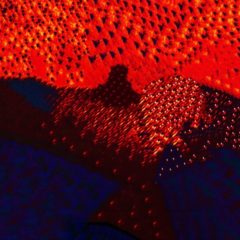La conférence LE PROBLEME DE L’ESPACE EN PSYCHOPATHOLOGIE est prononcée en 1932 et publiée en 1933. Elle appartient à la période daseinsanalytique. Il s’agit d’une étude de l’être-affecté selon l’espace. Il y a une diversité des formes du spatial. Leur constitution doit permettre la compréhension psychiatrique des différentes pathologies. Le problème de l’espace (dont la notion se fonde sur l’analytique existentiale de l’être-au-monde) se pose en vue de la compréhension et de la résolution des modes de spatialisation affectés du patient.
La conférence LE PROBLEME DE L’ESPACE EN PSYCHOPATHOLOGIE est prononcée en 1932 et publiée en 1933. Elle appartient à la période daseinsanalytique. Il s’agit d’une étude de l’être-affecté selon l’espace. Il y a une diversité des formes du spatial. Leur constitution doit permettre la compréhension psychiatrique des différentes pathologies. Le problème de l’espace (dont la notion se fonde sur l’analytique existentiale de l’être-au-monde) se pose en vue de la compréhension et de la résolution des modes de spatialisation affectés du patient.
« Nous recherchons des altérations fondamentales qui concernent les modes de l’explication du je et du monde, à partir desquelles il faut rendre compréhensibles les altérations à l’intérieur des sphère particulières du vécu. » (p. 116)
A/ Arrière-plan théorique du problème de la spatialité en psychopathologie
Les références de Binswanger :
– Ernst Cassirer (cf. Philosophie des formes symboliques) : tout espace est une forme particulière du spatial et chaque forme représente un type constitutif déterminé de la spatialité.
– Heidegger (cf. Être et Temps) : l’espace n’est pas dans le sujet, le monde n’est pas dans l’espace. Celui-ci est saisi dans un retour sur le monde, la spatialité se découvre sur un fond mondain. Le Dasein est « spatial » en un sens qui ne renvoie pas l’espace ou la corporéité à l’étendue sensible et matérielle. Binswanger pose en note une équivalence entre monde et espace du monde. La constitution ontique des espaces est rapportée à la préinscription ontologique de cette constitution dans l’être-au-monde.
Procédant à la mise à découvert des formes de spatialité, B. va se demander avec lesquels de ces degrés la psychopathologie a à faire ? Quel est le sens et les limites des résultats à attendre ?
- Quelques voies méthodologiques suspectes sont écartées :
– Dès l’introduction : l’amalgame espace-temps (Bergson) : il ne faut pas mélanger les deux problèmes de la spatialisation et de la temporalisation.
– L’espace comme condition subjective et la distinction entre idéalité transcendantale et réalité empirique de l’espace (Kant).
– Le débat entre empirisme et nativisme, c’est-à-dire la question de savoir si les représentations de l’étendue sont des données innées de la conscience ou si elles ont été apprises.
– Les problèmes psycho-physiques (à propos de la relation âme/corps).
– La théorie des signes locaux (Lotze).
Il n’est pas question de donner une définition objective ou subjective de l’espace : on ne se demande pas ce qu’est l’espace (son essence) et on ne se penche pas sur l’origine de la représentation de l’espace.
- Binswanger s’oppose à l’idée que quelque chose d’essentiel puisse être exprimé avec la possibilité de localiser un trouble psychique.
Il faut constamment souligner la façon infiniment compliquée dont se présentent les relations psychopathologiques dans la désorientation qui a lieu à l’intérieur de l’espace orienté. On décrit les relations psychopathologiques d’après le schéma d’un appareil dans le cerveau et à partir de la possibilité de localisation des désorientations spatiales, on conclut à un « sens spatial » spécifique. C’est contre ce terme que s’élève Binswanger car on s’en sert pour décrire des troubles fondamentalement différents. De plus, ce point de vue conduit à l’hypostase de » l’ » Espace et à une théorie analytico-fonctionnelle de l’appréhension de l’espace en tant qu’elle constitue une aptitude biologique parmi d’autres. Enfin, il faut dire que la possibilité de localiser biologiquement les maladies mentales ne constitue pas un argument contre le point de vue ontico-génétique.
- Il faut combattre la tendance à la simplification en psychopathologie.
Contre les hypothèses sensualistes, il faut opposer l’énorme complexité du processus réel, concret conditionné par la situation et le problème, le vécu et sa structure historique (cf. Fuite des idées.) La controverse autour de la modalité des troubles de l’espace : est-ce que ces troubles doivent être rapportés à une fonction de base ou alors à des foyers voisins et isolés ? Binswanger ne rejette pas complètement la recherche focale de Kleist. Ce dernier comprend le spatial comme une propriété particulière des sensations et représentations à côté de leurs autres propriétés qualités, intensités, durée. Il est conduit à différencier deux modalités de troubles dans l’organisation des représentations : l’une dans la construction des représentations à partir de leur composants sensoriels isolés et l’autre dans la structure spatiotemporelle de représentations. Or, on met au compte de représentations isolées ce qui est affaire de l’homme tout entier. On rate du coup ce qui est émanation de la modalité d’ensemble de chaque être-au-monde.
- Binswanger veut plutôt se demander : « comment l’organisme répond à une tâche déterminées et comment il la résout ? »
Il ne se contente plus de l’hypothèse de fonction et de systèmes fonctionnels inaltérables déterminés et en autarcie absolue. Pas question d’examiner des fonctions générales mais chaque fonctionnement doit être examiné dans une situation déterminée pour une tâche déterminée. Les troubles de l’orientation ne doivent pas être rangés sous la rubrique des troubles de la mémoire ou de l’attention. Ils sont le symptôme d’un appauvrissement déterminé du monde de l’homme qui ne se limite pas à la portion de l’espace orienté : même la faiblesse de jugement exprime un tel appauvrissement du monde des significations et des objets de pensée qui s’y constituent : un manque d’arrière-plan mondain est visible comme dans l’espace orienté.
- Dans sa mise à découvert de la forme principale d’espace pour la psychopathologie, Binswanger rencontre une tradition littéraire et philosophique regardée avec mépris par les sciences positives. Trois co-fondateurs sont nommés : Pascal, Kierkegaard et Newmann.
À la Nature de Newton s’oppose celle de Goethe (cf. Traité des couleurs : « toute la nature se manifeste par la couleur au sens de l’oeil) : c’est aussi une science. Mais l’incapacité de saisir la région du cœur avec les seules catégories scientifiques n’exclut pas nécessairement toute scientificité. Cette tradition remonte à St Augustin en passant par Hamann et Herder : les concepts scientifiques fondamentaux tirer leur origine de l’affectivité humaine : le concept de force, celui de pesanteur (Baader) de dureté (Jean Paul) de temps (Plotin), sont rapportés à leur foyer originaire : c’est à partir du sentiment du poids qui pèse sur un être que toute idée scientifique de pesanteur peut être élaborée. Le concept physique de pesanteur ne représente qu’une abstraction scientifique atténuée du point de vue anthropologique. De même le concept de résistance, fondement de la réalité du monde extérieur chez Dilthey et Scheler. Pour Scheler, le vide du cœur est le datum originaire pour tous les concepts de vide, c’est le foyer du concept de la forme vide d’espace et de temps dans le cœur. Or cette forme vide n’est rien d’autre qu’une fiction inouïe dans la vision naturelle : l’espace comme vide et les choses comme pur remplissage.
– Il faut distinguer trois directions contemporaines de cette tradition :
1) Klages poursuit cette tradition pour ce qui concerne le problème de l’espace : il distingue espace mathématique (pur homogénéité, infini, dimensions commutables, incorporel, muet, incolore) et espace de la vision (hétérogène, fini, haut/bas réels, droite/gauche, orientation selon l’ici absolu, corporel, coloré, sonore). La direction du haut vers le bas signifie l’effet de pesanteur ou la direction de la chute). Les relations de position deviennent un moyen de représentation de l’opposition légar/lourd, ascension/chute, charge/portage.
2) Référence à Vischer, Lipps, Stein et Husserl (entre positivisme et phénoménologie) : problèmes de l’empathie.
3) Source la plus fondamentale et la plus sérieuse scientifiquement : la phénoménologie de la perception – Pfänder, Scheler, Conrad Martius, Lipps et Schapp. Il s’agit de la connaissance de l’aspect et de l’habitus et de la perception de formes physionomiques ou expressives (dureté/molesse, chaud/froid, bois/fer, spongieux/osseux etc.) La phénoménologie de la perception vise la quiddité du perçu, sa nature matérielle.
B/ Les différentes formes de spatialité que doit prendre en considération le psychopathologue
I. L’espace du monde naturel : spatialité déterminée suivant des positions et des directions. Espace que j’emporte toujours avec moi, dans lequel je ne circule pas. C’est par cette forme la plus courante mais non la plus originaire que Binswanger commence. Elle se caractérise par la position, la direction, l’éloignement, le mouvement infinitésimalement divisible. Cet espace prend trois formes entre lesquelles existe une nette gradation : l’espace orienté, l’espace physique et l’espace géométrique. Les degrés les plus primitifs de l’espace naturel constituent les champs de mouvement d’organes de la vue et du toucher. Ils sont pré-spatiaux, c’est-à-dire qu’à partir d’eux se forme l’espace ambiant (orienté) de l’individu. Tout comme les mouvements des yeux et de la tête élargissent le champ de vision, l’élargissement de l’espace orienté en un espace homogène (celui de la science newtonienne) s’obtient par un déplacement dans l’horizon lointain avec les mouvements de la marche. Homogène signifie la relativisation de l’ici et du là et donc l’absence de tout point insigne. Ce qui permet d’accomplir idéalement la pleine mobilité du corps propre du je : celui-ci peut s’y déplacer sans limites de distance. Le corps propre est devenu cette fois complètement chose parmi les choses. Je peux prendre la place d’un autre et m’imaginer à quoi ressemble le monde de son point de vue. L’espace orienté dans lequel l’homme forme le centre absolu d’orientation (ici absolu) se distingue de l’espace homogène des sciences de la nature sans ici absolu (relativité des places). Quant à la façon dont l’espace des géométries euclidienne et non-euclidienne proviennent de l’espace homogène de Newton, cette question n’a pas d’intérêt direct en psychopathologie, ni pour ce qui concerne le dépouillement du caractère absolu de l’espace newtonien par la théorie de la relativité restreinte.
II. L’espace thymique : Le domaine de recherche de l’espace thymique recouvre toute la psychopathologie. Même dans l’espace orienté nous sommes naturellement thymiques. Jamais complètement athymiques. On y fait abstraction pour parvenir à l’idée d’orientation spatiale : pensée résultant de l’action, de l’observation des grandeurs, du retrait dans la mesure et pensée géométrique. Même là nous sommes thymiques. Cette disposition du retrait-auprès-de-quelque-chose est la soubassement de la possibilité d’une spatialité opposée à l’espace thymique, celle de l’espace orienté. L’espace vécu de l’être-thymiquement disposé est empli et articulé, structuré de façon propre – non pas par le système de direction droite/gauche, haut/bas, devant/derrière, mais par la qualité spatiale de l’ampleur, la profondeur, la hauteur, et le mouvement propre de l’espace (non par l’éloignement, la direction et la grandeur.) L’ampleur n’est pas quantitative, c’est une qualité de l’espace. Modèle de l’espace présentiel de la danse étendu à l’histoire intérieure de la vie.
III. L’espace historique
– Moment historique : quand je vais de la maison au travail, aller et venir sont déterminés par des moments historiques non par des postures et des positions : foyer et séjour. L’espace historique n’est pas susceptible d’une homogénéisation complète. Espace dont l’ordre de sens est déterminé par les caractères historico-individuels de sens que sont foyer et séjour. Cette forme s’étend à l’histoire intérieure de la vie. Chez l’homme atteint de la fuite des idées, il y a effacement des sens du foyer et du séjour dans un espace biographique anhistorique et homogène.
– Caractères spatiaux du foyer et du séjour (Straus). Cet espace ne se décrit que si on garde l’œil sur le moment de la temporalisation (utilité de cette étude sur l’espace historique pour les formes schizophréniques).
IV. L’espace esthétique
a) Espace en relation au vécu présentiel, à l’espace présentiel ou thymique. Espace esthétique du vécu (esthétique générale de Häberlin) du vécu de beauté (esthétique pure) – cf. F.I. p. 39. Espace sonore en musique, rôle des odeurs, des senteurs dans la constitution de l’espace thymique-esthétique.
b) espace esthétique de la représentation : constitution complexe – espace de la légalité objective de la perspective (peinture) ou de la statique (architecture) – formes de la constitution spatiale.
V. L’espace technique
Ce n’est pas l’espace physique – il n’est pas homogène. Espace objectif de la mécanique. Création technique des malades mentaux (malades de Tramer.)
VI. Les autres formes d’espace
– Espace démoniaque mythique (travaux de Ernst Cassirer)
– Forme de l’espace commun de l’être-ensemble (mitsein)
cf. 3ième étude F.I. : le monde du malade dans l’espace orienté, de la pensée, dans l’espace social, montre une articulation particulière : les limites deviennent floues : espace social plus homogène, plus plat. Il « saute » différemment que nous, bousculant sans distinction tout ce qui vient sur son chemin.
– Forme complexe déterminée par le monde de la nature, le monde commun et la « culture » : là où nous écrivons une lettre (opération culturelle) : le malade est-il ou non capable d’une telle opération ? Conscience temporelle déterminée par le futur, attente de la réception de la lettre. Le malade : son monde n’a pas de place pour la possibilité d’un espace-temps culturels. Son temps se temporalise en tant que présent : il ne sait pas ce qu’est l’attente et ne peut attendre. A partir d’un acte simple (pouvoir ou non écrire une lettre) on peut pénétrer dans la structure du monde du malade.
C / La constitution de l’espace orienté
Le plus important des espaces naturels pour la psychopathologie.
- Espace du corps propre/espace ambiant
– Binswanger découvre une unité fonctionnelle avec pour deux pôles de fonctions : l’espace du corps propre et l’espace du monde ambiant. Ces deux espaces se constituent selon l’unité de l’optique et du kinesthésique.
– L’espace ambiant est optiquement fondé, très stable et indépendant de l’espace kinesthésiquement fondé : la simple perte optique de la position d’orientation spatiale conduit à un sentiment d’insécurité/souffrance et de vertige authentique (purement optique). Cette épreuve du vertige montre que notre sécurité vitale se rapporte à certaines limites fonctionnelles du rapport espace du corps propre-espace ambiant.
– L’espace lié au corps propre est kinesthésiquement fondé, c’est-à-dire qu’il se déplace avec le corps propre. Chez certains agnosiques et aphasiques l’espace est orienté selon la position respective de leur corps physique : expérience dans lesquelles on leur ferme les yeux : le haut c’est alors la tête et le bas les pieds ; en ouvrant les yeux il corrige. Le malade vit dans deux types d’espace orienté : un espace fondé optiquement et un autre kinesthésiquement (aussi réels l’un que l’autre)
– L’espace ambiant et celui du corps propre forment donc une unité indissoluble : les actes de mouvement renvoient à la fonction du pôle-corps-propre et les buts ou objets du mouvement à la fonction du pôle-espace-ambiant. C’est à chaque fois le tout unitaire qui se modifie en tant que tout.
– Les troubles de cette unité fonctionnelle ne concernent pas la seule physiopathologie car les troubles de l’agir et du percevoir/reconnaître sont intriqués ensemble. Praxie et gnosie sont liées par une étroite appartenance fonctionnelle. Les troubles de la parole peuvent renvoyer tout à la fois à la fonction motrice et à la fonction de représentation et signification. Tout est lié dans cette structure fonctionnelle de sorte que le trouble d’une partie entraîne celui de la totalité comme celui d’une structure principale affecte diverses fonctions isolées. Par ex : les troubles du système fonctionnel de l’espace symbolique ou de la représentation se manifestent dans un trouble de l’appréhension logique des significations, du calcul, de l’incitation à parler, du comportement à l’égard des positions et directions spatiales, de la localisation sur le propre corps physique. Mais il ne s’agit pas de comprendre ces troubles comme des déficits opératoires, mais comme des suppléances opératoires mutuelles dans les déficits.
- Espace propre/espace étranger
– Pour étayer la théorie de l’espace du corps propre (Leibraum) en tant que totalité fonctionnelle, Binswanger va procéder à l’élargissement du concept d’espace du corps propre en introduisant le concept d’espace propre opposé à celui d’espace étranger (à ne pas confondre donc avec l’opposition espace du corps propre/espace ambiant.) L’espace du corps propre subit trois sortes d’élargissements avec cette distinction :
1) D’abord cette distinction espace propre/espace étranger se constitue à travers le simple acte de saisir. L’espace étranger naît de la séparation entre perception-pensée/motricité (gnosie optique/kinesthésie pratique) bien que dans l’action propre et étranger forment un seul espace.
2) La subjectivation de l’espace étranger : l’automobile que je regarde est dans l’espace étranger, celle où je suis assis est dans l’espace propre (je n’ai pas besoin d’évaluer sa largeur par rapport à la voûte tout comme mon corps quand je vais franchir une porte)
3) Un autre élargissement de l’espace propre a lieu dans l’assimilation dynamique de l’espace étranger : fusion pathique : aller à cheval, faire de la luge, ramer, skier, faire du vélo, nager. Il y a fusion de l’espace du corps propre avec le mobile étranger. Le principe étant de « se laisser porter. »
- Espace proche/espace lointain
L’espace orienté autour d’un ici absolu se décline en espace proche et en espace lointain (qui n’est pas l’opposition propre/étranger). Dans cet espace orienté, une chose nous est à portée ou à la main, alors qu’une autre ne nous est accessible que par le sens à distance (œil, oreille). L’éloignement par rapport à moi n’est donc pas à comprendre sur le modèle de celui entre deux objets qui s’individuent dans cet espace.
Dans l’espace orienté, le corps propre (Leib) est constitué à la fois comme objet parmi les objets et comme insigne sur le plan tactile et visuel comme l’ici absolu de tout là : le je forme le centre d’orientation absolue, autour duquel le monde en tant que monde ambiant se constitue. C’est la position centrale du tronc qui rend possible un ici, une localité du « je », et une orientation centrale autour d’un plan médian. En effet c’est au moyen des mouvements d’éloignements des membres par rapport au tronc que se constitue l’espace tactile. Un être sans membre ou un animal sphérique ne seraient pas capables de constituer un espace orienté. La réinterprétation de la profondeur visuelle en un espace tri-dimensionnel est fondée dans la kinesthésie. La tridimensionnalité elle-même procède de la pluridimensionnalité des mouvements du corps propre.
D / La constitution de l’espace thymique :
- Le mouvement présentiel de la danse
– Une autre constitution du spatial implique la relation des membres au tronc, mais se laisse comprendre selon un ordre de sens : le monde vécu pathique qui se distingue du monde gnosique et pratique et que Binswanger entend saisir à partir du mouvement présentiel d’après Erwin Straus. Le but de Straus : montrer qu’on ne peut rendre compte du mouvement sans rendre compte de la structure de l’espace où le mouvement se produit. D’où la nécessité d’une psychologie du mouvement pour l’élaboration de la constitution des formes du spatial. La danse entre au premier plan de cette psychologie dans la mesure où elle remplit cet espace de tous côtés.
– Dans la danse, les mouvements du corps s’ordonnent aux qualités symboliques de l’espace. Le je de l’être humain actif éveillé qui est localisé normalement à la racine du nez, entre les yeux descend avec la danse jusqu’au tronc (Balzac) où se concentre d’une façon unitaire le corps propre.
– Il y a simultanéité de crue/décrue, accroissement/diminution mais pas d’altération ni de procès historique. D’où l’expression « mouvement présentiel » (adoptée par Straus). C’est un présent prolongé en dépit de sa durée dans le temps objectif. Si dans le mouvement finalisé de la marche, la marche en arrière est évitée, dans la danse elle va de soi. Mais les directions principales ne peuvent distinguer espace orienté et espace présentiel. L’espace orienté d’après des directions est à chaque fois celui de la position du corps propre. Espace présentiel de la danse est libre de toute référence locale et de toute dynamique historique. Mais son homogénéité est spécifique.
– Le système de relations du je et du monde est plus riche et plus complet que le système de positions, directions et mouvement orientés sur cet ici. Tandis que le système des relations dans l’espace orienté se construit en fonction de notre activité finalisée et de notre sécurité vitale le système des relations est à présent de type existentiel. Il ne s’agit plus de l’espace d’action vitale de l’être-orienté-ici absolu, ni de l’espace homogène de la connaissance physique et géométrique (espaces finalisés : explication finalisée, pragmatique ou logique du je et du monde). C’est un espace sans but et fins pratiques et logiques : 1 Dasein sans finalités, riche et profond, qui fait de l’homme un homme.
– La forme du vécu et la configuration de l’espace représentent le double pôle d’une unité noético-noématique. C’est cette unité essentielle que Straus a en vue. Mais sa doctrine de l’espace présentiel et de son opposition à l’espace historique doit subir une extension, une transposition au domaine de l’histoire intérieure de la vie où prennent sens les notions de foyer et de séjour. L’existence comme un perpétuel « être-en-chemin » (Hofmansthal Les chemins et les rencontres), le chemin vers le Christ comme chemin vers le foyer. De même l’amour de l’homme pour la femme, de la mère pour l’enfant, amant/aimé etc. dans leur absence ou leur présence (vifs ou morts). Aussi notre métier, l’art, une œuvre peuvent signifier un foyer. L’espace de notre histoire intérieure de la vie, l’espace historique de notre histoire intérieure s’articule selon la genèse et l’ordre de liaison de ces foyers, selon la dominance d’un centre etc. Dans cet espace, il y a aussi du plein/vide (néant), aller/retour, rapprochement/éloignement, arrivée/départ, courts/longs chemins, se hâter/s’arrêter/marche prudente/rester sur place obstiné/bondir d’un cœur léger (cf. F.I. p. 179 et sq.)
– Nous passons de l’espace historique de l’histoire intérieure de la vie à l’espace anhistorique, présentiel ou thymique quand nous nous abandonnons, sans but, à la pure disposition thymique : comme dans la danse, le mouvement du corps propre, la sorte de mobilité de notre Dasein s’exprime. Le mouvement n’est qu’un cas de cette expression du corps prorpre. Le Dasein adopte une forme déterminée de mobilité ressentie comme chute brutale (déception grave) flottement (joie) rétrécissement de l’espace (angoisse, mélancolie) ou élargissement (optimisme, manie). Nous quittons l’espace présentiel pour l’espace historique selon la façon dont nous assumons ce vécu présentiel, sa configuration historique.
– Binswanger va prendre position sur le plan terminologique : l’espace « pathique » ou « du vécu » évoquent une passivité. « Présentiel » connote le présent : trop étroit. Pour l’espace dans lequel séjourne le Dasein humain, le qualificatif « thymique » convient mieux. Le monde de la disposition thymique a une temporalité et une spatialité propre comme l’atteste la teneur expressive de certains espaces : églises, usine, lieu de travail, habitation, paysage, « plaine infinie », « mer infinie », vallée montagneuse, montagnes qui vont s’écrouler sur l’homme qu’elles encerclent par opposition à l’ampleur du foyer pour le cœur. L’ampleur n’exclut pas de petites dimensions sur le plan objectif. En note p. 89 : le foyer donne le sentiment de l’ampleur ; le montagnard est ample dans la vallée étroite et trouve étroite la vaste plaine : indépendance du caractère spatial de ce monde à l’égard du monde de l’espace orienté et de ses grandeurs. La proximité d’autrui épanouit ou serre le cœur. Selon que je sens que c’est ample ou étroit pour le cœur (joie ou chagrin, plein ou vide) l’expression du monde varie. Ni l’espace induit le vécu ni le vécu induit l’espace. C’est l’unité dialectique du je et du monde qui est exprimée.
- L’unité dialectique du je et du monde
– La plénitude ou le vide existentiel du je fait face à ceux de son monde et inversement. L’espace du corps propre et l’espace étranger n’y sont pas aussi séparés que dans l’espace orienté. Il y a un dépassement de la tension sujet/objet (devenir-un). Je et monde forment une unité dialectique dans laquelle ce n’est pas un des pôles qui confère son sens à l’autre : le sens découle de leur contrariété. Unité dialectique du vécu et de l’événement (comme avec le je-ici absolu et le monde ambiant orienté.)
– L’unité du je et du monde se forme ainsi dans l’espace thymique. L’individualité est ce que le monde est en tant que son monde (Hegel). « Ô Dieu comme le monde et le ciel se resserrent Quand notre cœur se serre dans ses limites » (Goethe, La fille naturelle). La relation comme-quand n’est pas causale (le serrement de cœur ne cause pas celui du ciel.) C’est un rapport d’essence anthropologique et phénoménologique, de l’être thymique du je (ou « cœur » comme centre de notre essence) et de la spatialité du monde. Le serrement de cœur consiste dans la limitation du monde et du ciel et à l’inverse. A distinguer du rapport génétique et objectif : mon cœur se serrant parce qu’un orage se prépare ou alors l’espace devient sombre à cause de mon anxiété.
– Chez Goethe, dans Elégies de Marienbad, le désespoir se manifeste dans le rétrécissement spatial du monde (ou affaiblissement, obscurcissement) : vide total de monde : le désespéré « regarde fixement le vide. » Ce vide du désespoir est relatif à une perte extérieure ou un être-dévasté intérieur. Le désespéré est absorbé par la perte du monde. A distinguer du vide du cœur chez Scheler : apathie et vide du Dasein qui vacille dans le vide à la recherche du monde, même de manière indolente ou avide en tant que matière à stimulus et curiosité. Rudolf Hildebrand : « Cela revient à se poser la question de l’espace en nous, sans lui on ne peut pas faire un pas dans le monde vrai de la pensée. » Binswanger : dans le monde tout court.
- Les altérations de l’espace-thymique
– Il renvoie à ses analyses sur la forme maniaque de l’existence et à celles de Fisher sur les schizophrènes. Il faut connaître la perte « normale » de monde dans le désespoir et l’apathie du cœur pour comprendre anthropologiquement le vécu de la vacuité (Fischer) et le vécu de la fin du monde (Freud) schizophréniques. La compréhension du monde de la disposition thymique optimiste normale est indispensable à la compréhension du nivellement ou de l’a pauvreté de reliefs du monde dans la forme maniaque d’existence (cf. F.I.)
– Straus met les phobies en relation avec les qualités symboliques de l’espace, les perversion, la psychopathie avec la distinction du gnosique et du pathique, la catatonie avec le mouvement présentiel.
– Le malade qui entend et voit le morceau de la voie ferrée qui rentre dans sa chambre : il s’oriente dans l’espace orienté. C’est son espace thymique qui est gravement altéré. Pour un européen éveillé, adulte et civilsé. Unité grotesque de l’espace thymique avec l’espace orienté. L’espace orienté s’articule en normal et pathologique (car la montée de la voie ferrée se déroule dans l’espace orienté).
– Rapport de l’hallucination et espace magico-myhthique de Cassirer Philosophie des formes symboliques. L’orientation spatiale est liée au sens de l’être-thymique pathologique : entités démoniaques vécu spatial terrifiant, angoissant. Il faut distinguer néanmoins l’espace mythique du primitif et l’espace thymique pathologique du schizophrène. Avec les drogues : troubles de l’espace orienté. Fusion douloureuse de l’espace propre et de l’espace étranger dans un espace indivis.
– Minkowski : immobilité et uniformité générale de l’espace schizophrène (que ce soit l’espace de la pensée, de l’action ou de la thymie) : « rationalisme, géométrisme morbide » à la suite de Bergson.
– Cf. F.I. : Heidegger et Häberlin. Binswanger rappelle qu’il a étendu l’analytique existentiale et l’anthropologie existentiale à la région de la forme maniaque de l’existence. La forme d’explication du je et du monde est plus homogène : diminution de relief, plus pauvre : « nivellement » (Wernicke). L’explication du je et du monde est plus uniforme : nivellement des accents de signification, de l’articulation syntaxique et grammaticale, de la structure sociale (Mit-sein), de la temporalisation, de l’histoire intérieure de la vie (saut, tourbillon, accomplissement des désirs) et de la spatialité. A partir des caractères spatiaux (découverte, élargissement, remplissement de l’espace) on dégage la structure et l’articulation propre à la spatialité maniaque : consistance, exposition, éclairage, mobilité de leur monde. Pas de différences que ce soit l’espace de pensée, du corps propre, étranger, pragmatique, thymique, social ou culturel. Cf. 3ième étude F.I. : on peut comprendre, décrire la structure existentiale de la confusion propre à la fuite des idées avec la différence entre vie à la périphérie de l’existence (tourbillon) et vie à partir de son centre et les passages de l’une à l’autre. L’homme atteint de la fuite des idées ne vit pas seulement dans l’improvisation du tourbillon, mais aussi dans la composition d’un thème (significatif existentiellement) façonnant le foyer de l’histoire intérieure de la vie. Fidèlité au milieu des séjours qui changent au milieu du tourbillon.
– Les malades organiques : trouble de l’espace orienté. Schizos et maniaco-dépressifs : troubles de l’espace thymique. Les deux formes sont altérées dans les psychoses toxicomaniaques (stupéfiants) opium, hashish, cocaïne, fatigue, endormissement, rêve, aura épileptique et crises des psychasthéniques. Elargissement du je sous le signe de l’ivresse et du bonheur (cf. Mayer Gross).
– L’altération biographique du vécu présentiel : il s’articule différemment selon les âges. L’homme jeune : son bouleversement crée l’espace du monde ; l’homme âgé : un monde indépendant de ses vécus singuliers en tant qu’espace établi : il cherche à caser ce qui’l rencontre dans cet espace ; l’âme infantile qui cherche à s’imaginer la fin du monde (univers des rêves) ; le garçon : monde de la rue, dans la classe, plaisir de la lutte et du combat : conquête de sa place fixe, point dans le monde. La pensée infantile se réflète chez l’homme mûr avec les concepts philosophiques.