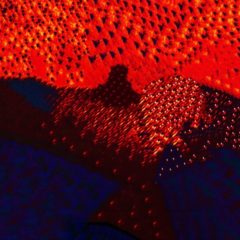« L’impuissance, incontestablement, est l’emblème du malheur arabe aujourd’hui. Impuissance à être ce qu’on pense devoir être. Impuissance à agir pour affirmer notre volonté d’être – ne serait-ce que comme une possibilité, face à l’Autre qui vous nie, vous méprise et, maintenant, de nouveau vous domine. Impuissance à faire taire le sentiment que vous n’êtes plus que quantité négligeable sur l’échiquier planétaire, quand la partie se joue chez vous… »
Samir Kassir, Considérations sur le malheur arabe, éd. Actes Sud, coll. Babel, 2004.
Avant-propos : l’orientalisme du Hadewijch
Henry Corbin , le grand penseur du chiisme iranien, nous a déjà appris le lien unissant les mystiques chrétiens d’Occident comme Maître Eckhart aux mystiques islamiques d’Orient comme Rûzbehân, Sohrawardi, Molla Sadra Shirazi etc. Il semble du point de vue de Bruno Dumont que le mysticisme vrai est essentiellement chrétien quand il n’est pas athée, comme celui qu’il revendique. Cependant dans le mysticisme, il ne s’agit plus de croire en Dieu, mais d’en explorer le néant – c’est-à-dire de franchir la distance qui met Dieu à l’écart de tout existant, en retrait de la présence – aussi nous ne sommes pas loin d’une revendication athée (pour Eckhart, Dieu est rien). Que le mysticisme est fondamentalement un phénomène chrétien, c’est aussi la thèse de Bergson dans son livre Les deux sources de la morale et de la religion dont Dumont s’est inspiré pour célébrer le mariage de la mécanique et de la mystique dès le plan d’ouverture où l’on voit une grue travailler tandis que l’héroïne se recueille dans ses prières.
Mais bien que se voulant bergsonien, Dumont veut transposer l’amour pour l’homme dans l’amour divin (le Christ retrouvé à la fin du film sous la figure de l’ouvrier délinquant (white trash). Pour Bergson, l’amour pour Dieu est transposé dans l’amour humain, et en nourrit l’imaginaire. Par conséquent, c’est la poésie courtoise qui provient de la poésie mystique et non l’inverse comme on pourrait être incliné à le penser, lorsqu’on réduit les extases des saintes à un orgasme sexuel par exemple.
Ce qui est embarrassant dans le film, c’est son côté orientaliste – qui est indiqué par le i de Hadewijch sur l’affiche.
Le terme “orientalisme” est à prendre au sens qui lui a été donné par le penseur Palestinien, Edward Saïd, à qui l’on doit d’avoir démêlé dans la profusion des discours qui traitent de l’Orient, ou même qui l’effleurent en passant, l’unité jupitérienne d’un regard qui ne connaît pas les frontières des genres et des styles. Qu’il s’agisse d’un texte émanant du Pentagone, d’un écrit de Flaubert, a fortiori d’un film de cinéma, la vision orientaliste de l’Orient par l’Occident laisse échapper deux vérités fondamentales : les autres ne sont au fond pas si différent de nous. Tout ce que nous croyons reconnaître chez eux n’est qu’une projection de ce que nous savons de nous-mêmes. Si l’Autre ne nous hantait pas, s’il n’était pas en nous, les autres ne seraient pas si terrifiants à nos yeux. Cette terreur, Hadewijch l’aborde, avec le risque de succomber à la vision orientaliste.
Il ne suffit pas de revendiquer une intention non-politique pour dépolitiser son propos. Un tel évitement reste une forme d’engagement – sans doute la pire. On ne s’en lave pas les mains aussi facilement avec le réel, qui est politique de part en part. Pourtant la majorité des critiques a préféré ignorer cette dimension du film et suivre les indications du réalisateur. Résultat : personne ne veut se salir les mains. Il est symptomatique que le débat ne se soit pas engagé sur ce terrain, mais cela est en même temps peu étonnant. Il suffit de considérer l’actualité pour suivre la montée si inquiétante et si banalisée de l’islamophobie en Europe et dont on peut à juste titre dire qu’elle a pris la place du vieil antisémitisme occidental. Sous couvert d’une lutte contre le politiquement correct, un conformisme arrogant se nourrit de la critique d’un islam dont il ignore tout de ses textes et de son histoire. Et quand on prétend dispenser sa pensée d’une vision politique (celle qui prend en compte la polis comme mode d’être en commun), c’est pour finir par manipuler des clichés assez gênants. Mais le plus inquiétant, c’est ce consensus à ne pas voir venir le danger qui consiste à désigner une nouvelle fois publiquement comme responsable de la dévastation du monde une minorité impuissante de la société.
Il serait intéressant d’analyser la figure abstraite de l’Arabe dans l’ensemble de la filmographie de Dumont – depuis La vie de Jésus en passant par Flandres.
On y décèlerait sans doute une véritable obsession qui mérite d’être questionnée. Dans Hadewijch, la religion musulmane est représentée par un personnage sans épaisseur existentielle, la horde en colère qui manque d’écraser l’héroïne, et l’action terroriste. Certes le terrorisme international peut se revendiquer d’une religion particulière mais son contenu objectif et concret est le monde dans lequel il se déploie (ou l’absence de monde plus précisément, qui caractérise le destin mondial). Les motivations des individus qui trouvent refuge dans la foi extrême et dans l’action enthousiaste (terme qui désignait autrefois les « fanatiques » possédés par le dieu : en – dans – et theos – le dieu) n’expliquent rien de ce qui advient. Si la religion est l’opium du peuple, c’est parce qu’elle est d’abord comme le dit Marx lui-même dans le contexte d’où cette sentence a été pourtant extraite, “le coeur d’un monde sans coeur” et “l’esprit d’un monde sans esprit” : un monde sans âme, un monde clos ou en définitive un non-monde.
En somme, il s’agit de comprendre, et c’est quelque chose que le film ne questionne à aucun moment, ce qu’il en est de nous tous aujourd’hui, pris que nous sommes dans le destin planétaire, ce qu’il en est de la clôture mondiale et de la détresse générale, à tel point que certaines questions nous échappent complètement. Et si les dieux ont bien fui, dans quel domaine se sont-ils retirés ? N’auraient-ils pas bien plutôt changé d’apparence pour se dissimuler là où l’on n’oserait pas les soupçonner ?
Comme à l’arrière boutique de sandwichs grecs, où cet islamiste radical du film façon Dumont initie les jeunes de la cité à l’enseignement coranique. Une fois au moins, la parole aura été donnée à Nassir. Un discours avec une signature propre s’introduit alors dans le film, bienvenu ou malvenu. Le scénario ne le prévoyait pas, du moins pas dans son contenu. C’est la conférence sur le ghâyb.
Ce mot fait signe vers une impuissance qui touche au cœur même de la puissance divine. Le dieu est dans l’impuissance à être et à se rendre présent. Il ne cesse de refluer au-delà de tout ce qui est visible ou invisible, dans le retrait le plus extrême. C’est quelque chose qui se tient plus haut que ce que nous avons nommé dieu. Plus haut que le dieu, il y a le divin. Si la véritable piété – rapport au secret et au sacré – ferme la porte à la théologie (le discours sur l’étant suprême), à l’inverse, on pourrait voir dans certaines figures athées le résidu d’un système théologique, qui implique dans la structure omniprésente de la représentativité, une obsession du dieu ontique.
Le « jihad » engagé par les laïques contre l’islam est loin d’être le symptôme jovial de l’anticléricalisme : il faut plutôt y voir l’effet actuel des siècles d’antisémitisme en Europe. Il est absurde d’opposer un anticléricalisme à une religion qui a ceci de particulier qu’elle ne comporte pas d’appareil clérical. La religion musulmane exclut tout vicariat du système de la foi. Ce sont rarement les institutions religieuses qui sont visées par les « laïcards » (autrement dit les fanatiques de la laïcité qui voient en celle-ci une autre religion ou qui la mettent en concurrence avec les religions, plus particulièrement avec l’islam), Mais c’est plutôt la minorité communautaire – les fidèles, les femmes, les jeunes hommes – qui est prise pour cible.
En créant une représentation du culte musulman, le président Sarkozy a cherché à la fois à christianiser et à séculariser l’islam : il s’agit d’en faire une religion, c’est-à-dire quelque chose qui puisse à ce titre relever d’un statut normalisé dans la République. C’est ce qu’il appelait après J.-P. Chevènement un « islam de France », d’une France dont on aime par ailleurs à rappeler les racines chrétiennes. Or, aucun musulman, sans exception, ne prend les représentants de cette représentation – les recteurs de mosquées – pour des lieu-tenants de la foi.
Mon intention initiale n’étant nullement de donner une mauvaise image, orientaliste, de l’islam, ou de justifier de quelque manière le terrorisme islamiste, je me devais d’éclaircir ma participation au film de Bruno Dumont. La réflexion sur le ghâyb devrait permettre de réévaluer la distinction trop grossière entre une laïcité théologiquement immaculée et un islam qui serait en droit trop “politique” – et par conséquent incompatible avec la vie citoyenne. Et peut-être aussi tendre l’oreille à ce fait trop souvent négligé et auquel Jacques Derrida nous aura attiré l’attention, que le terrorisme international n’est que le symptôme d’une maladie auto-immune qui frappe l’Occident du dedans. Mais l’empressement à créer de l’Autre, nous empêche de porter le regard sur nous-mêmes.
Voici la conférence dans son intégralité :
La conférence sur le ghâyb
« A l’époque de la représentation généralisée qui suit le réel à la trace, et qui, mettant toute chose dans l’évidence du voir panoptique, se crispe sur le visible, c’est-à-dire sur un présent coupé de sa présence, nous rencontrons un mot pensant de la langue arabe qui nous convie à l’abandon, le temps de la méditation. Ce mot c’est el-ghâyb.
Il provient du verbe ghâba qui veut dire « ne pas être là », « s’absenter ». Il signifie à la fois l’absence, le mystère, le caché, le non-manifeste, l’invisible. Le ghâyb c’est ce qui ne s’offre pas au regard humain, qui ne peut être exhibé et qui se maintient dans le retrait de la présence – dans une présence qui se retire du présent. En un sens dérivé (car ontique), le ghâyb, renvoie au domaine subtil de l’esprit, le suprasensible. Dieu, ses Anges, le paradis, l’enfer mais encore ces hommes d’exception que sont les envoyés de Dieu, tout cela peut être dit appartenir au règne du ghâyb, au sens où ils ne se donnent pas à voir et se refusent à la possibilité même de la représentation. Mais un lieu lointain que je ne peux percevoir peut être dit ghâyb, même s’il suffit que je m’y rende pour qu’il cesse de l’être. L’avenir aussi serait ghâyb en ce sens qu’il n’a pas eu lieu, qu’il n’est pas encore présent, ou bien le passé en tant qu’il a déjà eu lieu, qu’il n’est plus présent.
Tout ce qui vient à la présence ou sort de la présence surmonte le ghâyb ou bien en définitive s’y abime. L’étant visible et l’étant invisible doivent être pensés selon et à partir de leur provenance du ghâyb, selon un double mouvement d’arrachement et d’attachement par rapport à lui. Mais ce qui, comme présence cachée du visible, demeure en réserve, reste en retrait du visible et en fait un présent, cela est le ghâyb.
Dans ce sens originaire, le ghâyb ne renvoie donc à aucune chose présente cachée derrière ce qui est présent, mais il fait référence à la cache de la présence elle-même, qui n’est elle-même jamais rien de présent. Une cache dont l’absence et l’invisibilité permet à ce qui est présent de s’avancer dans la présence et de venir à l’apparaître. C’est l’apparaître qui se retire au profit de ce qui apparaît. Le visible n’a pas les moyens de cacher l’invisible qui le supporte : c’est à l’inverse, l’invisible (l’apparaître) qui découvre le visible (l’apparaissant) en même temps qu’il s’y abrite. L’invisible se dit ainsi de ce qui toujours déjà se retire hors du champ du visible, et c’est ce retrait même qui rend possible toute venue à la présence et toute sortie hors de la présence. Ainsi la lumière n’est jamais objet de la vision : si c’est la lumière qui devait être vue, on ne verrait jamais rien. Au contraire, la lumière se retire au profit de ce qu’elle illumine.
Plus spécialement donc, el-ghâyb désigne ce feu qui illumine le visible, et ce feu ne peut être atteint par la perception commune des sens, ni par la raison abstraite, ni par le cœur. Par définition, les sens corporels et l’intellect aiment à se représenter leur objet et sont donc toujours extérieurs à lui, alors qu’avec le ghâyb, nous sommes admis dans l’intimité du monde, là où nous nous tenons toujours déjà, et que nous sommes nous-mêmes, quand bien même nous nous en serions détournés depuis longtemps.
Bien que nous ne puissions nous le représenter, nous disposons néanmoins d’un accès au secret. Mais c’est en tant que mystère seulement que le retrait peut être visé et approché. Celui qui se dit capable de voir et de connaître l’invisible devient coupable d’un taghout : il commet une démesure, en prétendant dépasser les limites qui lui sont assignées : il se prend pour Dieu ou pour un envoyé de Dieu – car on sait que Dieu a accordé et ce, de façon ponctuelle, un rapport présentifiant à cette absence en dévoilant aux prophètes le voilement dévoilant, en leur rendant visible la lumière occultée. On peut supposer que ce qui leur a été ainsi dé-voilé n’en a pas moins cessé d’être dé-voilé, car ce que le dévoilement leur a révélé, c’est bien le voile pudique qu’il porte sur lui-même. La présence est en retrait du présent. La présence se retire du présent. Ce retrait a pu être manifesté à certains tel qu’il est, comme non manifeste, présentifié comme absence, montré comme ce qui ne se montre pas, vu comme ce qui excède toute vision.
Dans le taghoût, règne l’idolâtrie contraire à la foi, où on a besoin d’associer au Dieu unique, diverses représentations qui tiennent alors lieu de dieux divers. L’idolâtrie peut persister sous des formes en apparence moins religieuses mais qui ne perdent pas leur caractère théïologique : l’athéisme n’en préserve pas.
Noyée dans la profusion des représentations, l’idolâtrie (qu’elle soit religieuse ou athée) ignore la nécessité du secret. Elle est par essence faitichiste. En vertu d’un préjugé positiviste, trop souvent, on croit que pour dévoiler, il suffit d’arracher des voiles. Si cela vaut pour les choses visibles, cela n’est pas le cas pour l’invisible. Surmontant le taghout et ses cortèges de veaux d’or, la pensée méditante des mystiques se con-fie à l’invisible. Que serait cette fiance sans ce rapport à l’invisible? Cet être-fié qui précisément laisse être ce que nous ne saurons voir ni connaître. Ce qui est vu, ce sont les signes extérieurs de la création, les retombées de son élan. Mais l’exotérique est toujours l’exotérique d’un ésotérique, il renvoie à un intérieur qui ne peut être exhibé ni exposé, mais qui transparaît à même le visible, comme l’invisibilité fondamentale qui le supporte, comme ce retrait sans lequel il n’y aurait jamais de venue à la présence.
Avec le dieu, ce retrait se creuse de plus en plus, et on entre dans l’ésotérique de tout l’ésotérique. Dieu même pour être dieu a besoin du retrait. Le divin est en dieu ce qu’il y a de plus en retrait, au point qu’il n’est pas interdit de dire que le ghâyb est plus originaire que le dieu.
Rappelons-nous parmi les multiples noms, le 76ième : el-Bâtin qui signifie le caché, l’ésotérique, vient du mot el-Batn, « le ventre ». Mais à la différence de ce que cache le ventre, les entrailles, et qui demeure visible au moment où on a arraché l’enveloppe extérieure, el-Batn lui-même ne peut être exhibé, comme s’il suffisait d’effeuiller le visible pour le rencontrer à un certain moment, comme les entrailles dans le ventre. Mais ce nom est précédé dans la liste par son contraire : el-Dhâhir, l’apparent, le manifeste. Comment penser le rapport entre ces termes ? Y a-t-il là une contradiction ? Ce que cette opposition laisse entendre, c’est que le dieu est à la fois ce qui est le plus présent et ce qui est le plus absent, de plus évident et de plus invisible. La contradiction est levée si on considère que ce n’est pas au même titre et relativement à la même chose qu’il est absent et présent : dieu est présent par son absence et dieu est l’absence de la présence. Son évidence et son invisibilité se fondent dans ce qu’il y a de divin en lui, et qui est son essence à jamais impensée. Ravalé au rang de l’étant, fût-il suprême, le divin est perdu.
Le retrait du divin, aucun homme, aucune créature pas même dieu lui-même – au risque de penser une impuissance fondamentale au cœur de dieu – ne sont capables de le surpasser ou de le surmonter : ne pouvant s’incarner, engendrer ou être engendré, le divin ne le peut car il est déjà la chair invisible du visible.
C’est seulement dans l’abandon de la pensée au ghâyb, que la frustration divine peut « dévoiler » quelque chose de son mystère. Car le dieu ne peut que révéler son impuissance à se rendre visible. La pensée fidèle se tourne ainsi vers ce qui ne pourra jamais lui faire face à titre d’objet de représentation.
Que signifie dès lors pour le fidèle de s’abandonner au ghâyb ? Non pas quitter le visible pour une contemplation aveugle et sans but, mais au contraire s’y consacrer sincèrement. En effet, il ne faut pas penser que ce retrait divin signifie un délaissement et un abandon de l’homme. Le retrait ouvre un champ historial pour l’intelligence et la volonté, pour le cœur et l’esprit : le monde.
En montrant le divin comme ce qui en dieu est ce qu’il y a de plus caché, la pensée fidèle nous livre son secret, à l’abri de la présence. Nous sommes dès lors en mesure de confier notre activité au monde tout en laissant être l’invisible. Car dans cette foi originaire, l’amour du secret ne cherche pas à rendre visible l’inapparent qui se trouve au cœur de ce qui apparaît. Au contraire, il laisse le ghâyb dans son abri et dans le même temps se retrouve lui-même libre pour œuvrer dans le monde. L’abandon au ghâyb et l’engagement dans le monde sont les deux revers du même acte qui est de laisser être l’invisible tout en se consacrant au visible.
Alors que la séparation et la transcendance du divin devrait avoir pour résultat de libérer le champ de l’action politique de toute contamination théologique, de toute représentation de Dieu sur terre, d’un sacré susceptible de profanation, elle est loin d’avoir empêché la succession des dieux et de leurs vicaires. En France, la mort de Dieu n’a pas eu pour conséquence l’instauration de fondements non-théologiques à la cité politique. Elle a, loin de là, rapporté un nouveau culte, celui d’une laïcité républicaine incomprise et dénaturée, dès l’instant où la société civile est sommée de la réaliser et où le moindre croyant est perçu comme un ennemi potentiel. Le système de la représentation généralisée est selon nombre de ses aspects anti-démocratique, tout entier fondé sur l’idée d’un Etant suprême, celui que la théologie dogmatique connaissait sous les modalités de l’analogie. Ce qui est reconnu comme étant le plus haut, comme summum ens, étant suprême, theiôn, c’est ce qui peut représenter le peuple. Se dessinent les rapports de proportion, depuis le Président de la République jusqu’aux sans-rien : sans abri, sans pays. La politique du laós se confine à la représentation. Et la Révolution française aura eu parmi ses innombrables tendances, celle d’avoir démocratisé la fonction royale en permettant aux « élus » d’occuper le trône pour un temps déterminé, sans qu’il n’y ait eu à proprement parler de changement de régime.
A l’inverse, certains processus planétaires sont déconnectés de leurs causes et affublés d’un sens théologique qui ne leur est pas propre ; présentés sous les traits abstraits d’une guerre des civilisations, ou de celle de la civilisation contre la barbarie, d’une guerre des religions, ou de celle du religieux contre l’universalité des Droits de l’Homme. Mais c’est pour mieux effacer leur sens politique, pour éviter de poser les problèmes dignes d’être posés.
Quant au martyr (shahîd, le témoin), s’il est facile de le présenter comme un enthousiaste fou de Dieu, il faut bien admettre qu’en vérité il ne témoigne de rien. Il n’est que le martyr de l’absence. Ce qui peut aussi et du même coup le faire passer pour un bourreau de la présence. »